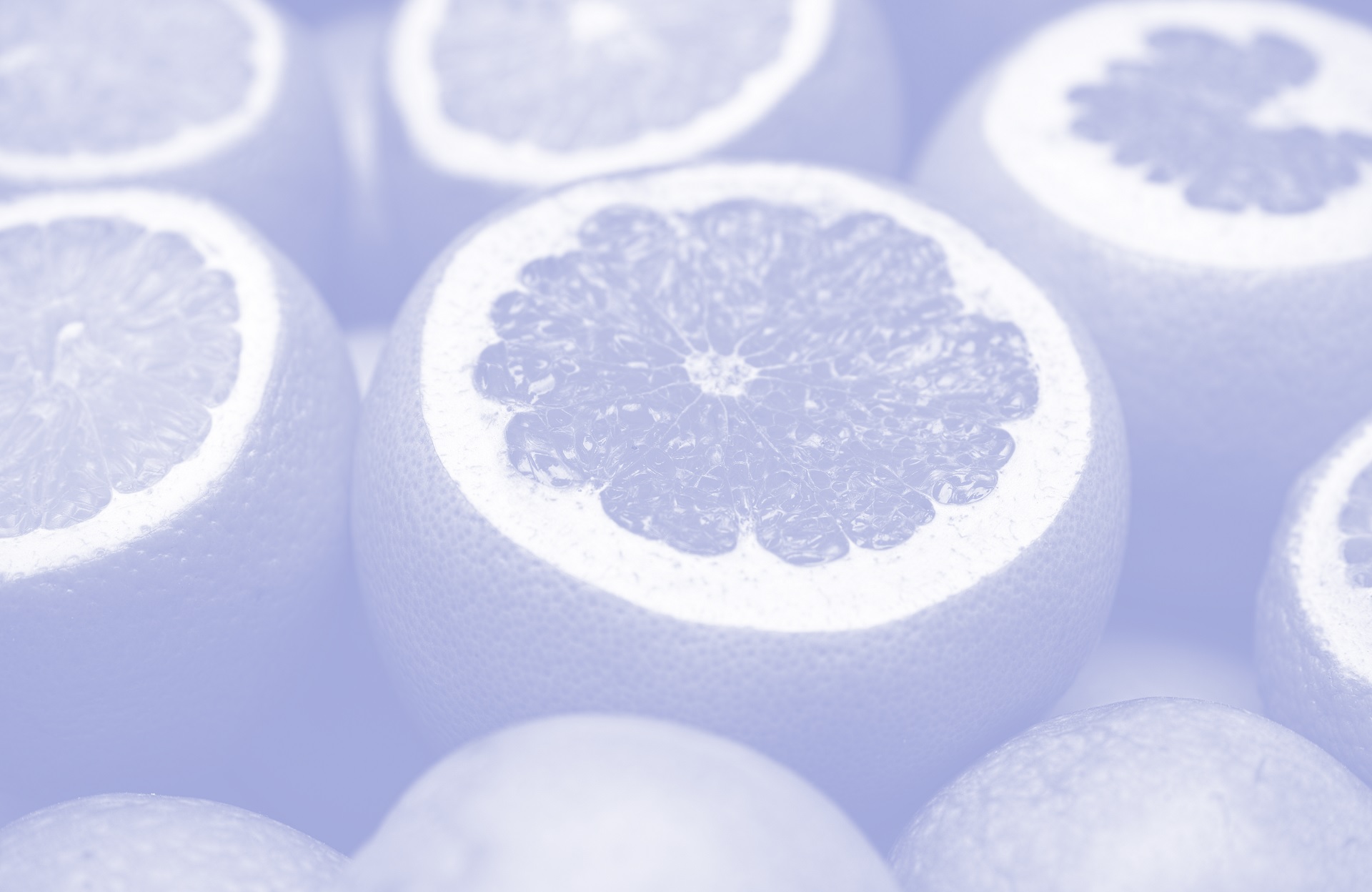Dans son dernier essai (L’Inquiétante familiarité de la race, publié aux éditions Le Bord de l’eau), le politiste Alain Policar revient sur l’emploi aujourd’hui grandissant des concepts d’intersectionnalité ou de race, et plaide notamment pour un universalisme revisité – et éloigné de tout idéal d’uniformité.
Vous avez regretté sur le site de Telos qu’en « assignant à la matrice coloniale l’ensemble des discriminations que subissent les habitants des quartiers défavorisés, il devient impossible de penser les fabriques contemporaines des racismes ordinaires ». À quelles formes de fabriques pensez-vous ?
Toutes les discriminations ne relèvent pas de l’histoire coloniale. Certes, celle-ci est largement explicative des mécanismes ségrégatifs subis par ce que l’on nomme les minorités visibles, mécanismes qui donc peuvent être interprétés selon un paradigme racial. Mais le fonctionnement même du système capitaliste produit la ségrégation spatiale, les inégalités scolaires, l’accès fortement différencié au monde de l’emploi durable. Ces mécanismes existent indépendamment du passé colonial ou esclavagiste. Et si ceux qui les subissent n’appartiennent pas seulement aux minorités visibles, ces dernières voient se cumuler les handicaps, ce qui explique leur surreprésentation notamment dans les prisons. Car n’oublions pas que les seules différences pratiquement ineffaçables, comme l’a rappelé Todorov dans Nous et les autres, sont les différences physiques, celles dites de « race » et celle de sexe. Et, précisait-il, « si les différences sociales se superposent pendant suffisamment longtemps aux différences physiques, naissent alors ces attitudes qui reposent sur le syncrétisme du social et du physique, le racisme et le sexisme ». L’assignation à la couleur de peau relève du racisme ordinaire, lequel fait partie du quotidien des minorités dites visibles. Aurélia Michel en rend compte avec une particulière acuité dans Un monde en nègre et blanc.
Vous plaidez pour une éthique de la coexistence. En quoi consisterait-elle ? L’injonction à la concorde ne risque-t-elle pas de se muer en une injonction unilatérale, qui exige des populations minoritaires qu’elles oublient les méfaits présents et passés sans rien obtenir en retour ?
Je comprends tout à fait votre inquiétude. Mais je ne prétends pas qu’il faille oublier les méfaits passés et, a fortiori, présents. Bien au contraire, je pense que les torts doivent être réparés. Et, de ce point de vue, je ne peux que renvoyer aux récents travaux de Magali Bessone. Ils appellent en effet à reconstruire des institutions, des normes, des pratiques, des structures plus inclusives et moins inégalitaires. Cette reconstruction implique de visibiliser le caractère structurel de l’inégalité qui pèse sur les populations anciennement colonisées et réduites en esclavage. On ne peut fonder le refus de la réparation, comme c’est très souvent le cas, sur le décalage temporel entre le moment où les crimes se sont produits et la formulation contemporaine des revendications de rétablissement de la justice. Ce serait, selon Magali Bessone, se méprendre sur la nature de ces injustices. Plutôt que de les considérer comme des « crimes historiques, datés et finis », on devrait les envisager comme « des injustices persistantes affectant la structure même, juridique, politique et sociale, de la République »1Faire justice de l’irréparable : esclavage colonial et responsabilités contemporaines, Paris, Vrin, 2020, p. 58.. Cette position pose le problème de l’imputabilité de l’injustice aux protagonistes disparus, mais aussi, en l’absence des victimes directes de celle-ci, de l’identification des personnes méritant réparation. La philosophe résout cette importante question d’une façon tout à fait novatrice : ce qui est à réparer, ce n’est pas le passé, mais la structure. Dès l’instant où l’on appréhende l’injustice en termes non pas individualistes (comme le ferait le droit) mais structurels, on est en mesure de comprendre que ce n’est pas le crime passé qui doit être réparé, mais nos structures institutionnelles actuelles, lesquelles restent marquées par les anciennes inégalités raciales. On pourrait rétorquer que ces dernières ont déjà été corrigées. Mais c’est précisément ce que réfute Magali Bessone : en examinant la période située entre 1848 (abolition de l’esclavage) jusqu’aux indépendances, elle montre que les structures juridiques et socio-économiques de la France ont non seulement été installées par l’expansion coloniale mais qu’elles restent productrices d’injustices raciales.
Ce point est essentiel : l’esclavage et la colonisation ne sont pas, comme le pensent encore certains « républicains », totalement des anomalies. Ils ont été justifiés au nom des idéaux de la République, de sa « mission civilisatrice ». Magali Bessone dégage, de façon convaincante, l’existence d’une continuité des normes racistes qui ont fourni une assise à l’exploitation économique post-abolition. Les demandes de réparation ne sont pas de nature financière mais, c’est fondamental, de nature morale. Elles sont liées à une exigence de solidarité et reposent sur ce que nous estimons nous devoir les uns aux autres dans une communauté politique. Dès lors, le fait que les générations présentes ne soient pas coupables de l’esclavage colonial, qu’elles n’aient pas commis de faute morale pour laquelle on pourrait les blâmer, qu’elles ne soient pas causalement responsables n’implique pas qu’elles ne puissent être tenues pour responsables de la réparation.
Il est ici question de demande de reconnaissance dans un double sens : d’une part, que le passé soit pris en compte et la vérité rétablie et, d’autre part, de reconnaissance intersubjective, fondée sur le respect et la confiance. Le paradigme est donc celui de la justice transitionnelle. Réparer l’injustice historique, c’est s’engager à transformer les institutions et les pratiques qui, sans intention consciente manifeste, relèguent à un statut subalterne les racisés.
Ce n’est que dans ces conditions que peut être sérieusement envisagée une éthique de la coexistence. Celle-ci se réalise dans la réciprocité (chacun considère tout autre comme un autre soi) et l’égalité (chacun considère tout autre comme égal à soi), qui, par conséquent, oppose à l’épistémologie du point de vue un point de vue de toute part, selon la belle expression de Francis Wolff. Cette éthique spécifiquement humaine, fondée sur l’existence d’invariants anthropologiques, ne sacrifie pas au culte du divers, du fragmenté, à la célébration des origines.
Vous relevez que les personnes juives sont peu prises en compte dans les réflexions autour de la racisation et la racialisation. Comment l’expliquez-vous ?
C’est une question difficile. Ma réponse n’a pas d’autre prétention que d’esquisser des pistes. Le premier facteur, sans doute le plus important, tient à la nature de l’antisémitisme. S’il est évidemment un racisme, ses spécificités font du Juif une figure de la puissance, certes dans la malveillance, et non, nonobstant le sort des populations juives dans l’histoire des persécutions, dans la soumission. On se souvient de la phrase célèbre du général De Gaulle, parlant des Juifs comme d’un peuple dominateur. Or la racisation est décrite, à juste titre, comme subie. Le second facteur est plus conjoncturel (même s’il s’agit d’une conjoncture durable) : il tient au fait que les Juifs sont soupçonnés de collusion avec Israël : il pèse sur eux l’accusation de sionisme, sans que l’on sache très bien à quoi elle renvoie tant le mot est polysémique. Mais on comprend aisément, nonobstant le nombre considérable de Juifs critiques à l’égard de la politique de colonisation israélienne, que tout Juif est un sioniste potentiel, autrement dit un ennemi du genre humain, comme l’était autrefois le « Juif vague » cher à Drumont. La stratégie d’euphémisation, liée au discrédit scientifique de la notion de race, rend ainsi, pour un nombre de plus en plus grand de nos contemporains, l’antisémitisme respectable. Bref, les Juifs ne sont pas des racisés comme les autres.
Vous prétendez qu’il semble « tout à fait exclu de détacher la notion de race de ses usages racistes et donc de distinguer la « race » du sociologue (ou du chercheur en général) de la « race » du raciste ». On peut, bien sûr, questionner le choix et l’opportunité d’utiliser tel ou tel mot. Mais cette polysémie ne touche-t-elle pas un immense nombre de termes sociologiques ou politiques (vous évoquez vous-même l’exemple du sionisme) ?
Oui, vous avez raison sur l’étendue de la polysémie. En outre, depuis la rédaction de l’ouvrage pour lequel vous m’interrogez, j’ai changé d’avis sur cette question. La distinction entre la race du sociologue, plus généralement de celui qui l’aborde comme un domaine d’étude, au même titre, par exemple, que le genre, et les « races » du raciste tient précisément à la différence entre le singulier du premier et le pluriel du second. Dès l’instant où l’on parle des « races », on permet qu’elles soient hiérarchisées. Or la hiérarchie est un élément essentiel de la démarche raciste. L’existence d’un racisme différentialiste, soit fondé sur l’exaltation de la différence, n’est qu’une manière d’habiller culturellement ce qui, aux yeux du raciste, reste fondé dans l’ordre naturel.
Pourquoi préférez-vous le principe de consubstantialité à celui d’intersectionnalité ?
Soyons bien clair : je ne fais pas partie de ceux qui vouent le concept d’intersectionnalité aux gémonies. Je le crois même tout à fait heuristique. Je vais expliquer en quoi de façon à ce que l’on perçoive mieux la nature des critiques que je lui adresse. Proposée en 1989 par Kimberlé Crenshaw, l’intersectionnalité est devenue, ces dernières années, le sésame explicatif. Pensée comme un outil d’analyse de la domination, elle cherche à rompre avec les approches analogiques (par exemple, le sexisme pensé sur le modèle du racisme) ou additives (lesquelles se limitent, sans le théoriser, à énoncer le cumul des discriminations). Pour expliquer la complexité des relations de pouvoir, il conviendrait de prendre en compte les influences réciproques de la race, du genre et de la classe.
Kimberlé Crenshaw, en tant que juriste, a pensé la notion en constatant que les juges américains ne reconnaissaient pas les spécificités des discriminations subies par les femmes noires et ne pouvaient ainsi leur accorder une protection particulière. Il faudra que se mettent en place des actions compensatoires (généralement désignées, de façon malhabile, sous le concept de discrimination positive) pour que soient prises en compte ces spécificités. Or, en France, l’universalisme républicain, bien souvent confondu avec l’uniformité, s’oppose à la reconnaissance de ces discriminations particulières. Leur tardive considération s’est faite de surcroît par la promotion d’un discours entrepreneurial sur la diversité (alors qu’aujourd’hui, outre-Atlantique, l’intersectionnalité est évoquée comme un outil critique s’opposant à ce discours).
L’intersectionnalité se veut donc avant tout une praxis critique orientée vers la justice sociale, notamment en accordant une extrême attention aux phénomènes de marginalisation. Une juste estimation de ses apports théoriques doit tenir compte de son héritage marxiste, à travers, notamment, le Black Feminism américain dont le projet d’émancipation emprunte au vocabulaire de la lutte des classes (notamment le manifeste du Combahee River Collective en 1979). Aussi faut-il regarder avec circonspection les attaques visant à disqualifier l’approche intersectionnelle en la présentant comme une simple mode intellectuelle.
Je la critique néanmoins en raison de l’attention prédominante, au fur et à mesure de son institutionnalisation académique, accordée aux questions de genre et de race, au risque de ne plus remplir le rôle qui lui était assigné : être un instrument de dévoilement des rapports d’exploitation. C’est pourquoi il est nécessaire de la confronter à une théorisation rivale, l’approche de la consubstantialité.
La critique matérialiste reproche à l’analyse intersectionnelle de ne pas suffisamment voir que les rapports de sexe sont des relations de production et d’exploitation. L’intersectionnalité réduirait à l’excès le rôle du monde du travail, notamment dans le processus de définition des normes de genre.
La différence de perspective est aisément perceptible : alors que l’intersectionnalité se penche sur des catégories constituées, le féminisme matérialiste insiste sur le processus de production des classes et donc sur les rapports sociaux. Le rapport social de sexe implique plus que l’appropriation de la force de travail : il met l’accent sur la relation d’appropriation physique, sur la dépossession de soi pour les femmes, ce qui a conduit à forger le terme de sexage par analogie avec esclavage (l’esclave ne peut vendre, par définition, sa force de travail). J’ajoute, ce n’est pas sans signification, que les violences sexuelles ont, semble-t-il, été dénoncées, pour la première fois, au sein de la classe ouvrière, en 1905 aux usines Haviland à Limoges.
Il existe donc, dans l’analyse matérialiste, une volonté de remonter aux racines de la domination, ce qui impose de rendre compte de la pluralité des systèmes qui la constituent. Le choix en faveur du concept de consubstantialité correspond adéquatement à l’idée qu’il existe une unité de substance entre entités distinctes, et il insiste sur le fait que ces entités ne peuvent être comprises séparément, sous peine de les réifier. Comme l’écrit Danièle Kergoat, « c’est ensemble qu’ils tissent la trame de la société et impulsent sa dynamique : ils sont consubstantiels ».
Vous critiquez souvent ce que vous appelez, à la suite de Michael Walzer, un universalisme de « surplomb ». Pouvez-vous préciser de quoi il s’agit, et en quoi votre critique se distingue de celles parfois formulées dans le champ décolonial ? À quoi un universalisme « concret » ou « réitératif » pourrait-il donc ressembler – et comment pourrait-on le faire advenir ?
Un mot d’abord sur le champ décolonial. Il est, c’est une trivialité, extrêmement divers. Et, même si les auteurs qui s’en revendiquent ne seraient pas nécessairement d’accord avec mon diagnostic, il me semble que, précisément, la critique fondamentale que l’on est en droit de lui adresser est qu’il rompt, contrairement aux postcoloniaux, avec l’universalisme. Le relativisme culturel, mais aussi moral ou cognitif, me semble, par la rupture revendiquée envers les grands récits d’émancipation de la modernité, caractéristique du décolonialisme. Mais évidemment ma critique ne m’entraîne pas vers la célébration d’un « universalisme » qui confond l’universel et l’uniforme.
En effet, le modèle d’intégration à la française est lié à une conception extrêmement contestable de l’universalisme, qu’il est commun, depuis l’article célèbre de Michael Walzer (dans Esprit de décembre 1992), de désigner comme l’universalisme de surplomb. L’expression avait été utilisée, sans doute pour la première fois, en 1958 par Maurice Merleau-Ponty, dans son rapport pour la création d’une chaire d’anthropologie sociale au Collège de France (laquelle sera occupée par Lévi-Strauss), mais en un sens différent. Il l’opposait alors à l’universalisme latéral, défini comme celui qui tient compte de la concrétude d’une société (alors que l’universalisme de surplomb était conçu, à l’instar des structures élémentaires de la parenté chez Lévi-Strauss, comme purement formel) : « Il s’agit de construire un système de référence général où puisse trouver place le point de vue de l’indigène, le point de vue du civilisé, et les erreurs de l’un sur l’autre, de constituer une expérience élargie qui devienne en principe accessible à des hommes d’un autre pays et d’un autre temps. » En termes politiques, l’universalisme latéral privilégie la rencontre et provoque ainsi une « incessante mise à l’épreuve de soi par l’autre et de l’autre par soi ». Il est donc une dénomination possible pour un universalisme authentique.
Un autre nom pour l’universalisme de surplomb est celui que propose Aimé Césaire. Le souci fondamental de celui-ci est de dissiper les préjugés raciaux qui ont servi de justification à la colonisation elle-même et, par conséquent, de s’attaquer aux représentations dont les colonisés ont été l’objet. Dans sa magnifique lettre d’octobre 1956 à Maurice Thorez (lettre de démission du PCF), il distingue alliance (entre lutte anticoloniale et communisme) et subordination, et il dénonce l’« assimilationisme invétéré », le « chauvinisme inconscient » et l’européocentrisme du PCF. Diagnostic qui vaut encore pour notre temps : « C’est une véritable révolution copernicienne qu’il faut imposer, tant est enracinée en Europe, et dans tous les partis, et dans tous les domaines, de l’extrême droite à l’extrême gauche, l’habitude de faire pour nous, l’habitude de disposer pour nous, l’habitude de penser pour nous, bref l’habitude de nous contester le droit à la personnalité. » Et au reproche éventuel de « provincialisme », Césaire répond qu’il refuse tout aussi bien le « particularisme étroit » que l’« universalisme décharné ».
Il n’est pas sans signification de noter que la position de surplomb peut se vêtir d’autres habits, notamment ceux de l’anti-cosmopolitisme, lequel vilipende utopistes invétérés et belles âmes aveuglées : « Et si cette toquade pour le pluriel cachait en réalité une allergie à la diversité ? » (Pascal Bruckner) Cette rhétorique paradoxale relève de l’orgueil de celui qui affirme dire le vrai contre la doxa. Le cosmopolitisme fondé sur l’universalisme moral ne serait, en définitive, qu’un relativiste béat. Bruckner écrit ainsi : « L’amour de l’altérité débouche sur l’indifférence quiétiste : tout se vaut finalement, les visions du monde se démentent les unes les autres. » Faut-il vraiment prendre la peine de réfuter semblable « argumentation » ?
Les appels à la tradition ou aux racines recherchent souvent dans la terre la supposée vérité de l’identité. Combien de conflits se focalisent sur la possession de lieux avec lesquels nous entretiendrions des liens immémoriaux ? Nous gagnerions beaucoup à considérer les traditions non comme verticales mais comme horizontales : aux racines qui nous attachent à un endroit, il faut substituer l’image du fleuve où chaque affluent apporte sa part. Autrement dit, nous devons comprendre que l’important se situe, comme le note précieusement Maurizio Bettini, dans la reconstruction continue de la mémoire collective. Or, nous confondons trop souvent cette mémoire collective avec la mémoire privée, c’est-à-dire l’anthropologie et la nostalgie. Nous avons évidemment le droit d’être nostalgique, mais à condition que ce ne soit pas le prétexte d’une déploration dont les responsables seraient ceux qui viendraient, en même temps qu’ils transforment nos repères familiers, détruire nos « racines culturelles ». La référence aux racines implique, en effet, l’idée que l’authenticité tout entière est contenue dans les origines. Les influences postérieures, étrangères forcément, ne sont alors que dénaturation.
Le kosmopolites, le citoyen du monde, celui pour lequel le monde est sa seule maison, par son existence même, rend caduque la notion d’étranger. La société romaine s’est bâtie sur un mythe, celui de l’asylum, selon lequel Romulus aurait accueilli des fugitifs venus de partout. La naissance de Rome est ainsi placée sous le signe de l’ouverture : Plutarque dans Vie de Romulus, évoque la fosse dans laquelle chacun jette une poignée de terre apportée du pays d’où il vient et, une fois l’ensemble des poignées mêlé, désigne la fosse du nom de mundus pour y tracer tout autour, en forme de cercle, le périmètre de la ville. À Rome, par conséquent, ce n’est pas la terre qui engendre les hommes, mais les hommes qui fabriquent la terre. Il nous faut méditer la leçon des Romains. Ceux-ci accordaient peu d’importance à l’autochtonie, à l’idée d’être né de la terre, alors que c’est le refus de se mélanger qui, malgré leur puissance militaire, a sapé le destin d’Athènes et de Sparte.
Comme l’écrit Aimé Césaire, un universalisme ouvert à l’altérité, un universalisme pluriel doit se vouloir « riche de tout le particulier, riche de tous les particuliers, approfondissement et coexistence de tous les particuliers ».
Alain Policar est un politiste associé au Centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof). Il a notamment publié L’Inquiétante familiarité de la race – Décolonialisme, intersectionnalité et universalisme aux éditions Le Bord de l’eau (2021).
Entretien mené par Paul Tommasi.