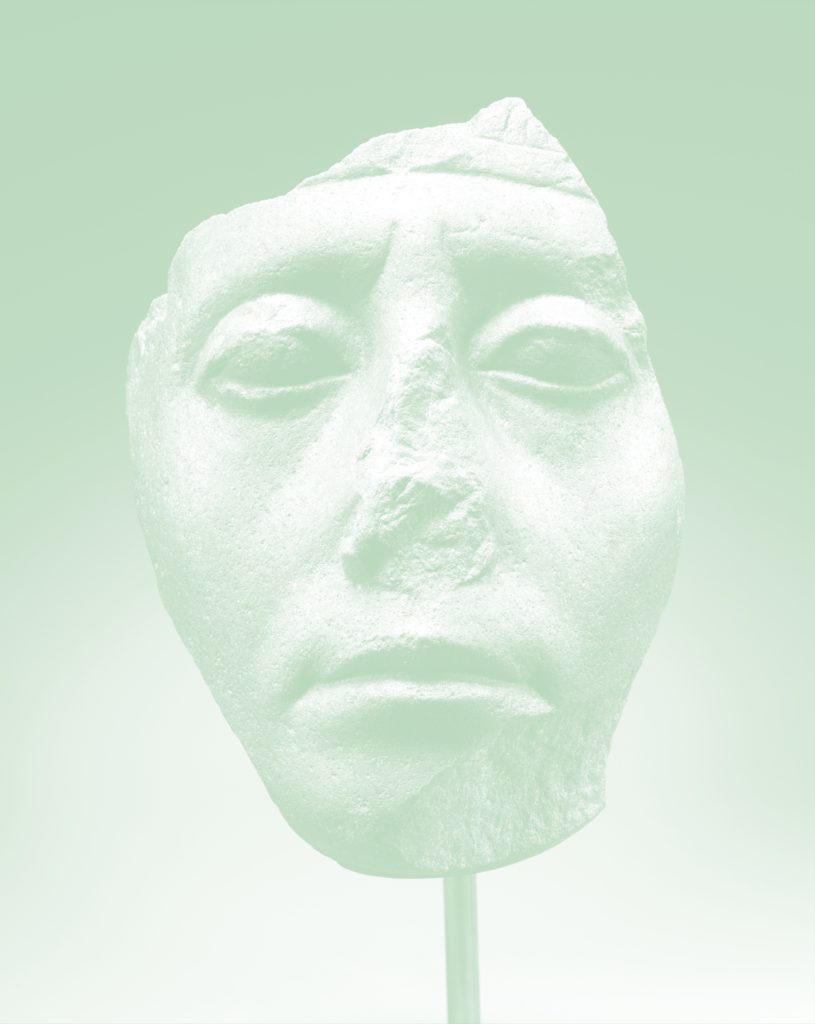
Rafaël Tyszblat est médiateur et concepteur de programmes de dialogue interconvictionnel et inter-identitaire notamment à Soliya, Connecting Actions et la Muslim-Jewish Conference.
Nous avons échangé avec lui sur le « devoir de mémoire », les processus de minorisation, le besoin universel de reconnaissance et le rôle que peut jouer la médiation dans les luttes contre les discriminations – ainsi que sur ses réticences à l’encontre de certaines autres formes de lutte.
Le besoin d’être reconnu dans son identité (et dans ses souffrances) est présenté par certains comme un des maux de notre époque. Quel est votre avis sur la question ?
D’abord, il y a bien aujourd’hui une individualisation croissante des rapports sociaux, en même temps qu’une remise en cause des structures traditionnelles. Cela s’accompagne de la multiplication des groupes identitaires se pensant comme une communauté, qu’ils soient fondés sur des critères ethniques, religieux, sexuels, biologiques, sociaux, culturels ou politiques.
Je crois que le besoin de reconnaissance est à la fois profondément humain, naturel, et potentiellement destructeur. Profondément humain parce que, étant des êtres grégaires et sociaux, nous ne pouvons vivre sans la reconnaissance par les autres que nous existons réellement, que ce soit physiquement ou symboliquement à travers nos identités. Dangereux parce que, dans un monde où tout se sait, et où les identités sont en évolution constante, le besoin de reconnaissance paraît impossible à satisfaire complètement. C’est un processus sans fin et qui favorise l’escalade.
Il faut mentionner dans ce contexte le travail de René Girard qui décrit très bien ce mécanisme qui conduit les individus et les groupes à imiter le comportement les uns des autres avec une escalade inévitable des revendications et de la violence. Même les neurosciences nous confirment que toute menace même symbolique est traitée par notre cerveau comme une question de vie ou de mort. La violence ne doit donc pas nous étonner. Ce qui est nouveau, c’est le caractère exponentiel de ces escalades. C’est la complexification, favorisée par les médias (qu’ils soient « mainstream » ou « alternatifs »), de l’ensemble des dynamiques identitaires au niveau global. L’accroissement de la masse et de la durée des interconnexions entre groupes identitaires conduit à créer sans cesse de nouvelles revendications – de la part des minorités comme des majoritaires.
Sans connaissance de l’existence et du comportement des autres, il n’y aurait sans doute pas d’escalade mais il est clair aujourd’hui que dès que quelqu’un revendique un statut identitaire ou victimaire, il le fait à travers de nombreux canaux de communication qui atteignent beaucoup de monde. Ainsi de plus en plus de gens seront touchés par ces affirmations identitaires et seront tentés de demander : « et moi ? » De plus, on sait qu’une identité bien affirmée – et son corollaire potentiel, la victimisation – donne du pouvoir à ceux qui estiment en avoir moins que les autres. Or, chacun ayant tendance à se focaliser sur les plus puissants et à les envier, le combat pour la reconnaissance rejoint le combat pour l’égalité. La recherche de l’égalité ne s’exerce pas seulement sur le plan économique : elle se veut de plus en plus symbolique. On veut l’égalité de statut, qui n’est jamais vraiment mesurable donc jamais vraiment atteignable. Cette course sans fin se déroulant dans le chaos communicationnel des réseaux sociaux, elle semble très difficile à freiner.
Comment réconciliez-vous cette idée avec le fait que nombre de minorités subissent discriminations et infériorisation dans nos sociétés ?
Il est clair que les revendications identitaires sincères existent. Pour moi, tout est une question de sincérité. Il est difficile de distinguer ce qui est légitime et authentique, et ce qui relève plutôt d’une sorte de stratégie politique. On peut en effet se victimiser simplement parce qu’on voit que cela apporte une forme de pouvoir. Cela ne remet pas en question la légitimité d’autres revendications liées aux discriminations que subissent les minorités, et à l’invisibilité de ces minorités dans l’espace public, médiatique et politique. Qu’il y ait des minorités et une minorisation de certains groupes, c’est évident. Il est indéniable que les noirs et les arabes sont en situation collective de minorisation, et qu’il y a une dominance (certains disent une oppression) de la majorité sur ces minorités. C’est une réalité qu’il faut reconnaître et tenter de corriger.
Pour moi, le dialogue est le meilleur moyen de faire comprendre profondément cette expérience de la minorisation et de faire adopter un changement de comportement sincère par la majorité. Et c’est aussi par le dialogue, je pense, qu’on peut relever ce qui tient d’une attitude un peu moins sincère. Pour moi, ce qui empêche le changement, c’est souvent que les avocats de causes justes s’expriment à travers des postures politiques : des positionnements et des éléments de langage censés représenter ce que pense l’ensemble des avocats de cette cause. Or toute posture, même lorsqu’elle s’appuie sur quelque chose de réel, est détachée de la sincérité originelle et de l’expérience concrète de chaque individu. Concrètement, je peux vivre une expérience de discrimination sur laquelle j’essaie de sensibiliser les autres. Mais lorsque cette sensibilisation se transforme en campagne soutenue par un corpus idéologique censé apporter des solutions intellectuelles englobantes, elle est moins facilement entendable. Ce détachement nous empêche d’avancer ensemble. Le dialogue que je pratique permet de connecter réellement les personnes, au-delà de leurs affiliations idéologiques ou partisanes, et donc d’avancer ensemble pour la justice et la paix.
Vous défendez l’idée que, pour réduire la dimension émotionnelle de nos conflits, nous devons d’abord parler de ce que nous ressentons. Pouvez-vous en dire plus ?
C’est très simple, même si c’est contre-intuitif pour beaucoup de gens encore aujourd’hui : pour mieux gérer nos émotions, pour pouvoir s’extirper de leur potentiel violent, la pire des choses est de les réprimer. Il faut donc d’abord comprendre qu’il est inutile de rejeter ou d’ignorer les émotions. Celles-ci sont, selon moi, toujours légitimes puisqu’elles sont justement irrépressibles et naturelles. On peut condamner et tenter de limiter la violence des comportements mais les émotions, elles, ne doivent pas être confondues avec cette violence, même si l’apparition des émotions fait craindre leurs expressions violentes, comme un réflexe pavlovien. En fait, en réprimant systématiquement les émotions, nous nous privons d’informations essentielles. Les émotions donnent toujours accès à des informations précieuses dans l’effort d’amélioration de nos relations parce qu’elles donnent accès à ce qui est réellement en jeu dans nos frustrations, nos revendications et nos conflits. Même si notre fierté d’homo sapiens nous empêche de l’admettre, c’est notre affect qui domine notre intellect et pas l’inverse, surtout en situation de conflit. De nombreux travaux en neurosciences le démontrent : nous sommes moins des êtres rationnels que des êtres qui rationalisent leurs réactions instinctives. Et pour une bonne raison : nos émotions sont bien plus rapides que notre réflexion pour nous sortir d’une situation potentiellement menaçante.
Elles ne sont néanmoins pas toujours efficaces ou justes, et c’est pour cela que la raison est utile car elle permet de corriger, après coup, des perceptions erronées. Mais elle ne peut le faire qu’après coup. Si nous ignorons ce premier message émotionnel, nous nous privons d’informations brutes indispensables à une meilleure compréhension des autres ou de nous-mêmes. Surtout, nos instincts s’affranchissent de toute tentative de censure et ils trouveront toujours un moyen détourné de s’exprimer, notamment par la violence envers les autres ou envers soi-même. C’est justement parce que quelque chose n’a pas été écouté que la violence s’exprime. Si nous avons peur de la violence, nous ferions bien de faire la chose la plus efficace pour la désamorcer : écouter. La vraie sagesse est donc d’accueillir et d’entendre nos émotions. Ce qui est très difficile aujourd’hui car à l’école, en famille, dans l’entreprise ou l’administration, et aussi dans l’espace public, chacun est prié de « laisser ses émotions aux vestiaire », sous prétexte que ce serait plus professionnel. Mais il faudrait évaluer les coûts sociaux et, in fine, financiers de cette attitude pour les organisations. Je pense qu’on serait surpris de savoir ce qu’on perd en énergie à réprimer ce que tout notre être réclame d’exprimer.
Est-ce que cela implique selon vous d’aborder librement tous les sujets ?
Oui, si un sujet est présent dans l’esprit des gens, il faut pouvoir l’inclure dans les échanges. En même temps, chacun est libre aussi de ne pas participer à la conversation ! Je suis plutôt pour la liberté d’expression, surtout lorsqu’il s’agit de conversations non publiques. La publicité des échanges brouille leur authenticité et dès lors, le jeu est faussé car d’autres personnes font partie de l’univers de la conversation. Même si ces personnes spectatrices ne peuvent s’exprimer, elles limitent la spontanéité de ceux qui s’expriment puisqu’ils prennent en compte non seulement leurs interlocuteurs mais aussi leurs auditoires. Je pense qu’on doit pouvoir tout dire, quitte à choquer, mais il faudrait toujours prendre le temps et l’espace adéquat pour analyser et faire sortir la vérité profonde que veut exprimer l’auteur des mots qui fâchent et ceux qui les entendent. Je parle ici de tous ceux qui les entendent – ce qui devient très difficile lorsque ces derniers se comptent par millions ! Il faut comprendre la différence entre l’intention de l’auteur des mots et l’impact que ceux-ci ont sur les autres. C’est seulement en faisant cela que le caractère blessant et donc violent des mots sera désamorcé et que les protagonistes pourront véritablement apprendre de la discussion. Le problème aujourd’hui est que si cet échange se déroule sur la place publique, par tribune, émission, ou vidéo YouTube interposée, cela fera intervenir une infinité de commentateurs qui complexifieront les échanges, rendant impossible d’atteindre cette profondeur du dialogue. Je suis pour la liberté totale d’expression si la responsabilité qui doit l’accompagner est possible. Aujourd’hui, la multiplication exponentielle des messages publics et le temps court des médias rendent cette responsabilité quasiment impossible.
N’est-ce pas occulter qu’un propos peut être une violence en lui-même, et que la colère peut être une réponse légitime ?
Je pense qu’un même propos peut avoir un impact très différent selon la personne qui l’émet, son identité, son intention, la manière dont elle s’exprime, mais aussi selon la personne qui la reçoit, son identité, son histoire, sa personnalité et, bien sûr, selon le contexte et l’époque ! Ça fait beaucoup de paramètres… Ce qui fait conflit est toujours éminemment subjectif. On ne peut pas toujours prédire si telle ou telle action provoquera une réaction chez telle ou telle personne. Donc je ne pense pas qu’il est juste de dire qu’un même propos est toujours, partout une violence. Mais cela n’empêche pas non plus ceux qui les reçoivent de ressentir légitimement de la colère ! Encore une fois, les émotions sont toujours légitimes. Par contre, la colère n’est selon moi pas une raison suffisante pour brider l’expression, en tout cas pas avant d’avoir tenté de comprendre pourquoi un propos peut être violent et pourquoi des personnes souffrent de cette violence.
Les remises en question du « devoir de mémoire » sont aujourd’hui récurrentes. Certaines personnes regrettent que celui-ci soit devenu aussi solennel, alors que d’autres (comme David Rieff) présentent l’oubli comme un possible outil de réconciliation. Que pensez-vous de ces débats ?
C’est très compliqué et il faudrait justement ici prendre beaucoup de temps pour bien répondre ! Effectivement le devoir de mémoire est remis en question mais il est aussi défendu par énormément de monde – pas toujours dans le même sens évidemment. Le problème est que cette mémoire est malheureusement l’objet de la même compétition dont nous parlions lorsque nous évoquions la course identitaire et victimaire. La mémoire cristallise ces sujets puisque lorsqu’on parle de mémoire, on parle en général de mémoire victimaire. Le prétendu « devoir de mémoire » est en fait un appel à la reconnaissance qui s’est imposé, parfois par la loi, mais toutes les mémoires ne bénéficient pas de la même reconnaissance ni de la même garantie juridique. D’où la compétition permanente à laquelle on assiste. Je pense qu’on ne peut empêcher les personnes et les groupes auxquelles elles se sentent appartenir de revendiquer une mémoire et de la défendre. Pour autant j’ai tendance à être contre l’inscription dans la loi de ce qui relève de l’Histoire. La mémoire doit s’entretenir et s’enrichir par la pédagogie et le dialogue, pas par le législatif ou le judiciaire, car celui-ci n’est que le résultat d’un rapport de force à un moment donné, et il nourrit les ressentiments. Quant à l’oubli, je ne comprends pas très bien comment on peut l’exiger. David Rieff a raison lorsqu’il condamne la sacralisation de la mémoire. Le besoin de reconnaissance s’est mué, par le jeu politique, en devoir sacré de reconnaissance. La mémoire s’est transformée en une « iconisation », une fétichisation d’un souvenir figé. Or la reconnaissance et la connaissance d’une vérité historique ne peuvent survenir qu’à travers un dialogue, une pédagogie qui rend justice à la complexité de l’histoire. Par contre, Rieff a l’air de dire que l’oubli, lui, peut se décréter. Je crois moi que, s’il doit y avoir un oubli, il ne viendra qu’en laissant les gens libres d’oublier ou pas. L’oubli imposé provoquera forcément les mêmes réactions que l’inégale protection des mémoires. Cela sera perçu comme une violence et une injustice. Quand Benjamin Stora dit que « la mémoire est importante, mais pour vivre il faut savoir aussi oublier », je pense qu’il veut dire que notre travail de mémoire ne doit pas nous empêcher d’être des êtres autonomes, libérés de cette identité de victime essentialisée. Le problème de notre travail de mémoire est qu’il est trop souvent judiciarisé ou placé sous l’angle de la morale, et pas assez l’objet de conversations sereines. La mémoire est trop souvent perçue comme une idée abstraite et pas assez comme un vécu humain. La normativisation de la mémoire nous fournit des repères mais elle ne doit pas se faire au détriment du dialogue. Parlons des mémoires autant qu’il est besoin, jusqu’à ce que chacun puisse effectivement oublier. Mais on ne décrète pas l’oubli comme on ne décrète pas la reconnaissance ni la réconciliation.
La manière dont ces questions conflictuelles sont traitées sur les plateaux de télévision semble parfois contradictoire. On y entend régulièrement des appels à l’unité, et ce alors que sont dans le même temps invitées des personnalités qui prônent la division. Comment s’en sortir ?
Les appels à l’unité, dans l’espace médiatique, c’est une sorte de surmoi inauthentique, ce qu’on appelle le « Parent » en Analyse Transactionnelle : une antienne qui semble devoir s’imposer à leurs auteurs. Et en même temps, on sait que nombre d’animateurs de plateaux ont pour objectif explicite de provoquer le clash. Le clash est devenu irrésistible, comme une drogue, comme le sucre dans les aliments qu’on nous donne à manger. La plupart des médias mainstream et de très nombreux médias alternatifs sont coincés dans ce paradigme qui veut que l’audience baisse si on lui montre autre chose que de la violence ou de l’anxiogène. Pourtant on peut essayer de se sevrer de cette addiction. Il faut absolument des émissions qui, au lieu de prétendre appeler à l’unité, permettent l’expression de toutes les idées ; et qui, au lieu de rechercher la confrontation permanente, permettent d’avoir un échange où l’on peut justement apprendre de cette diversité d’idées, en sortir enrichi par un dialogue sincère. Un dialogue où l’expression des opinions mais aussi des émotions et des expériences personnelles serait encouragée, et où la restauration des liens viendrait, non d’un consensus, mais d’une acceptation de la diversité des personnes. Pour cela, il faudrait revoir ce qu’on enseigne en école de journalisme ainsi que les pratiques des grands médias. Le dialogue constructif dans la diversité requiert un savoir-faire qui s’acquiert par la formation. Le vrai rôle des journalistes et des présentateurs devrait être un rôle de médiateur pour que le public soit non plus « diverti » mais informé, au sens profond du terme : comprendre les discours, comprendre d’où ils viennent et prendre conscience des réelles différences de chacun pour se faire soi-même son idée. On en est encore loin. Il faut un véritable changement de culture des médias. Mais ce changement n’est pas impossible.
N’est-ce pas oublier que le temps passé à déconstruire une idée reçue ou une position mensongère est extrêmement long – et que ce qu’on peut faire lors d’une médiation devient presque impossible au sein d’une émission télévisée ?
C’est tout le problème, mais je pense que c’est possible dès lors que l’on met en place les bonnes conditions, le bon cadre et les bons outils de facilitation – et que l’on évite les « bons clients » habituels. Oui, le caractère public des échanges, l’absence de confidentialité peuvent porter atteinte au confort des participants et donc abaisser le niveau d’authenticité. Mais si l’animateur facilite véritablement le partage d’expériences personnelles, l’expression des émotions, la prise de conscience de ce qui est exprimé et de comment cela est exprimé, s’il parvient à installer une relations sincère avec ses invités, la conversation aura une toute autre qualité que ce que l’on nous sert le plus souvent. Certaines émissions se rapprochent un peu de cet idéal où l’on prend le temps de s’écouter, surtout à la radio. Mais il est évident que l’ont peut mieux faire pour concurrencer la culture du clash médiatique et faire en sorte que les médias jouent davantage un rôle de médiateur que de créateur de conflits.
Les compétences de médiation semblent aujourd’hui peu présentes (ou du moins, peu prises en compte) au sein de la société. Pourquoi pensez-vous qu’elles sont si peu mises en avant, et que devons-nous faire pour corriger cela ?
C’est là aussi une question de changement culturel. Nous sommes dans des automatismes qui veulent que s’il y a conflit, il conviendrait simplement de tenter (même si on sait que cela est vain) de déterminer celui qui a tort et celui qui a raison, ou celui qui mérite plus que l’autre. On se focalise sur le résultat qui nous semble juste sans se soucier du choix du processus pour y parvenir. Pour changer de logiciel culturel, il faudrait d’abord comprendre que notre tendance à nous affronter nous coûte beaucoup plus qu’elle ne nous rapporte. C’est encore une fois l’image de l’addiction et du sevrage. Certains adorent la confrontation et trouveront toujours un intérêt au conflit violent. Mais je pense que la majorité des gens aimeraient découvrir l’autonomie et la liberté qu’offrent les processus comme la médiation, c’est-à-dire un espace et un temps où il est possible de tout dire et où ce qui est dit aura toutes les chances d’être vraiment entendu. Un espace qui désamorce l’escalade, où les émotions sont bienvenues et où la reconnaissance dont chacun a besoin peut s’opérer. Aujourd’hui nombre d’institutions (par exemple les établissements scolaires) et de plus en plus d’organisations ont mis en place des programmes de médiation en leur sein. Il faut continuer ce travail d’éducation et de changement culturel en l’offrant au plus grand nombre. En fait, les compétences en médiation sont de plus en plus présentes, mais elles sont encore trop peu valorisées. Il faudrait insérer un peu plus cette valeur ajoutée dans l’économie réelle au lieu de la considérer comme un simple gadget sympathique. Comprendre que l’approche non violente des conflits est non seulement juste mais avantageuse collectivement. C’est une question de perception collective.
Entretien mené par Paul Tommasi.





