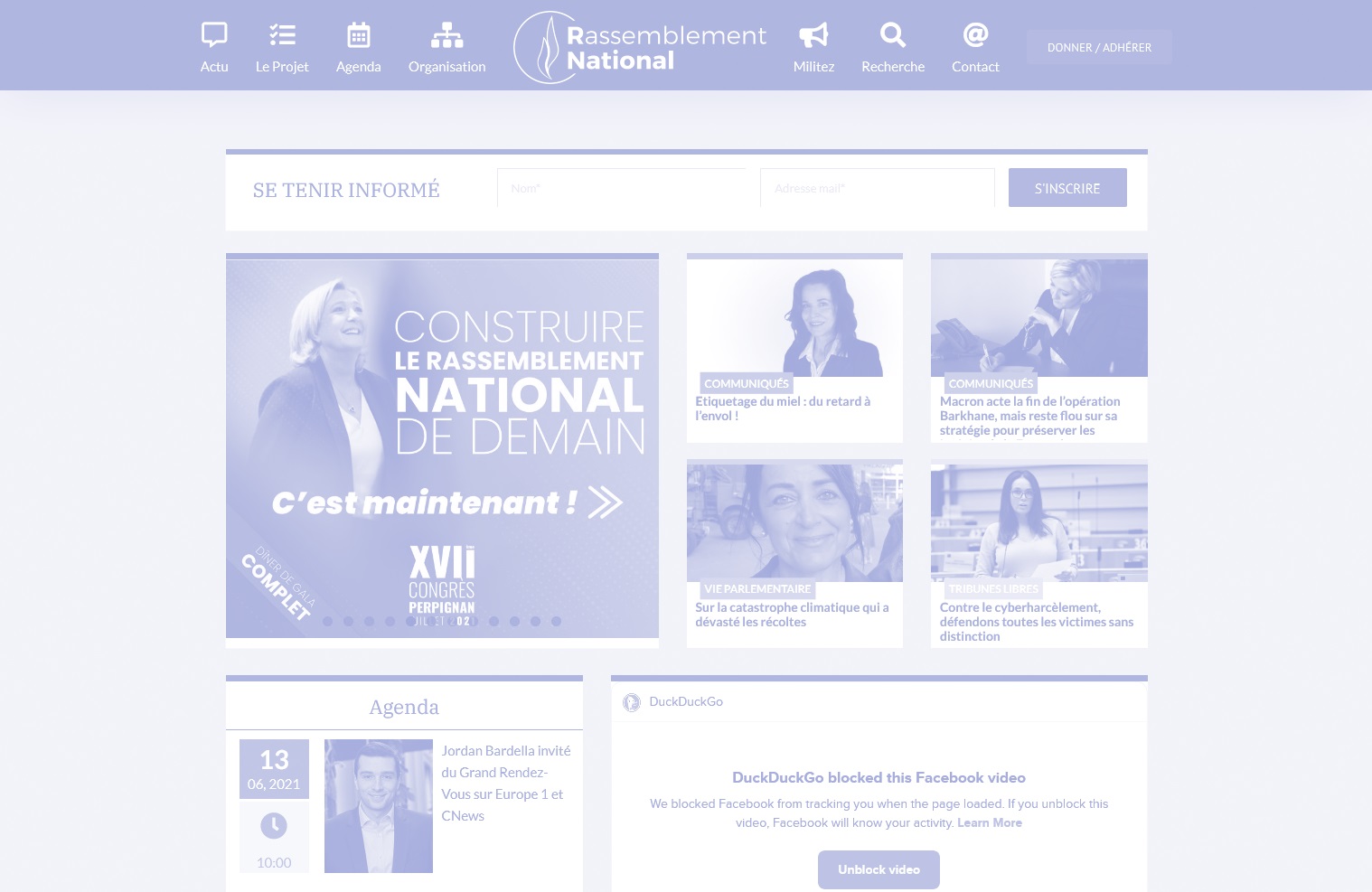« On m’a expliqué quelques fois que le studio pour lequel j’étais venu n’était plus à louer. Au début, j’y croyais. Puis, un jour, un collègue (blanc) a obtenu un studio trente minutes après qu’on m’ait dit qu’il n’était plus disponible. Je me suis alors rendu compte que beaucoup d’amis trouvaient des logements plus vite que moi, quand bien même leurs dossiers étaient moins bons que le mien » écrit Alexis D. sur dièses le 22 octobre dernier, en précisant qu’il est lui-même une personne noire.
Ainsi la couleur de la peau est-elle le motif, évidemment inavoué, du refus de louer. Cette différence d’accès n’est pas inscrite dans la loi, elle est même interdite par celle-ci. Cette pratique reste pourtant courante.
Mais comment prouver cette injustice et faire appliquer la loi ?
Prenons un autre exemple de discrimination : « Le 1er mars 2017, une classe de terminale du lycée Louise-Michel, à Épinay-sur-Seine, arrive à la gare du Nord après un séjour bruxellois. Leur voyage était consacré à la découverte des institutions européennes. À la sortie du train, trois lycéens, d’origine malienne, comorienne et marocaine, sont contrôlés par deux équipages de police devant leurs camarades de classe. Palpation, fouille des sacs, tutoiement, humiliation. Une « panoplie » classique des contrôles d’identité pour leur avocat Slim Ben Achour. »
Dans le cadre de cette nouvelle affaire, « c’est autour de la question de la preuve d’une éventuelle discrimination exercée par la police que l’audience s’est cristallisée », indique Slim Ben Achour, qui rappelle que le Défenseur des Droits estime que les jeunes hommes perçus comme noir ou arabe ont une probabilité vingt fois plus élevée d’être contrôlés que les autres.
Un constat d’autant plus alarmant que « l’État n’apporte aucun élément crédible, circonstancié, permettant de dire qu’il n’y a pas de discrimination », estime Slim Ben Achour pour qui ces contrôles révèlent « un racisme conscient ou inconscient ». D’un sanglot dans la voix, il conclut : « Ces jeunes sont venus me voir en me disant qu’ils voulaient changer le monde, en appliquant le droit. »
Nous avons donc à faire à des pratiques qui entrent dans un cadre légal (les contrôles d’identité par les forces de l’ordre) mais dont l’usage contrevient, dans certains cas, à certains principes fondamentaux de la République française. Malgré ce constat, prouver un acte raciste ou plus généralement discriminatoire reste compliqué.
Le droit à la parole
Mars 2016, je participe à une formation de professeur·es d’école maternelle sur l’apprentissage de la parole par les jeunes enfants. Nous regardons une vidéo réalisée par le Réseau Canopé, réseau de documentation pédagogique de l’Éducation Nationale. Il s’agit d’une professeure chevronnée qui apprend à ses élèves à bien s’exprimer : filles et garçons sont réuni·es autour d’elle et échangent à propos d’un bonhomme dont l’image est affichée au tableau et qu’il s’agit d’habiller avec pantalon, pull et bonnet de couleurs diverses ; certain·e·s des élèves viennent même près du tableau et s’expriment alors face à la classe. À l’issue de la diffusion de la vidéo, je fais remarquer que durant les huit minutes que dure cette séquence, aucune fille n’a parlé, alors qu’elles ont levé la main pour demander la parole. Certaines finissent par se balancer sur leur chaise. Les garçons (la plupart) ont ainsi pu exercer leur prise de parole, mais les filles ? Qu’ont-elles appris ? Le conseiller pédagogique responsable de la formation, aussi bien que les autres participant·es, réagit : « Mais que vas-tu chercher ? » Je lui réponds que je cherche l’égalité d’accès aux apprentissages, ainsi que le droit au respect et à la reconnaissance par les pairs et par l’adulte. On me rétorque que « ce n’est pas le sujet, [qu’] ici on réfléchit à comment apprendre à parler ». Mais les petites filles de cette classe, comme de l’immense majorité des autres classes d’école primaire, de collège, de lycée et même d’université1Voir par exemple Isabelle Collet, « Faire vite et surtout le faire savoir. Les interactions verbales en classe sous l’influence du genre », Revue Internationale d’Ethnographie, 2015, n° 4, p. 6-22. auront sans doute surtout retenu que leur parole a moins d’importance que celle des garçons et que, dans un conflit, les filles ne doivent pas tenter de défendre leur point de vue ou leur intérêt, car ce faisant elles s’exposeraient à la violence, alors que les garçons eux apprennent l’inverse, qu’il faut s’imposer en usant de la force – les deux connaissent donc la même confusion entre conflit et violence. Cette discrimination d’apparence anodine pour la plupart des professeur·es a des conséquences importantes pour notre société et ses membres2Annie Léchenet, « Egalité, liberté, citoyenneté : former les enseignant-e-s à l’égalité des filles et des garçons », in Léchenet, Baurens & Collet, Former à l’égalité, défi pour une mixité véritable, L’Harmattan, 2016, p. 16-27..
Ces trois exemples illustrent ce que sont les inégalités d’accès à des droits.
Notre société souscrit à un idéal d’égalité, mais elle n’en est pas moins organisée par des inégalités réelles. Si certaines de ces inégalités sont pensées comme légitimes, du moins dans certaines limites, comme par exemple certaines inégalités économiques, il est des inégalités que nous avons du mal à justifier. Il s’agit de celles qui concernent ces aspects de la vie qui sont vécus ou reconnus dans la loi ou dans le discours de notre société sur elle-même comme des droits, auxquels tous et toutes devraient avoir également accès, et qui pourtant donnent lieu à de multiples inégalités, lorsqu’il s’agit par exemple de chercher un logement ou un emploi, de revendiquer une rémunération, mais aussi d’avoir la parole dans une assemblée, d’être entendu·e dans une conversation, de déposer une plainte dans un commissariat, et même de circuler sereinement dans l’espace public. Il s’agit bien d’inégalités d’accès, celles que nous nommons souvent inégalités des chances : nous ne souhaitons pas vraiment avoir tou·te·s le même logement, mais, puisque la loi oblige un bailleur à ne tenir aucun compte du sexe, de la couleur de la peau ou de la langue parlée par celui ou celle qui répond à son annonce pour choisir à qui il louera son appartement, nous espérons que chacun et chacune a la même « chance », au sens d’opportunité, que son dossier soit examiné selon les seuls critères en rapport avec les qualités attendues d’un locataire : solvabilité, tranquillité. Dans le cas contraire, cette différence de traitement est à dénoncer comme une discrimination, interdite par la loi française3« En droit, une discrimination est un traitement défavorable qui doit généralement remplir deux conditions cumulatives : être fondé sur un critère défini par la loi (sexe, âge, handicap…) ET relever d’une situation visée par la loi (accès à un emploi, un service, un logement…). À ce jour, la loi reconnait plus de 25 critères de discrimination. Ainsi, défavoriser une personne en raison de ses origines, son sexe, son âge, son handicap, ses opinions… est interdit par la loi et les conventions internationales auxquelles adhère la France. » (site du Défenseur des droits, consulté le 6 octobre 2020).
Pour lutter contre une discrimination particulière au plan juridique, il faut pouvoir la prouver. Au plan scientifique, il faut établir et démontrer son existence en général. Dans tous les cas, puisqu’il s’agit d’inégalités d’accès, leur réalité objective est difficile à établir.
Prouver les discriminations
Parfois cependant, il « suffit » de compter, par exemple pour le nombre de prises de parole des filles et des garçons dans une classe de maternelle ou de lycée, qui s’avère la plupart du temps très inégalitaire. Le ou la professeur·e pour prouver à quel point il ou elle est profondément convaincu·e de l’égalité des filles et des garçons, déclare ne même pas observer si il ou elle s’adresse à des filles ou des garçons, les traitant à égalité puisqu’« ils sont tous des élèves ». Lorsque l’observatrice lui présente les chiffres, qu’elle a notés, de la répartition effective de la parole, le ou la professeur·e est stupéfait·e. Peut-être alors parviendra-t-il (ou parviendra-t-elle) à corriger cette inégalité, à force de volontarisme et d’attention à sa pratique, mais, et c’est là l’essentiel, cela n’arrivera que lorsqu’il ou elle aura pris conscience de sa pratique inégalitaire. On peut donc penser qu’il s’agit là de discriminations mises en œuvre de manière non consciente, et qui n’étaient donc jusque-là pas perçues. Certes, elles sont en réalité fondées sur des stéréotypes, qui plus est tellement partagés dans la société qu’ils font quasiment l’objet d’un consensus, mais leur collision avec les valeurs et les idéaux consciemment professés par celles et ceux qui les mettent en œuvre permet, une fois qu’elles sont dévoilées, de lutter de bonne foi contre elles.
Pour les plus connues des discriminations à l’heure actuelle, la sociologie doit user non pas tant de mesures directes que de méthodes indirectes. La simple méthode objective du comptage présente de difficiles obstacles, qui tiennent à la difficulté d’isoler la variable que l’on soupçonne être un motif de discrimination. Si l’on constate un plus faible nombre de personnes ayant un nom à consonance maghrébine dans des logements de quartiers aisés (ce qu’en France on ne peut pas faire étant donné l’interdiction relative des statistiques « ethniques », ce qui n’est pas l’objet de la présente discussion), comment établir que ces personnes ont été discriminées par leur nom dans l’examen de leurs demandes ? Il faudrait savoir si elles ont fait des demandes dans une proportion correspondant à leur nombre dans la société, et si leur plus faible présence ne s’explique pas par le plus faible revenu de nombre de ces personnes (mais pourquoi ont-elles un plus faible revenu ?). On use donc de méthodes d’observation indirectes, comme des campagnes de testing, qui consistent à présenter deux dossiers semblables en tout point, sauf celui à l’égard duquel on soupçonne une discrimination (consonance du nom, lieu d’habitation, sexe, etc.).
Mais parfois il semble que l’on parvienne par un comptage, certes sophistiqué et rigoureux, à isoler la variable discriminante – cette mise en évidence nous amène alors au cœur du problème de la compréhension des discriminations. Par exemple, si l’on compare les rémunérations des femmes et des hommes, que ce soit dans une entreprise ou à l’échelle de la société globale, on voit bien que l’écart est considérable, variant de 23,7% (masse des rémunérations perçues en un an par les femmes et par les hommes) à 9% (lorsque l’on cherche à mesurer ces rémunérations « à travail égal et à compétence égale »), en passant par le chiffre intermédiaire de 18,4% (qui mesure cette fois l’ensemble des rémunérations des contrats à temps plein). C’est le second chiffre qui semble isoler la part de discrimination pure dans l’inégalité des rémunérations, une fois qu’on a estimé que les femmes et les hommes travaillent également et avec des compétences égales. On peut certes se demander comment caractériser un travail égal et une compétence égale, lorsqu’on sait par ailleurs combien les tâches et surtout les compétences dites féminines sont peu reconnues et peu estimées dans notre société. Mais à supposer que cette estimation soit rigoureuse et exacte, alors la discrimination déploie son énigme : si le travail et les compétences sont égaux, pourquoi cette inégalité dans les rémunérations ? Comment est-elle justifiée ? Enquête après enquête elle est connue précisément, mais ne disparaît pas. Faut-il l’expliquer par des raisons objectives, les mécanismes aveugles de la « loi d’airain des salaires » défavorisant spécifiquement les femmes, car il faut bien, pour plus de profit, des secteurs de la main d’œuvre qui soient moins payés – et la culture environnante fournit pour cela une cible évidente : les femmes forment un groupe qui semble naturel et naturellement plus faible, et donc « digne » d’être moins payé4Voir Silvia Federici, « Le Capital et le genre », in Le capitalisme patriarcal, La fabrique, 2019, p. 27-61. ? Ou doit-on plutôt y voir l’influence de l’idéologie sexiste banale de notre société et des préjugés qui mésestiment les femmes sur les décisions des sujets ? Voire la faible capacité revendicatrice des femmes elles-mêmes, qui auraient intériorisé la faible estime d’elles-mêmes qui conduit à leur traitement discriminé ? Peut-être tous ces facteurs à la fois ? De la part de ceux qui la pratiquent la discrimination est-elle consciente, c’est-à-dire délibérée, et plus ou moins dissimulée explicitement5Ce qui ne peut s’exprimer ouvertement dans l’espace public se déploie librement dans des groupes « privés », par exemple sur les réseaux sociaux. ? Ou bien est-elle pratiquée de manière peu consciente, et de manière totalement méconnue, par ses auteurs ?
Un paradoxe
Un paradoxe me semble se nouer ici : les discriminations non conscientes semblent en un sens les plus redoutables, puisqu’elles sont basées sur des préjugés très intériorisés, partagés et banalisés, mais elles sont peut-être plus faciles à combattre que les discriminations conscientes seulement dissimulées dans des dénis qui ne trompent guère.
Les discriminations que l’on peut qualifier de conscientes sont relativement connues dans notre société : elles reposent sur le racisme, le sexisme, l’homophobie et diverses autres « phobies » (bien mal nommées car il s’agit plutôt de haines). Elles sont traquées, dénoncées, celles et ceux qui les pratiquent savent qu’elles sont illégitimes et donc les dissimulent, le plus souvent par le déni. Mais comment pourraient-ils et elles changer d’opinion, renoncer à leurs haines ? Les arguments rationnels sont peu opérants sur des sentiments, d’autant plus que ceux-ci sont cultivés dans des groupes d’appartenance. Les expériences de la vie elles-mêmes semblent être soigneusement cloisonnées pour ne pas mettre en cause les opinions et sentiments identificateurs. Tel·le raciste « a des amis arabes », tel·le homophobe « s’entend très bien avec des collègues homosexuel·les ». La seule réponse demeure la loi, et la mise en évidence des comportements illégaux.
Les discriminations pratiquées de manière non consciente sont peut-être, d’une part, plus répandues et, d’autre part, plus insidieuses. Reposant sur des stéréotypes et des préjugés si répandus qu’ils sont banalisés, elles ne sont pas perçues comme des discriminations, et elles ne sont même parfois pas perçues du tout. Leur signification excluante n’est pas comprise par leurs auteurs, ni même toujours par leurs victimes. Elles se déploient donc de manière quasi universelle et banale, tandis que leurs effets opèrent bel et bien. Leur mise au jour et le dévoilement de leurs significations, tout ceci par des actes de connaissance de type scientifique, se heurtent parfois à des résistances, qui prennent la forme de déni ou de disqualification de la connaissance scientifique. Mais ces mises au jour peuvent aussi être vécues, individuellement ou collectivement, comme de véritables révélations de dysfonctionnements en décalage avec les valeurs et les idéaux professés, et ainsi donner lieu à des corrections tout à fait réelles et probantes.
Changer le monde, et appliquer le droit
Il demeure que nous devons lutter contre tous ces types de discriminations, par des efforts de connaissance, de compréhension, pour appuyer nos refus – sans doute de manière différente selon que l’on s’adresse à des auteurs conscients (ou non) de leurs préjugés.
Liberté, égalité, fraternité : ne critiquons pas dans l’absolu ces mots, qui sont bien pour nous des idéaux, c’est-à-dire des objectifs que nous ne pouvons pas ne pas souhaiter atteindre – imaginez un monde qui les rejetterait au prétexte qu’ils ne sont pas mis en œuvre de façon satisfaisante. Ce serait le retour à l’inégalité de principe, par exemple entre celles et ceux qui naissent roturiers ou nobles, bien doté·es ou dépourvu·es de privilèges. C’est donc à la réalisation de ces idéaux que nous devons aspirer et travailler. Ainsi les lycéen·ne·s d’Épinay-sur-Seine s’adressent à un avocat en lui disant qu’ils « veulent changer le monde, en appliquant le droit ». Et Alexis D. conclut ainsi son témoignage : « En fin de compte, au quotidien, je suis surtout vu comme un noir. Alors qu’une personne blanche, elle, est d’abord vue comme une personne. On voit l’être humain, et non sa couleur de peau. J’espère un jour pouvoir vivre la même chose en France. Les principes universalistes sont les miens, et je rêve de les voir être respectés. »
Annie Léchenet est philosophe. Elle a notamment codirigé l’ouvrage Former à l’égalité : défi pour une mixité véritable (L’Harmattan, 2016).
 Les discriminations – comme les
Les discriminations – comme les