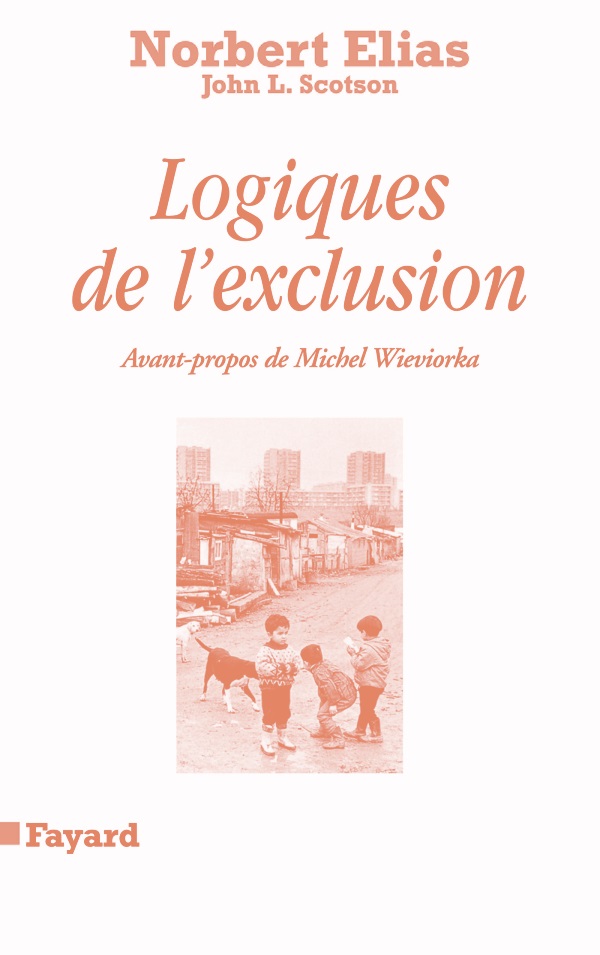
L’ouvrage de Norbert Elias et John L. Scotson, Logiques de l’exclusion, originellement paru en 1965 sous son titre anglais, The Established and the Outsiders, et traduit en français en 1997 (d’où le terme « exclusion », très en vogue à cette époque de visibilité des SDF qui donnera la loi contre les exclusions en 1998), est devenu un classique des sciences sociales. Cela tient certes à la notoriété internationale d’Elias, mais aussi à la singularité de l’œuvre. En effet, alors que tout porte à croire que les intérêts de classe conduisent les ouvriers à se mobiliser contre leurs ennemis « naturels », soit les patrons (voire les cadres), cette recherche menée à l’Université de Leicester et réalisée dans une banlieue anonymisée, Winston Parva, vient contredire, en apparence, une vision classique en termes d’antagonismes de classe. L’enquête révèle en effet des divisions internes dans le monde ouvrier. Ce qui est aujourd’hui relativement balisé n’était, à l’époque, presque jamais envisagé. Souvenons-nous des cultural studies anglaises, de Richard Hoggart décrivant un monde ouvrier opposé aux autres et à sa fameuse distinction entre les « nous » et les « eux ». Pensons à Paul Willis et aux jeunes déscolarisés dénonçant les « fayots » à l’école, pris entre la petite délinquance et l’entrée inévitable dans l’usine. Le destin ouvrier, tel qu’il a été documenté par des chercheurs aussi différents que Michel Verret ou Gérard Mauger, en passant par toute la sociologie française du travail ouvrier, s’est accompli jusqu’aux années 1970 dans la notion de reproduction des classes et d’oppositions entre les dominants et les dominés. Toute la tradition marxiste du mouvement ouvrier et du front de classe a imprégné une science sociale centrée sur le conflit en entreprise. Ce n’est pas le cas de cette étude, qui fait intervenir un autre paradigme : celui de la disqualification, autrement dit du racisme de classe, de la dépendance au groupe de référence, des valeurs et des goûts classés. Cette sociologie du classement, que l’on ne pouvait pas trouver dans l’École de Chicago – bien trop centrée sur les déclassés repliés sur leur monde, à commencer par les migrants dans toutes leurs déclinaisons ethniques (Polonais, Italiens, Allemands, anciens esclaves Noirs), les déviants, les hobos, les délinquants, les danseuses/prostituées des taxi dance halls –, est donc inaugurée par N. Elias et J.L Scotson.
Le rejet des nouveaux arrivants
À cette question insolite des haines de classe entre ouvriers, les auteurs répondent par un postulat a priori simple : les ouvriers plus anciennement arrivés rejettent les nouveaux arrivants (p.31). Le facteur le plus discriminant est selon eux la forte cohésion des premiers en « communauté », un terme typique du monde culturel anglosaxon qui n’a aucun équivalent en France, sauf sur le plan politique, au travers d’une dénonciation du communautarisme. Alors que chez les Britanniques, le terme est hautement valorisé et exemplifie les groupes nationaux, il désigne, en France, un repli sur soi dangereux des groupes étrangers.
Pourquoi cette communauté est-elle donc fermée au point de stigmatiser les « nouveaux » arrivants ? L’explication des chercheurs semble tautologique : cette communauté reposerait sur une forte cohésion interne. Pourtant, la démonstration est remarquablement menée. À la façon d’un zoom de réalisateur, les enquêteurs présentent l’histoire sociale des quartiers de Winston Parva, en montrant pas à pas que la zone 2 comprend les anciens et la zone 3, sur un autre territoire connexe, toutes sortes de populations « immigrées » : des ouvriers londoniens ayant fui les bombardements de la guerre, des ouvriers provenant en fait de plusieurs régions du Royaume Uni. Les deux chercheurs montrent ensuite des liens très forts unissant les familles installées dans la zone 2 depuis plus de 80 ans. La focale s’accentue sur la vie locale en montrant le lien étroit entre ces vieilles familles et le tissu associatif qui draine les forces vives de la zone 2. Les chercheurs progressent alors en affinant la notion de classement et en étudiant le rôle que jouent les dénonciations (ragots, potins) dans la réaffirmation des valeurs conservatrices du groupe légitime. Finalement, en analysant les propriétés de la zone 3, ils donnent à voir un aspect central de leur recherche : la disqualification affecte d’autant plus les membres de la zone 3 que celle-ci intègre en son sein une frange marginale hautement visible : les jeunes déviants, au sens d’H. Becker (Outsiders), c’est-à-dire au sens d’une construction sociale externe finalement politique (car le point de vue politique dominant de la zone 2 associe la résistance de l’infra-politique à la déviance pure et simple) sont perçus comme le reflet d’un groupe de familles qui ne tiennent pas leurs enfants. De ce fait, le discrédit jeté sur une minorité des membres de la zone 3 rejaillit sur l’ensemble de la population, alors même que dans sa grande majorité, celle-ci est travailleuse et disciplinée (p. 34). Telle est la loi sociologique que l’on peut facilement utiliser comme modèle pour penser la relégation les Noirs aux États-Unis à « l’underclass », catégorie déconstruite par Herbert Ganz dans The War Against The Poor ; pour penser les SDF qualifiés de « mauvais pauvres », comme toute l’historiographie l’a restitué pour l’Europe ; pour penser aussi les Gens du voyage, Tsiganes et/ou Roms marqués du sceau de l’infâmie. Comme le résument les deux chercheurs : « Un groupe installé a tendance à attribuer à son groupe intrus, dans sa totalité, les « mauvaises » caractéristiques de ses « pires » éléments, de sa minorité anomique » (p. 34).
Des ouvriers attachés aux normes sociales conservatrices de la bourgeoise locale
Les deux chercheurs sont pourtant bien loin d’avoir divulgué tout leur savoir-faire sociologique. Alors même qu’ils prétendent se concentrer sur les deux groupes ouvriers, la zone 2 et la zone 3, ils donnent à voir le conflit de classe. Non pas sous ses formes les plus connues que sont la grève, la confrontation dans la rue, l’action syndicale ou encore les revendications militantes, mais sous sa forme la plus routinière, encastrée dans les rapports sociaux qui « vont de soi ». L’ambivalence du monde ouvrier, c’est de faire naître sa progéniture dans un monde qu’il fait sien et, en même temps, de vivre l’exploitation, source de souffrances et, par là, d’une prise de conscience que quelque chose ne va pas, que le sens commun se heurte à l’existence de manques. Dans cette tension entre adhésion et défection, trois chemins sont envisageables pour améliorer sa position : jouer le jeu et tenter de « progresser » ; contester et rompre avec l’ordre établi ; enfin partir (migration, déviance, mercenaire)1Ces stratégies recoupent les options Loyaulty, Voice et Exit définies par l’économiste Albert Hirschman.. Loin des luttes de classe frontales, on a affaire ici à des luttes de classement en toute loyauté ; des luttes de stratification, des luttes de mouvements, comme si le monde social était une échelle à gravir en donnant des coups de pied à celui d’en dessous tandis qu’on tend la main à celui du dessus. Tout l’ouvrage nous montre la respectabilité des ouvriers de la zone 2 qui se « tiennent », fermement accrochés au gouvernail de la communauté, tout en rejetant les concurrents potentiels relégués dans la cale. Sans utiliser le mot, et encore moins s’en rendre compte, les auteurs montrent pourtant très clairement une dépendance des ouvriers aux normes sociales conservatrices contrôlées par la zone 1, les membres locaux de la bourgeoisie, entrepreneurs industriels et professions libérales. Alors qu’Elias défend avec ardeur l’analyse monographique d’une configuration communautaire (p. 31 et suivantes), il détaille en fait l’emprise « quasi-féodale de dépendance » (p. 144) des dominants de la zone 1 sur les ouvriers de la zone 2 : toutes les familles « anciennes » sont reliées par un tissu inextricable d’associations très investies (fanfare, club des anciens, aides philanthropiques et caritatives, clubs de sport) chevillées à la nébuleuse anglicane (p. 129) contrôlée par les puissants de la zone 1, dont le fameux Drew, élu sans étiquette mais représentant en fait les conservateurs. En hésitant ainsi entre l’analyse « raciale » des ouvriers rejetant les « autres » – au point de créer une segmentation radicale entre les pubs – et l’analyse globale des classes, les auteurs brouillent un peu les pistes. Quand, dans l’introduction, ils abordent les dimensions centrales de la « cohésion », ils insistent d’abord sur une perspective en termes de configuration locale : « la forte cohésion des familles » (p. 31) matérialisée par la mainmise sur les « postes clés des organisations locales – conseil, église, club – aux gens de leur espèce » a pour effet « l’exclusion et la stigmatisation des intrus » pour « affirmer sa supériorité ». Ce point de vue, que l’on dirait aujourd’hui culturaliste, proche des analyses « écologiques » de l’École de Chicago, est posé d’emblée comme le cadrage théorique fondamental alors que tout l’ouvrage détaille de façon magistrale le jeu « vertical » d’admiration envers les groupes de référence, « respect » qui emprisonne la classe ouvrière de la zone 2 dans les mains des
dominants de la zone 1, la zone 3 des « immigrants » étant rejetée par les deux premières. Le plus sublime dans cette démonstration n’est en effet pas tant le travail scientifique révélant les dégoûts des ouvriers intégrés envers les « cockneys » et les « grands mal-lavés » (p. 43) – ragots sur le « trou à rats » (p. 87), rejets dans les pubs, contrôle des postes dans les associations, stigmatisation puissante des jeunes délinquants – que la chaine des dépendances (plus que la chaine des interdépendances, n’en déplaise à Elias) qui se joue à tous les niveaux. En effet, plus qu’une étude de la division du travail (et donc de l’interdépendance), c’est un tableau de la collaboration de classe qui est décrit, sous l’appellation « village ».
L’existence d’une « aristocratie ouvrière »
Tout d’abord, au conflit de classe, se substitue un respect global de la hiérarchie : « Tout le monde reconnaissait la supériorité de la zone 1 » (p. 102).
Sur le plan territorial, une « aristocratie ouvrière » est implantée dans la zone 1 (p. 77, 86) et dans la zone 2, sorte de groupe tampon entre le quartier des puissants et les ouvriers moins qualifiés ou moins riches de la zone 2. « Certaines familles avaient donc des ramifications à la fois dans les zones 1 et 2, les premières formant une sorte de « haute société » pour le « village » comme pour Winston Parva dans son ensemble » (p. 86). Les habitants sont fiers de ceux qui ont réussi, et aspirent à devenir comme eux (p. 108-109).
Outre l’aristocratie ouvrière, il y a aussi une porosité entre la zone 1 et la zone 2 du fait de la présence de familles bourgeoises dans les « meilleures rues » de la zone 2 (p. 77). Les auteurs précisent que « dans les meilleures rues de la zone 2 (au nord) habitaient quelques familles qui relevaient de la classe II (positions de classe moyenne). Le nombre d’habitants bourgeois était réduit. Mais en tant que facteur de la configuration qui donnait aux deux rues une position supérieure, cette minorité de voisins plus haut placés jouait certainement un rôle hors de proportion avec son importance numérique : il était presque invariablement question d’eux dans les entretiens » (p. 111). Dans la logique du groupe de référence, « la minorité de la zone 2 était mentionnée par les résidents, toujours avec une évidente fierté » (p. 77).
On voit poindre, derrière les grands postulats de départ, une brèche qui nous conduit vers cette autre problématique : « Il fallait avoir quelque lumière sur la naissance de cette relation (de rejet entre 2 et 3) pour comprendre comment on en était arrivé là : comment les habitants de la zone 2 pouvaient revendiquer un statut plus élevé que celui des habitants de la zone 3 tout en reconnaissant un statut supérieur à la plupart des résidents de la zone 12Souligné par l’auteur de l’article.. À défaut d’éclairer et d’expliquer cet ordre hiérarchique, il manquait la clé pour comprendre d’autres aspects de la vie collective » (p. 89). On le discerne nettement : les deux chercheurs ont parfaitement conscience que le cadrage est plus général qu’il n’y parait et que le rejet entre anciens et nouveaux ouvriers n’est qu’une première marche dans un système explicatif plus global. Elias ne retient pourtant que cette dimension culturaliste dans son introduction, alors que l’analyse monographique s’appuie vraiment sur une analyse structurale de la lutte des classements à la sauce « communautaire » anglaise. Car il ne faut pas oublier que le système social anglais, localiste et communautaire est très différent du modèle français, aussi bien du point de vue des élites que de la structuration des syndicats et des partis. Comment comprendre ce « bug » dérivant de la séparation entre les deux points de vue ?
Un continuum des logiques de l’exclusion ?
Elias, entrainant avec lui son collègue, est obnubilé par les dimensions symboliques des configurations. C’est ce qu’il appelle les fantasmes collectifs (p. 51). D’un côté, le groupe légitime ne cesse de se louer et de louer ceux du dessus. De l’autre, il façonne le stigmate sur l’inférieur qui l’intériorise (Elias parle d’aliénation et de réification p. 51) ou tente de le neutraliser (p. 36, 159). On retrouve là tout le poids du déterminisme individuel sur le rapport à la science. Le chercheur allemand, un intellectuel juif ayant fui le nazisme, passera sa vie à étudier les délires de grandeurs, ce qui signifie aussi les disgrâces des inférieurs. Dans l’introduction théorique de l’ouvrage, il se laisse aller à son anthropologie des groupes humains, voyageant à travers le monde (il s’abreuve à l’histoire antique, à l’Inde, au Japon), dépeçant les fascismes culturels qui se nichent dans leurs prétentions à la supériorité sur les autres, au point de les démolir symboliquement ou de les annihiler physiquement. Qu’il nous parle du « rêve américain », du « rêve russe » ou du « rêve du troisième Reich » (p. 53), on est bien loin de la sociologie de la communauté anglaise : « Au faîte de leur puissance, les groupes dirigeants des nations, des classes sociales ou d’autres ensembles d’êtres humains, cultivent des idées de grandeur » (p. 63). « Un idéal du nous excessivement développé est un symptôme de maladie collective » (p. 62). Elias voit dans le fonctionnement de la zone 2, dans cette petite communauté en apparence tranquille, le spectre du racisme, face inversée des fantasmes de grandeur qui portent en eux la maladie de la déshumanisation de l’autre. Derrière l’exclusion ou la stigmatisation visible à Winston Parva, il y a la conviction personnelle d’assister, en micro, à la répétition du scénario qui l’a conduit à devoir fuir l’Allemagne, persécuté par la démence politique d’un Hitler suivi par des millions d’Allemands3Sur sa théorie des rêves d’immortalité collective, lire The Germans et La solitude des mourants.. Qu’elle soit petite ou grande, l’attribution de la souillure et de l’impureté est un fait général de tous les groupes sociaux, avec des intensités variables. Les fausses coupures entre démocratie et totalitarisme, dualismes pourtant chers à tant d’intellectuels (dont Hannah Arendt ou Raymond Aron, sans parler de la culture des universitaires en science politique) sont ici particulièrement bien déconstruites. Elias ouvre la voie à une sociologie d’un continuum des logiques de l’exclusion. Ce qui frappe l’esprit du chercheur allemand, c’est que le système de rejet en fonctionnement à Winston Parva ne repose sur presque rien. Les ouvriers de la zone 3 n’ont rien fait, si l’on met à part les dérèglements de leurs rejetons, lanceurs d’alerte involontaires de l’anomie (terme d’Elias) des jeunesses occidentales populaires ou, si l’on veut, de l’espace des possibles entre déviance et résistance. Mais leurs parents travaillent comme les autres, veulent se distraire comme les autres, vivent grosso modo comme les autres. Et que font leurs enfants ? Du chahut aux abords du cinéma, quelques déprédations sur les voitures, des bagarres dans les bals. La bourgeoisie locale devrait être rassurée : la grève générale est bien loin, de même que les attaques de banques ou les atteintes aux propriétés privées. Et pourtant, la zone 3 est diabolisée. La moindre incartade est relatée dans la presse locale et fait les choux gras des potineurs. La logique du classement social dérivé en zone grise est alors implacable : la violence symbolique se déchaine, et l’autre devient une cible permanente.
Soumission ou rébellion ?
Dans ce registre de la collaboration, les auteurs sentent bien les homologies entre les différentes situations. En attendant un meilleur sort, les ouvriers anglais de la zone 2 vivent une « gloire par procuration » (p. 101) et jouissent des « gratifications » associées au respect qui rejaillit sur eux toutes les fois où la norme est respectée. Cette situation mène à une épuration sociale dans les pubs (interdiction de fréquenter les mal-lavés), dans les associations (exclusion, ou relégation hors des postes à responsabilité), mais aussi dans les mots (disgrâce et infamie de la zone 3).
Voilà pourquoi Elias délaisse l’analyse des structures du classement social, laquelle devait le conduire à embrasser d’un seul tenant les trois termes du fonctionnement local, et poser à la fois la force du groupe de référence (zone 1) et la force du groupe repoussoir (zone 3). Ce qui le travaille, c’est de fouiller les déclinaisons du mépris, lesquelles mettent en scène essentiellement les zones 2 et 3. Il marginalise en théorie le poids structural incontournable de la zone 1 tout en développant avec brio les effets traversant du légitimisme : les figures patriciennes locales, les vieilles familles, les institutions du village, les admirations de référence, l’acharnement à l’entre-soi. Ce légitimisme est en effet la face positive indissociablement cadenassée à sa face négative, à savoir le travail systématique de décrédibilisation des nouveaux venus « parqués » dans la zone 3.
En marginalisant le jeu de fidélisation entre la zone 1 et 2, entre les notables locaux et les ouvriers traditionnels, via notamment l’aristocratie ouvrière des vieilles familles, et en se polarisant uniquement sur les mécanismes de la dénonciation, en ayant en tête sa quête de compréhension du racisme, Elias manque en fait tout l’intérêt en soi des mécanismes d’alliance entre les established – autrement dit, du déploiement du capital symbolique à l’échelle locale. Il aurait pu pourtant, là encore, généraliser. Car, en y regardant de près, la sociologie de l’adhésion aux valeurs dominantes peut être reliée à l’anthropologie des « collaborations », c’est-à-dire des affiliations « contre-nature ».
Le couple intégration des « nous » et rejet des « eux » – sur le modèle cher à Richard Hoggart – n’est pas uniquement la résultante de la vie au village. On le voit, les ouvriers doivent se soumettre aux valeurs de leurs patriciens, en jouissant de deux avantages : la participation aux organes du « village », avec l’effet de grandeur associé au fait de côtoyer les membres de la zone 1 ; et le droit de rêver d’une meilleure condition, en louant ceux qui ont réussi et en se persuadant d’avoir une meilleure situation que les relégués. Ce double mouvement de « collaboration » n’est pas pensé comme tel par les deux chercheurs. S’ils identifient la posture du « traître » allant s’encanailler avec les plus désaffiliés de la zone 3 – ce qui est d’ailleurs rarissime –, ils ne parviennent pas à voir que leur propre public est catégorisable sociologiquement sous la même appellation de traître, ou, dans les termes de Primo Lévi, théorisés dans Les naufragés et les rescapés, de « zone grise ». Les Kapos des camps étaient des déportés œuvrant pour les nazis. Les « jaunes » sont des ouvriers qui cassent les grèves. Les commandeurs étaient des esclaves travaillant pour les planteurs, frappant les travailleurs et pourchassant les fugitifs (les « marrons »). Les légionnaires sont souvent des anciens délinquants d’origine populaire partis travailler pour l’État, souvent en réprimant les peuples colonisés. L’origine paysanne ou ouvrière des agents des forces de l’ordre éclaire cette réflexion dans le domaine de la répression. La question pourrait être la suivante : dans la tension précédemment évoquée dans la condition « populaire », qu’est-ce qui active la soumission zélée à l’ordre dominant contre « les frères de misère »4C’est l’objet central de l’ouvrage de K. Marx, Le 18 brumaire de Napoléon Bonaparte. ou, à l’inverse, explique la rébellion d’un Spartacus, et de tant de dominés de par le monde ? Dans la monographie faite à Winston Parva, la collusion de la zone 2 avec la zone 1 est tellement accentuée, pour un Français choqué par un tel communautarisme entre « villageois », que l’on est en droit de se poser la question. Simple mécanisme du « cela va de soi » dans un monde industriel traditionnel en disparition comme disent les auteurs, ou constitution d’une zone grise ?
Des logiques mortifères
Cette situation est-elle liée à une sorte de barbarisation sociale ? Les auteurs voient bien que cette population vit dans les conditions féodales de la pré-industrialisation, sans en déduire le principe de leur conduite. Bien plus qu’un rejet dual des « nouveaux », il s’agit d’une adhésion triale au monde social où se joue en fait dans un même mouvement, la soumission zélée aux ordres traditionnels et l’obligation plus ou moins consciente de mettre à distance les derniers arrivés. De fait, se découvre une triangulation typique des zones grises, des formes de collaboration en situation autoritaire. Et quand les chercheurs avancent que les statuts sont identiques en usine, en dehors de toute étude interne dans les entreprises, alors même que le système du closed shop (contrôle partiel de l’embauche par les syndicats ouvriers eux-mêmes, puisque le patron ne peut qu’embaucher des ouvriers syndiqués, donc des ouvriers de la zone 2) fonctionne à plein en cette période, ils ne peuvent produire les données qui soutiendraient leur postulat de l’homogénéité des deux groupes d’ouvriers. Or, tout porte à croire que les plus anciens ont des postes dominants dans les syndicats, dans les places les plus confortables de l’usine. D’ailleurs, on l’apprend incidemment, seuls les ouvriers de la zone 3 travaillent dans les usines les plus pénibles de la région, où les conditions de travail sont les plus drastiques. De la même façon qu’Elliot Liebow (Tallys’Corner) ou Elijah Anderson (A Place on the Corner) ont montré que les ouvriers afro-américains venus du Sud, quoiqu’affranchis, se sont vus octroyer les pires travaux manuels, les meilleures places étant réservées aux ouvriers blancs, les chercheurs britanniques auraient sans doute observé, dans les usines de Winston Parva toutes situées d’ailleurs dans la zone 2, une très sélective distribution des postes en fonction des allégeances et des reconnaissances locales. Ce qui est clairement identifié pour le quartier – les mères de la zone 2 négociant avec le bailleur la possibilité d’obtenir un logement proche de chez elles pour leurs filles mariées – aurait pu l’être pour l’usine.
Toutes ces remarques ne sauraient remettre en cause le travail entrepris, le but étant plutôt de s’y adosser pour aller de l’avant et combler certaines lacunes. C’est le travail nécessaire de la controverse, et c’est faire œuvre de science, que d’apprécier une recherche, de la recontextualiser, tout en y apportant des touches supplémentaires garanties par un champ scientifique en devenir. Elias a eu raison d’ouvrir le chantier des grandeurs car désormais son concept se place aux côtés d’autres notions voisines (capital symbolique, légitimité, statut, idéologie, etc.). De même, en défrichant une zone presque invisible de racisme, il est devenu un pilier des études sur la stigmatisation, la disqualification, l’étiquetage, la dénonciation, le racisme. Il reste que bien peu de chercheurs ont suivi son paradigme précis, celui des fantasmes transcendantaux, sortes de maladie des cultures qui apparaissent en période de crise. Car, encore un paradoxe, pris par la beauté de La dynamique de l’Occident, les chercheurs l’ont surtout utilisé pour penser la civilisation occidentale, les mécanismes de la pacification, des interdépendances et de l’autocontrainte alors que, dans le même temps, et sans pouvoir articuler les deux modèles théoriques, Elias se penchait sur les dérives des régimes pacifiés, notamment ce qu’il appelle la « Kultur » allemande. Que ce soit dans La solitude des mourants ou The Germans, le brillant intellectuel a pris le contrepied de ce qui l’a rendu célèbre, en développant une théorie extrêmement originale relative aux logiques mortifères qui poussent certains groupes, dans certaines conditions historiques – et l’on sait à quel point pour lui toute sociologie est de part en part historique – à devenir des prédateurs et des exterminateurs en se prétendant souverainement purs et authentiquement supérieurs à tous les autres. Thème qui, dans le contexte actuel, avec le Poutine des grandeurs russes et des massacres des infâmes « nazis » ukrainiens, est d’une actualité brûlante.
Patrick Bruneteaux est chercheur en sociologie politique au CNRS et membre du Centre européen de sociologie et de science politique (CESSP-CRPS, CNRS/Paris 1).
 Les discriminations – comme les
Les discriminations – comme les




