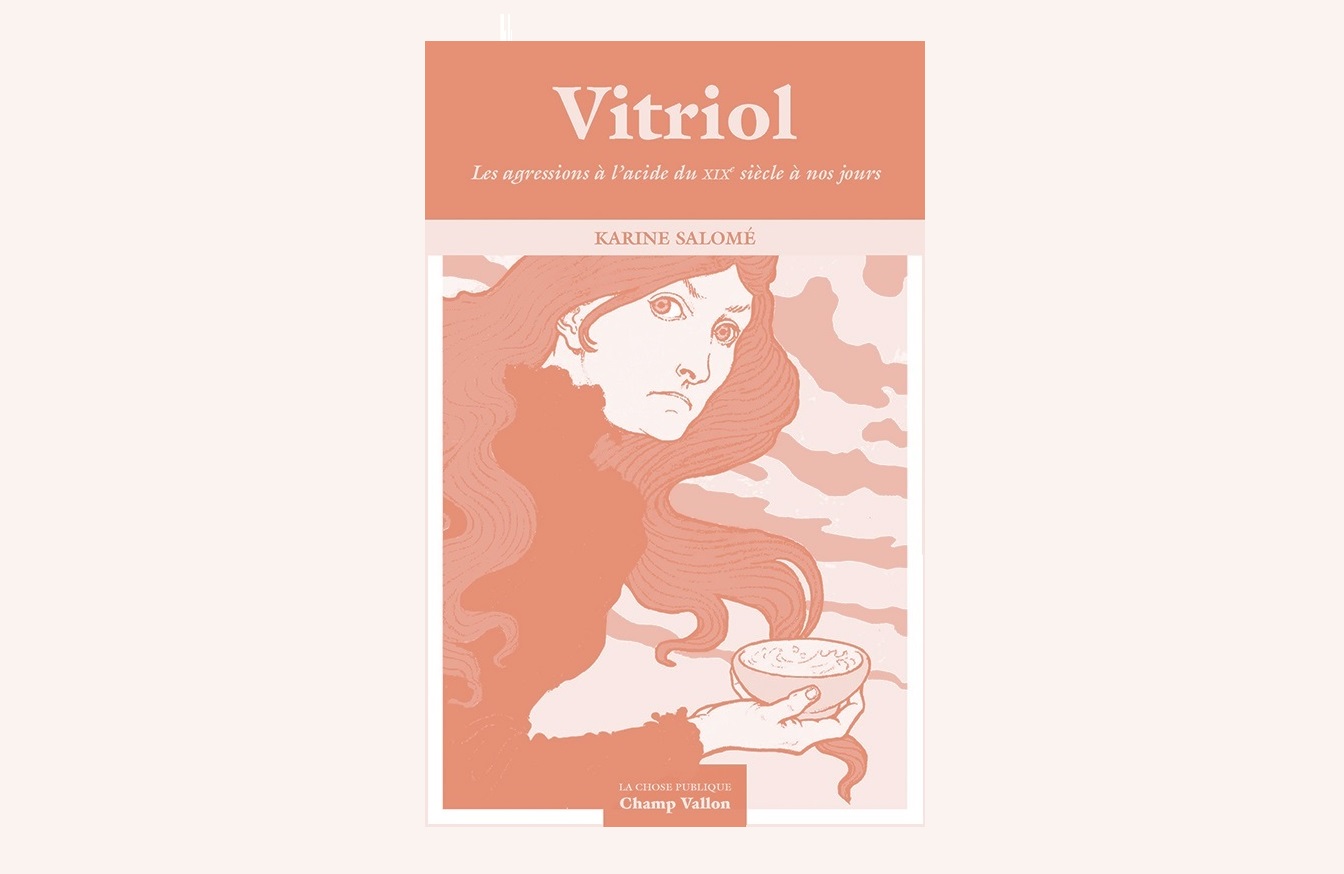Cette année, j’ai lancé un appel auprès de mes connaissances féministes pour trouver une accompagnante attitrée afin de me rendre à la manif du 8 mars, journée internationale pour les droits des femmes. Oui, j’ai besoin d’être chaperonné pour pouvoir participer à une manifestation, bien que je n’aie aucun souci à marcher sur mes deux jambes pour des kilomètres de pavés inégaux, ce qui est déjà un premier facteur – parmi mille autres – qui exclut beaucoup de personnes des manifestations pensées par les personnes valides.
Il y a 3 ans, j’écrivais un article qui relatait mon incapacité à me rendre en manifestation et mon sentiment d’être en conséquence une « mauvaise militante », une militante en carton qui se cache dans son canapé et ne participe pas à l’effort collectif de transformation de la société. Et si j’essaye d’y retourner cette année, ce n’est pas pour me prouver que je mérite bien le titre de vraie militante.
C’est parce que j’en ai envie. Parce qu’à moi aussi ça m’apporterait quelque chose, de puiser un peu de l’énergie de la foule, de me sentir être avec les autres. Les manifs ne sont qu’une infime partie du militantisme, celle dont on parle dans les médias, dont les photos impressionnent ; ce n’est pas la seule manière d’agir. Et si pour moi, me rendre à une manif représente un effort immense qui me bouffe l’énergie de la semaine, pour d’autres, c’est juste une occasion sociale, une activité entre ami·e·s, un peu excitante, et qui n’engage à rien sur la vie de tous les jours1Ce point est à nuancer maintenant que les violences policières augmentent. Les manifs d’aujourd’hui ne sont certainement pas celles que je vivais en tant que jeune femme blanche de 18 ans.. J’ai souvent été déçue, d’ailleurs, de ne pas pouvoir partager de discussions et d’énergie transformatrice avec certaines personnes que je rencontrais en manif.
Au-delà de mes crises d’angoisse et états de surcharge sensorielle, de mon peu d’énergie sociale, mes difficultés à communiquer oralement, mon besoin de prévisibilité et cohérence, il m’est assez rapidement apparu que le problème était plus large : la vision globalement partagée du militantisme et de l’engagement est formée d’un point de vue valide2Valide et privilégié de manière générale, parce qu’il y a d’autres choses que le handicap qui mènent à subir un risque accru en manif. On peut penser aux violences policières – notamment quand on n’est pas blanc –, au risque de perdre son emploi ou son titre de séjour, etc.. Les manifs et plus généralement la manière dont sont organisés les événements militants et même les réunions de préparation sont souvent excluantes pour un tas de personnes en situation de handicap.
Ce qui ne veut pas dire que les personnes handicapées ne manifestent pas et ne font pas d’actions radicales : on l’oublie souvent, mais ça fait aussi partie de l’histoire des luttes handies. L’association Disabled in Action aux États-Unis a mené plusieurs actions contestataires pour l’obtention de droits dans les années 1970, dont par exemple le sit-in de 1972, qui a bloqué une des plus grandes avenues de New-York, avec seulement 80 activistes en fauteuil roulant posté·e·s à un carrefour ; ou l’occupation longue de plus de 25 jours, en 1977, des bureaux du département de la santé et des services sociaux à San Francisco, occupation à laquelle ont participé beaucoup de personnes ayant besoin au quotidien d’assistance, de soins de santé, de traduction. Des personnes autistes manifestent en personne – et sont violemment dégagées – aux États-Unis contre les campagnes d’Autism Speaks, une grande association qui défend tout sauf le bien-être et les droits des personnes autistes. Bien avant ça, lors des actions plutôt violentes des suffragettes, on a vu des usagères de fauteuil roulant, comme Rosa May Billinghurst, manifester en utilisant leur appareil pour résister physiquement à la police ou cacher des projectiles, et ne pas avoir peur aussi de s’enchaîner aux grilles du palais de Buckingham ou faire la grève de la faim en prison3Je ne glorifie pas le mouvement des suffragettes qui était aussi classiste et raciste, mais c’est un exemple intéressant d’activisme « féminin » qui a choisi des actions radicales.. Plus proche de nous, en 2018, une quinzaine d’activistes, dont certain·e·s membres de l’association Handisocial, ont bloqué les pistes de l’aéroport de Toulouse Blagnac et la gare Matabiau, afin d’attirer l’attention sur le manque d’accessibilité des lieux publics (et ont écopé d’amendes et peines de prison avec sursis). Et il y aurait encore beaucoup d’autres récits à faire des actions militantes menées par des personnes handicapées, que ce soit pour leurs droits ou pour d’autres causes ; mais aujourd’hui, je veux parler plutôt de la part du militantisme moins visible et moins reconnue, et de ce que nos vulnérabilités nous enseignent sur la façon de mener des luttes communes.
Je parle de mon point de vue de personne sexisée, aux handicaps dits « invisibles » et qui essaye de prendre en compte le vécu de personnes vivant dans d’autres situations de handicap (sans prétendre pouvoir savoir mieux qu’elles) ; mais je suis aussi blanche, occidentale, diplômée. Je me retiens donc de parler à la place d’autres groupes qui s’organisent et militent autrement. Je crois cependant que le fond de mon plaidoyer peut avoir une portée générale : apprenons des marges, écoutons les autres, remettons en question les principes, pratiques et histoires du militantisme dominant.
Pouvoir se retrouver, communiquer et s’unir pour construire un savoir communautaire
Tout commence par là : avant de pouvoir militer pour quelque chose, il faut se rendre compte qu’il existe des injustices, qu’on peut transformer le système, qu’il y a des choses à réclamer. Avant de pouvoir militer, il faut pouvoir avoir le temps et l’énergie de réfléchir à ces questions, partager des expériences, rendre un vécu individuel collectif, traduire un ressenti en revendication. Puis militer, ça veut dire encore d’autres échanges, de l’organisation collective, encore du temps, encore de l’énergie. Et beaucoup de personnes handicapées n’ont pas ce temps et cette énergie-là, n’ont pas même la possibilité de se rencontrer entre elles et considérer leur vécu sous une autre perspective.
C’est ce que raconte le documentaire Crip camp qui relate la naissance du mouvement américain Disabled in Action et les luttes pour les droits des personnes handicapées dans les années 1970 aux États-Unis : tout a commencé par un camp de vacances qui regroupait des adolescent·e·s et des jeunes aux handicaps différents. Tout a commencé par le fait d’être ensemble, de se considérer à égalité, et d’avoir un cadre ouvert pour communiquer.
Et faire la grève, pour les travailleureuses les plus exploité·e·s, c’était et c’est aussi un moyen d’avoir le temps de discuter. Tout simplement. Pouvoir échanger sur les expériences et ressentis. Échapper au rythme sans pause des machines et prendre du recul sur sa situation.
Tout comme des femmes ont développé ce qu’on nomme en anglais le « craftivism », l’activisme par les travaux d’aiguilles. Le temps pris par le tricot ou la broderie permet la réflexion, les réunions de tricot et de crochets avec d’autres femmes permet d’échapper aux obligations domestiques et parentales pour un bref moment, et échanger avec d’autres femmes.
Tant qu’on ne peut pas s’arrêter, il est difficile de se rendre compte que quelque chose ne va pas. Et tant qu’on est isolé·e, on ne peut pas se rendre compte que ce qui ne va pas est systémique. C’est si facile d’intégrer ce que la société en déni nous enseigne : que tout est de notre responsabilité individuelle, que le problème, c’est nous, et pas la société inégalitaire.
Mais s’arrêter et échanger avec des semblables est compliqué pour beaucoup de gens : pas juste le nombre écrasant de personnes qui sur-travaillent dans de mauvaises conditions pour des salaires trop bas, mais, plus spécifiquement les personnes qui s’occupent d’autres personnes, qui ont en charge du vivant – parents, puéricultrices, sage-femmes, infirmières, aidant·e·s proches –, et puis, les personnes qui doivent déjà s’occuper d’elles-mêmes. Faire la grève à l’usine pour organiser une lutte, ce n’est déjà pas simple : mais faire la grève de se maintenir soi-même en vie, c’est tout simplement impossible. Or oui, gérer nos corps est parfois déjà un travail à temps plein, en soi. Les personnes valides ont du mal à comprendre toute la logistique et l’énergie qu’implique – souvent – le fait d’être handicapé·e.
Ensuite, il y a les possibilités de rencontres. La rencontre en personne, c’est parfois mieux, oui. Mais ce n’est pas toujours possible – et nous, personnes handicapées, n’avons pas attendu 2020 et l’épidémie de Covid-19 pour le découvrir. Ce n’est pas juste une question d’accès aux personnes à mobilité réduite, d’interprètes en langue des signes, ou utilisation d’autres modes de communication – même si ces aspects excluent déjà beaucoup de monde des espaces culturels et militants. Il faut aussi prendre en compte : la fluctuation de l’énergie et l’incroyable fatigue procurée par les déplacements et réunions, la difficulté à prendre les transports, le besoin de nourritures spécifiques, les intolérances sensorielles, l’impossibilité de participer à une activité le soir… Ou encore, la difficulté à s’intégrer dans un milieu militant où tout est basé sur la socialisation informelle, les informations sous-entendues, la fréquentation de lieux bruyants et la consommation d’alcool, des horaires et modes d’organisation et d’action très aléatoires et peu explicités (oui, je suis autiste, et c’est du vécu). Et c’est là qu’arrive internet, qui n’est pas non plus accessible à tout le monde, mais qui donne à beaucoup de gens isolés la possibilité de communiquer, s’instruire, s’exprimer, et trouver des semblables.
Prendre soin de soi et des autres, une forme de résistance
On sait que les réseaux sociaux peuvent faciliter l’organisation militante, la communication, le partage de ressources, la réaction à l’actualité – et depuis la pandémie, l’utilisation d’internet n’est plus autant dénigrée par la population générale, qui s’est retrouvée elle aussi obligée de compter exclusivement sur le virtuel. Mais trop souvent encore, notre activité sur internet est considérée comme accessoire au « vrai militantisme », comme insignifiante tant qu’on ne fait pas des actions publiques. Alors que c’est justement ça qui m’intéresse : ce qui se passe d’abord, ce qui se passe majoritairement, dans les groupes d’échanges entre personnes handicapées. Ce que moi je considère déjà comme du militantisme, mais qu’on conteste souvent comme relevant juste de la vie privée et de l’anecdotique. Dans nos groupes de discussion, une majorité de nos messages tournent autour du soin et de l’organisation quotidienne. Nos échanges sont principalement du self-help ou pair-aidance, du care, et de la construction d’un savoir expérientiel alternatif aux savoirs académiques qui ne nous prennent pas en compte.
Et même quand on se retrouve (difficilement, rarement), qu’est-ce qu’on fait ? Eh bien, avant de parler politique et action, on vérifie que tout le monde se sent bien, a ce dont iel a besoin, est à l’aise physiquement comme mentalement ; on se donne à boire et à manger, on partage des plaintes, des douleurs, des frustrations ou des joies et de la gratitude ; on essaye de trouver des manières alternatives de communiquer et participer, pour inclure un maximum de personnes ; on cherche un rythme, une fréquence de rencontre, des horaires qui puissent convenir à un maximum de personnes, qui ne soient pas trop exigeants, et on ne culpabilise jamais celleux qui ne peuvent pas participer à tout.
La notion de self-care comme acte de résistance a d’abord été développée au sein des luttes antiracistes4Audre Lorde, femme noire, lesbienne, et survivante de cancer, en parle notamment dans A Burst of Light (1988). Lire aussi : https://www.mentalhealthtoday.co.uk/blog/awareness/why-acknowledging-and-celebrating-the-black-feminist-origins-of-self-care-is-essential, avant d’être récupérée par un peu n’importe qui et n’importe comment sur Instagram et dans les magazines féminins, et de devenir un prétexte pour vendre plus de produits. Je ne suis absolument pas contre le fait que tout le monde apprenne à prendre soin de soi et à préserver sa santé mentale – mais ce n’est pas vraiment le même acte de résistance pour toustes, et ça ne se pratique pas de la même manière. Pour les personnes les plus opprimées, pour les groupes les plus fragilisés, le soin de soi est éminemment politique et se heurte à pas mal de barrières. Il s’agit à la fois d’une résistance face au monde qui veut nous supprimer ; d’une réparation face aux traumas individuels et collectifs – reconnaître et nommer ce trauma, apprendre à poser des limites, savoir que l’on a de la valeur, réclamer le droit au respect et à l’épanouissement, célébrer notre culture commune ; et d’une manière de gérer nos énergies afin que le mouvement dure, au lieu de toustes terminer en burnout militant.
Alors du coup nous handicapé·e·s, malades chroniques, autistes, traumatisé·e·s, anxio-dépressif·ve·s et compagnie, entre nous :
- On s’explique et s’enseigne mutuellement, à notre manière, nos conditions de santé, notre neurologie, notre fonctionnement, réparant par là les failles du système de santé discriminatoire et normalisant – souvent déshumanisant.
- On se décharge du validisme quotidien auquel on fait face, on se donne droit à la colère, à la tristesse comme à l’humour noir.
- On se donne des conseils sur quoi faire en crise pour atténuer la douleur, on discute interaction des traitements médicamenteux et hormonaux, habits et accessoires compatibles avec un handicap physique ou particularités sensorielles, on partage notre manière de calculer notre énergie et organiser notre semaine en fonction.
- On se partage nos expériences avec les services administratifs pour la reconnaissance de handicap, on se conseille sur nos droits et comment y accéder, on aide à repérer les comportements abusifs sur le lieu de travail ou de la part de soignant·e·s.
- On cherche des noms de médecins, de psychologues, d’avocat·e·s, qui ne soient pas sexistes, pas transphobes, pas grossophobes, et qui soient, par contre, un minimum au fait de nos conditions.
- On se conseille des objets ou aménagements pratiques pour aider avec nos handicaps au quotidien, on se fait des rappels de manger / boire / faire une sieste.
- On fait part de nos expériences en termes d’accessibilité de tel ou tel lieu, on se recommande des livres ou des films qui ne parlent pas trop mal de nous, on traduit des ressources qui n’existent qu’en anglais.
- On partage nos centres d’intérêts, nos passions, des photos de nos animaux de compagnie ou nos peluches.
- On est des personnes complexes, multifacettes, riches, qui nous définissons comme nous le voulons, qui parlons ou pas de notre handicap, de nos maladies.
- On se donne de l’amour, de la bienveillance, on s’offre l’acceptation inconditionnelle que l’on n’a parfois jamais reçu de personne d’autre, ni de notre famille, ni de nos pseudo-ami·e·s, ni de la société en général.
- On se soutient, se répare puis on cherche à retrouver une capacité d’action.
Et quand on est handi, parfois, l’empuissancement, ça passe autant par le rappel de nos valeurs politiques et principes militants que par l’encouragement à écouter cette douleur et la reporter au médecin ; par une suggestion de recette de cuisine facile qu’on puisse faire avec des dysfonctions exécutives ou une mauvaise motricité fine, qui nous permette de ne pas sauter un repas une fois de plus ; par une utilisation correcte de nos pronoms sans qu’on ait à prouver qu’on est de tel ou tel genre, sans qu’on ait à adopter tel style de vêtement ou coupe de cheveux pour montrer qu’on est queer ; par le partage de photos de chatons ou gifs rigolos pour nous détourner d’un trigger traumatique ; par le rappel constant que c’est ok de faire des pauses.
« Militer est un luxe », dit Elisa Rojas5Interviewée par Lauren Bastide dans le podcast La poudre.. « On ne peut militer que si on peut dégager du temps, de l’énergie, si on n’est pas dans la survie ». Ce n’était pas la première fois que je lisais / entendais / ou pensais ça, mais c’est cette fois-ci que je me suis arrêté pour noter cette phrase sur un morceau de papier que j’ai épinglé au-dessus de mon bureau. Cette fois-ci où j’étais en pleine plongée dépressive, écrasé par des angoisses matérielles, et que je ne pouvais plus participer à l’effort commun, ce qui renforçait ma dépression. J’imagine que cette phrase résonne aussi chez les personnes qui font face à une migraine de plusieurs jours qui les cloue au lit, qui sont obligées de travailler un temps plein alors que leur handicap nécessiterait bien plus de temps de repos, ou qui doivent apprendre à composer avec des nouvelles limitations physiques ou cognitives sans aide professionnelle pour réaménager leur vie. C’est pour ça que je pense que s’entre-soutenir pour sortir du mode survie, c’est déjà une forme de militance.
Qu’est-ce que le militantisme « concret » ?
Anecdote : au sein d’une association où j’ai travaillé il y a trois ans, une collègue, pourtant spécialisée sur les questions de handicap, remettait en question l’existence d’un « militantisme handi » dont avait parlé une autre collègue dans un texte de vulgarisation sur l’handiféminisme. « Il n’y a pas d’action concrète », argumentait-elle. Et j’avais des exemples de manifestations, actions et revendications politiques à lui donner, mais ce n’était même pas ça que j’avais envie de répondre. Je voulais plutôt revenir sur tout le reste, tout ce que j’ai cité plus haut, tous ces échanges et rencontres auxquels on n’a que si difficilement accès, ces aides et conseils du quotidien qui ne nous sont apportés par personne d’autre, puis ce savoir marginal, ces normes alternatives et cette histoire commune oubliée que l’on élabore collectivement. Peut-être que c’est facile, comme jeune féministe du XXIe siècle, d’oublier que même les femmes valides, blanches et bourgeoises, ont dû en passer par là, aussi, avant de pouvoir organiser des luttes de terrain.
Peut-être qu’en effet, la remise en question individuelle, le fait de se documenter et discuter du sujet, ce n’est pas suffisant (pour moi, ce sont déjà des graines que l’on sème et qui ont leur importance, mais passons). Militer, c’est chercher à faire changer la société, et à un moment, il faut que ça passe par une organisation collective. Mais inversement, les actions visibles sans remise en question de notre organisation interne, ça n’a pas de sens. J’ai eu personnellement de mauvaises expériences face à des personnes et des groupes qui brandissaient de beaux slogans mais continuaient en interne à reproduire les mécanismes de domination. Si on milite pour des réformes politiques et sociales, moi je veux en avoir un avant-goût, de cet autre modèle de société. Comment on relationne les un·e·s avec les autres ? Comment on s’organise comme groupe ? Comment on prête attention à l’autre ? Comment on apprend à prendre soin ? Exit la concurrence, les cultes de personnalité, la course à la pureté, la mise à l’écart des plus « faibles », la hiérarchisation des causes. Oui à l’humilité, la solidarité radicale, l’évolution permanente, l’intégration de perspectives multidimensionnelles et intersectionnelles – aussi pour les luttes pour la défense de l’environnement, ou pour le respect de la vie animale. Et oui, c’est souvent moins spectaculaire et plus lent.
Effectivement, ça prend du temps d’essayer de ne laisser personne à l’écart. Le temps d’écouter. D’envisager d’autres manières de faire. D’aménager les espaces, au sens propre comme figuré. De se remettre en question. De faire attention à la santé mentale du groupe. Se rappeler, aussi, que le temps n’est pas le même pour toustes. Quand on est handicapé·e, la temporalité est différente, et bien souvent, on se retrouve exclu·e, parce que nos journées semblent ne pas compter autant d’heures que celles des autres, parce que nos gestes sont plus lents ou requièrent plus d’étapes, parce que nos semaines consistent parfois simplement à survivre à une crise de douleur ou à s’en remettre. Je sais, tout nous semble urgent. Tout est urgent. La terre ne s’arrête pas de brûler et les personnes vulnérables de mourir prématurément pendant qu’on réfléchit sur comment s’organiser et qu’on prend le temps d’écouter chaque personne pour prendre en compte le maximum de points de vue et essayer de ne pas reproduire des dynamiques d’oppression au sein d’un petit groupe. L’idée n’est pas de faire les choses parfaitement – ça n’existe pas, la perfection – mais de viser à intégrer les points de vue et les besoins des personnes les plus marginalisées dans nos perspectives militantes. Parce qu’apprendre à résister à la pression à la performance et productivité dans le monde associatif/militant, c’est aussi, vraiment, de l’action anticapitaliste. Pouvoir faire une place pour tout le monde au sein de l’organisation et pas juste aux plus « capables » et les plus glamours, mais aussi à celleux qui annulent parce qu’iels sont fatigué·e·s, qui ont besoin d’aménagements ou qui ne crieront pas en manif, c’est de l’antivalidisme en action.
Enfin, commencer par l’individuel, ça n’empêche pas d’aller vers le collectif et le politique. Faire les choses sur internet, ça n’empêche pas les retombées sur le quotidien tangible (post-Covid, on a peut-être enfin intégré ça). Parler de nous, de nos corps, nos douleurs, nos maladies, nos larmes, mais aussi nos désirs, nos rêves et nos joies, parler de notre quotidien, de nos vêtements, de notre alimentation, de notre sexualité, de notre famille, c’est politique. En parler sur Twitter ou sur nos blogs, aussi.
Par exemple, la prise en compte militante, sociologique et politique des difficultés du post-partum (l’après-naissance, pour les personnes ayant accouché) a commencé par une déferlante de témoignages personnels sur Twitter et Instagram. Cette déferlante a donné lieu à des articles, des vidéos, des podcasts, des reportages, des livres, des émissions télé, des recherches, des journées d’étude, et puis, aussi, des décisions politiques : allongement du congé de parentalité pour le deuxième parent, mise en place d’un protocole pour une meilleure prévention et détection de la dépression post-partum, etc. De même pour la reconnaissance de l’endométriose, lutte longtemps menée par les concerné·e·s via des témoignages de leurs douleur et leur errance médicale, qui mène enfin à des actions politiques pour un meilleur diagnostic, des recherches sur les traitements, une prise en compte de la maladie comme affection longue durée. La militance pour la déconjugalisation de l’AAH en France (question toujours pas résolue, hélas) s’est aussi jouée en ligne ; il y a eu des manifestations, et pourtant c’est principalement la communication sur les réseaux sociaux qui a attiré l’attention des journalistes valides, des autres militant·e·s, de tout un chacun qui a pris conscience d’une des injustices faites aux personnes handicapées et signé la pétition qui a permis de porter la question devant l’Assemblée Nationale et le Sénat. Et, plus généralement, c’est internet et les rencontres autour de nos témoignages de vie et de discriminations vécues qui ont pu rendre possible la création du CLHEE, du CLE Autistes, et des Dévalideuses, les trois principaux collectifs militants de personnes handicapées en France.
Et tant d’autres exemples pourraient être tirés des luttes féministes, antiracistes, contre la transphobie, pour la reconnaissance des personnes intersexes… !
*
Alors voilà, moi, le 8 mars, je vais retourner manifester pour la première fois depuis des années, pour quelque chose qui me tient à cœur. Cette année, j’ai participé à la mise en place d’événements militants ; j’ai organisé une conférence ; j’ai animé des ateliers et motivé des rencontres entre personnes autistes minorisées ; j’ai essayé d’avancer personnellement et de faire avancer collectivement sur les questions d’accessibilité ; j’ai appris à m’organiser, m’entendre, me réunir, me mettre d’accord et lutter avec d’autres personnes, en chair et en os.
Mais j’ai aussi : écrit des articles sur l’autisme, encore et toujours ; développé des formes de bienveillance radicale dans mes amitiés avec d’autres personnes marginalisées ; échangé des mails avec des personnes souffrant de TCA et victimes de la grossophobie de médecins et psychologues ; diffusé des noms de thérapeutes approprié·e·s ; avancé dans la réparation de mes traumas, grâce à mes amies qui réparent aussi les mêmes chez elles ; appris à ne pas m’engager dans ce pour quoi je n’aurais pas la force, appris à dire quand c’était trop ; lu, échangé, réfléchi, toujours.
Et je ne considère pas certaines de ces actions plus concrètes ou plus importantes politiquement que d’autres. Parce qu’elles sont indissociables. Parce que les unes étaient et sont encore nécessaires pour me mener aux autres. Parce que chacun·e devrait pouvoir contribuer à l’effort collectif selon ses capacités, ses possibilités, sa manière de fonctionner, sans s’en sentir diminué·e. Parce que plus que jamais, dans un monde secoué par les catastrophes politiques et écologiques, nous avons besoin d’apprendre à prendre en compte et laisser sa place à tout être humain au sein de nos luttes.
Charlie Mostro milite sur les questions d’autisme et de féminisme. Vous pouvez découvrir son (excellent !) blog ici : pourquoipasautrement.wordpress.com