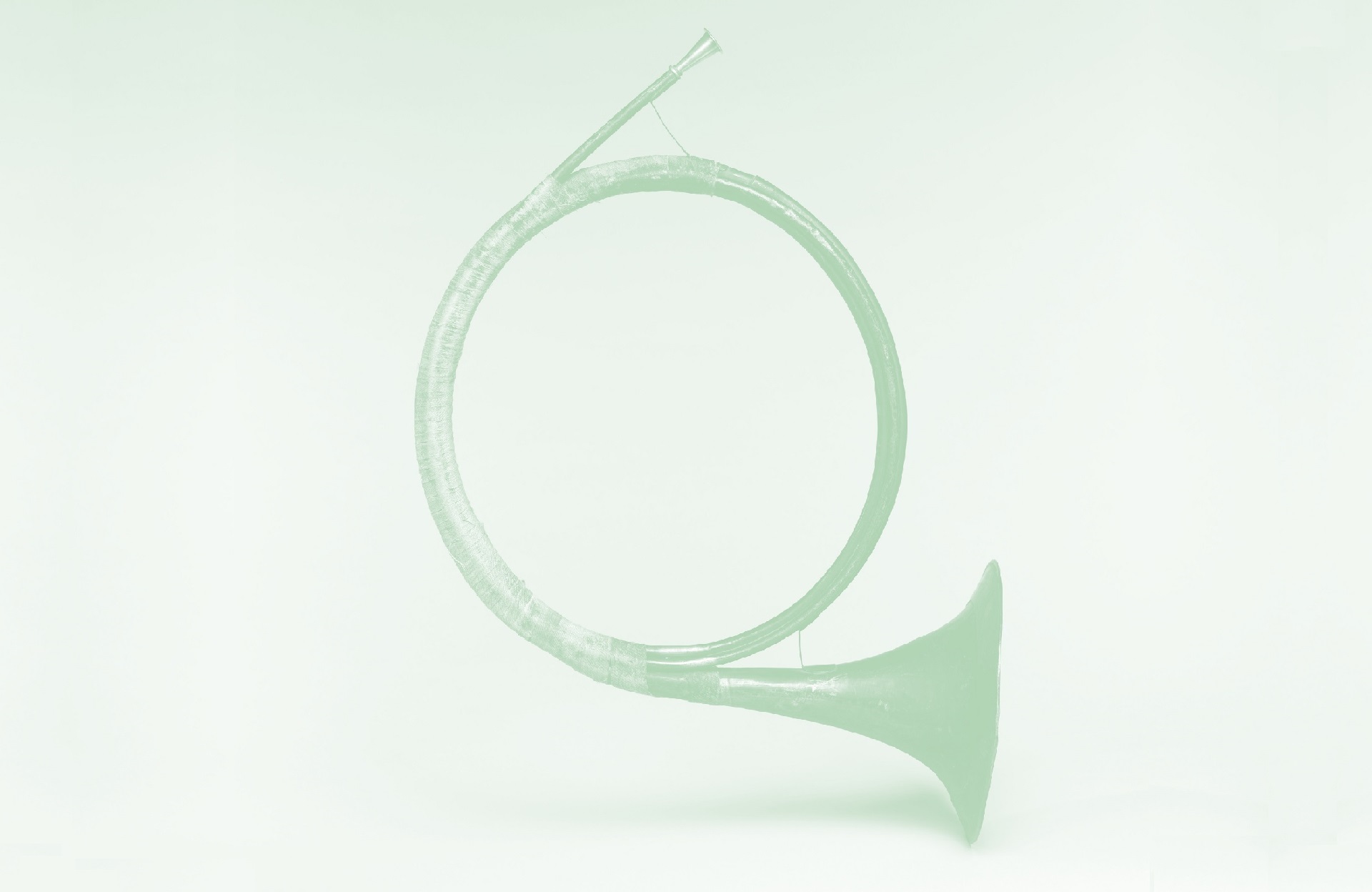En octobre 2017, Alyssa Milano reprenait le slogan Me Too, porté par Tarana Burke depuis 2006, pour dénoncer les agression sexuelles qu’elle avait subies suite à l’affaire Weinstein. Deux jours plus tôt en France, la journaliste Sandra Muller lançait le hashtag #Balancetonporc pour dénoncer le harcèlement sexuel dont elle avait été victime au travail. Depuis, une quinzaine de hashtags se sont succédé, permettant à des milliers de femmes et de victimes de violences sexuelles de témoigner.
Ce que l’on a alors appelé le « mouvement #MeToo » a été considéré comme une « libération » sans précédent de la parole des femmes face aux violences sexuelles. Pourtant les militantes féministes sont nombreuses à réévaluer l’efficacité qu’a eu le mouvement dans la société française.
Dans cet article, je reviens sur quelques points qui prennent en compte l’aspect langagier du mouvement #MeToo et de son échec.
#MeToo n’a pas été la libération de la parole des femmes, mais celle de l’écoute d’une société entière
Le silence est ce qui caractérise le plus les violences sexuelles faites aux femmes : la culture du viol, si justement décrite par Valérie Rey-Robert, les invisibilise et les relègue au rang de violence ordinaire, une violence dont on ne parle pas, qui n’existe que chez les autres et que l’on glisse sous le tapis lorsqu’elle arrive par malheur chez nous.
Le viol ne trouble aucune tranquillité, c’est déjà contenu dans la ville
Virginie Despentes, King Kong Théorie
Parler de libération de la parole en 2017, c’est nier celle des femmes qui ont parlé depuis des décennies. En 1970, la traductrice Emmanuelle de Lesseps témoigna dans la revue Partisans, en 1980, une militante féministe témoigna dans la revue Questions Féministes, en 1986, c’est dans une émission télévisée qu’Eva Thomas témoigna de l’inceste perpétré par son père quand elle avait 15 ans. Plus récemment, mais toujours avant #MeToo, Virginie Despentes témoigna en 2006 du viol qu’elle a subi dans son livre King Kong Théorie, suivie dix ans plus tard de l’animatrice Flavie Flamant qui sortit La consolation en 2016. Ces quelques exemples montrent que la parole des femmes était déjà libérée, qu’elles parlaient déjà, dès les années 1970 ; simplement, leur parole n’était pas écoutée, et encore moins prise en compte.
La complexité de parler des violences sexuelles
Deux stratégies opposées sont mises en place par ces femmes pour imposer une parole sur la place publique, incarnée avec #MeToo par les réseaux sociaux :
- User d’euphémismes pour rendre leurs récits écoutables et dicibles, en contournant ou en censurant le terme « viol » et les détails des faits ou des traumatismes, pour qu’ils puissent être dits et écoutés. Cela implique de s’autocensurer pour permettre aux autres d’accepter d’écouter, et cela atténue donc la réalité au profit d’un récit des violences édulcoré.
- Choquer l’opinion publique par des témoignages crus, réalistes, sans filtre ; ce qui implique de se replonger dans les souvenirs des actes subis, pour faire appel au trauma porn voyeuriste des médias et de la société, le mieux étant d’avoir vécu le bon viol, c’est-à-dire un viol violent, perpétré par un inconnu dans un lieu public, ayant laissé des séquelles physiques et psychologiques.
Dans les deux cas, il est nécessaire aux femmes d’articuler leur discours de façon à ce qu’il rentre dans certaines cases, et ce jusqu’à leur possible parcours en justice : après avoir eu le bon viol, il leur faudra devenir une victime exemplaire.
Avec #MeToo, toutes les femmes n’ont pas été en mesure de témoigner
Le mouvement #MeToo a été porteur d’une quadruple extension, dont la dernière a été qualifiée de sociologique. Porté par l’impulsion de femmes blanches, aisées et évoluant dans des sphères hautes de la société, le mouvement s’est étendu sur les réseaux sociaux pour atteindre les femmes de strates sociales plus basses. Mais l’extension s’est heurtée à un mur, symbolique et matériel, dès lors qu’elle a tenté d’atteindre les milieux paysans, les femmes vulnérables et précaires (sans domicile fixe, exilées, sans-papiers), les femmes âgées ou atteintes d’un handicap, celles n’ayant pas accès à un réseau internet, aux réseaux sociaux, à un téléphone portable ou un ordinateur, et surtout à l’accompagnement psychologique et financier souvent nécessaire au témoignage.
La parole des femmes racisées a également été confisquée. Aux États-Unis, l’invisibilisation de Tarana Burke au profit d’Alyssa Milano a incarné l’exclusion des femmes noires, ce qui a entrainé une large surreprésentation des femmes blanches sur le hashtag #MeToo, renforcée par le traitement médiatique du mouvement, qui se concentrait davantage sur les femmes et les agresseurs connus et puissants, excluant ainsi les victimes des groupes marginalisés de la conversation.
Le patriarcat n’est pas seulement lié au genre, il est aussi lié aux institutions de race, d’identité de genre, de sexualité et de classe.
Meaghan McBride, 2019 (traduction libre)
Pour penser cette invisibilisation, il faut se placer dans le cadre de l’intersectionnalité, c’est-à-dire de l’imbrication entre le genre, la classe et la race. C’est ce dont discute la militante Venus Liuzzo, d’XY média, lorsqu’elle propose de repenser le témoignage des violences transmisogynes perpétrées et subies par des personnes racisées. Leur témoignage, une fois récupéré, sert malgré lui les fins racistes d’un agenda politique qui auront alors des répercussions sur elles. Dans le même temps, les témoignages visant des hommes racisés permettent de réactualiser le script des violences sexuelles qui reporte les faits sur les « autres », à savoir les hommes noirs et arabes, surreprésentés dans les procès pour violences sexuelles.
#MeToo a donc été bénéfique à un certain nombre de femmes, tout en en laissant de nombreuses de côté, excluant ainsi leurs témoignages et de ce fait, occultant leur réalité des violences sexuelles.
Pour que les femmes témoignent, il fallait un déclencheur, quelque chose qui les autorise à dire
#MeToo a été un évènement discursif, c’est-à-dire un évènement construit dans et par les discours. Les témoignages individuels se sont regroupés en un mouvement collectif et les discours sur celui-ci l’ont fait se figer en un évènement délimité dans le temps.
L’évènement #MeToo a été autorisé, comme l’explique la chercheuse Marie-Anne Paveau, par une parole plus légitimée, notamment par des personnalités publiques utilisant leur notoriété pour entamer le dialogue, et permettre aux autres femmes victimes de parler à leur tour. Car parler nécessite une double autorisation : il faut s’autoriser soi-même à témoigner des violences que l’on a subies, et réussir à recevoir l’autorisation de la société, celle qui donne légitimité au témoignage, qui accepte que l’on puisse parler et qui accepte ce que l’on dit.
La légitimation et l’autorisation de la parole des femmes victimes a été appuyée dans de nombreux cas par la démarche de l’enquête journalistique (pour l’affaire Baupin, l’affaire Weinstein ou encore l’affaire Haenel) ou par les témoignages précédents, notamment lorsqu’ils étaient littéraires (comme La Familia Grande de Camille Kouchner qui a engendré le hashtag #MeTooInceste, ou Le Consentement de Vanessa Springora). Mais, avec #MeToo, l’autorisation a été anonyme et quasi-unanime, rendant chaque tweet plus légitime encore que le précédent et donnant la possibilité, et l’autorisation, au prochain d’être posté sous le même hashtag. C’est ce mouvement mondial, un féministe et solidaire, qui a donné la possibilité à tous ces témoignages d’émerger.
Sous #MeToo et #Balancetonporc, les témoignages sont restés très encadrés
Le lancement des deux premiers hashtags au même moment les a liés l’un à l’autre. Mais c’est aussi ce qui, en France, a engendré simultanément deux mouvements distincts portés par les instigatrices. L’un visant à dénoncer les actes subis pour faire communauté et donner une idée de l’ampleur du problème, comme l’explique Alyssa Milano dans son tweet. L’autre visant à dénoncer nommément les agresseurs, comme l’a fait Sandra Muller.
Une étude comparative a montré que cette disparité se lisait dans les tweets utilisant ces hashtags, par exemple avec l’usage du pronom « we » pour les tweets anglophones, et du « je » pour les tweets sous le #Balancetonporc. Les deux hashtags, tout comme les suivants, ont ainsi dirigé les témoignantes vers des types de témoignages précis ; même si très peu de femmes ont réellement « balancé leur porc » dans leurs tweets.
Les témoignages ont également été encadrés, ou contraints, par les discours ayant caractérisé l’évènement MeToo. En le qualifiant de libération de la parole, les médias ont délimité et orienté les enjeux et les possibilités du mouvement. Chaque nouveau hashtag ou nouvelle vague de témoignage a été affublée de la même description, indiquant aux femmes qu’il était à la fois nécessaire et suffisant de témoigner pour engendrer des changements systémiques.
Les critiques antiféministes ont quant à eux rapproché #Balancetonporc de la délation lors de la Seconde Guerre mondiale, ce qui a décrédibilisé le mouvement pour un certain nombre de personnes et inversé les rôles en faisant passer les féministes pour des « collabos » et les hommes pour des victimes.
Les expressions « libération de la parole » et « délation » ont donc contraint les femmes à libérer leur parole d’une certaine façon, et en les enjoignant à ne pas dénoncer nommément leurs agresseurs. Car c’est aussi cela la culture du viol : accepter que les femmes puissent avoir été victimes de viols, mais ne pas se résoudre à avouer que les hommes puissent violer.
Ce n’est pas parce que les femmes ont parlé que la question des violences évolue
Les femmes ont été entendues, mais ont-elles été écoutées ? A-t-on agi ?
Lorsqu’un des hashtags (#Jeleconnaissais) tentait exclusivement de donner à voir que les victimes connaissaient en majorité leurs agresseurs, le gouvernement a préféré proposer des lois visant à combattre le harcèlement de rue. Même si le #MeTooInceste a récolté des milliers de témoignages, le gouvernement a préféré redemander aux victimes de se confier à nouveau en organisant une commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles intrafamiliales. Les exemples comme ceux-ci sont nombreux, et la parole des femmes, vue depuis quatre ans comme une fin en soi, semble seulement devenir un moyen de faire changer les choses.
Ces vagues de hashtags, devenus un agglomérat de milliers de témoignages, ont fini par former une montagne, que peu pourtant se heurtent à gravir. En France, l’on préfère se dire que la montagne de témoignages se suffit à elle-même, que c’est assez pour que les choses évoluent toutes seules.
Cette sédimentation de #MeToo s’est assortie d’une spécification des témoignages : chaque nouvel hashtag s’est attelé à recueillir des témoignages de violences subies selon différents paramètres.
Si les témoignages de 2017 répondaient aux questions Qui ? Quoi ? Quand ? Où ? Comment ? dans leur ensemble, les suivants ont préféré fractionner la parole en ne répondant qu’à une seule de ces questions. #MeTooInceste spécifiait par exemple le type de violence subie (l’inceste) et les liens entre agresseurs et victimes, tout comme #Jeleconnaissais. #IWasCorsica spécifiait le lieu géographique des agressions, #Sciencesporcs en spécifiait le lieu social. Les hashtags comme #Balancetonyoutubeur, #Balancetonrappeur ou #UbercestOver répondaient à la question « qui ? » en spécifiant la profession de l’agresseur. Les tweets sous le hashtag #IWas répondaient quant à eux à la question « quand ? ».
Ainsi, chaque hashtag a tenté de se concentrer sur un aspect des violences sexuelles, ce qui semblait être une stratégie de la part des femmes lanceuses de ces hashtags, pour permettre d’accroître les chances d’une évolution réelle sur au moins un de ces paramètres.
« Ce qu’on veut, c’est qu’on ne viole plus »
Audrey Pulvar
Malgré tout, si le nombre de plaintes pour viol a augmenté en 2018 et par la suite, le nombre de viols, lui, n’a pas baissé.
Les derniers hashtags, #MeTooGay et #MeTooInceste, ont rappelé l’importance de replacer les violences sexuelles dans le cadre du patriarcat hétérosexiste qui donne les pleins pouvoirs aux hommes : les hommes gays et les enfants, quels que soient leur genre, sont également victimes de violences, mais les auteurs sont majoritairement des hommes. C’est cette constatation qui a engendré la question, bienvenue et nécessaire après quatre années de témoignages, « Comment fait-on pour que les hommes cessent de violer ? ». À ce jour, personne n’y a encore répondu et il ne serait pas étonnant qu’un nouvel hashtag surgisse, le #MeToo d’un lieu ou d’une sphère sociale jusqu’alors magiquement exempte des violences sexuelles faites aux femmes qui se révélerait finalement aussi toxique et violente que les autres.
Noémie Trovato est étudiante en Master 2 de Sociolinguistique à l’Université Sorbonne Nouvelle. Elle tient aussi un blog « [d’]écriture créative et [de] travaux universitaires » : L’Antigone café (noemieantigone.wordpress.com).