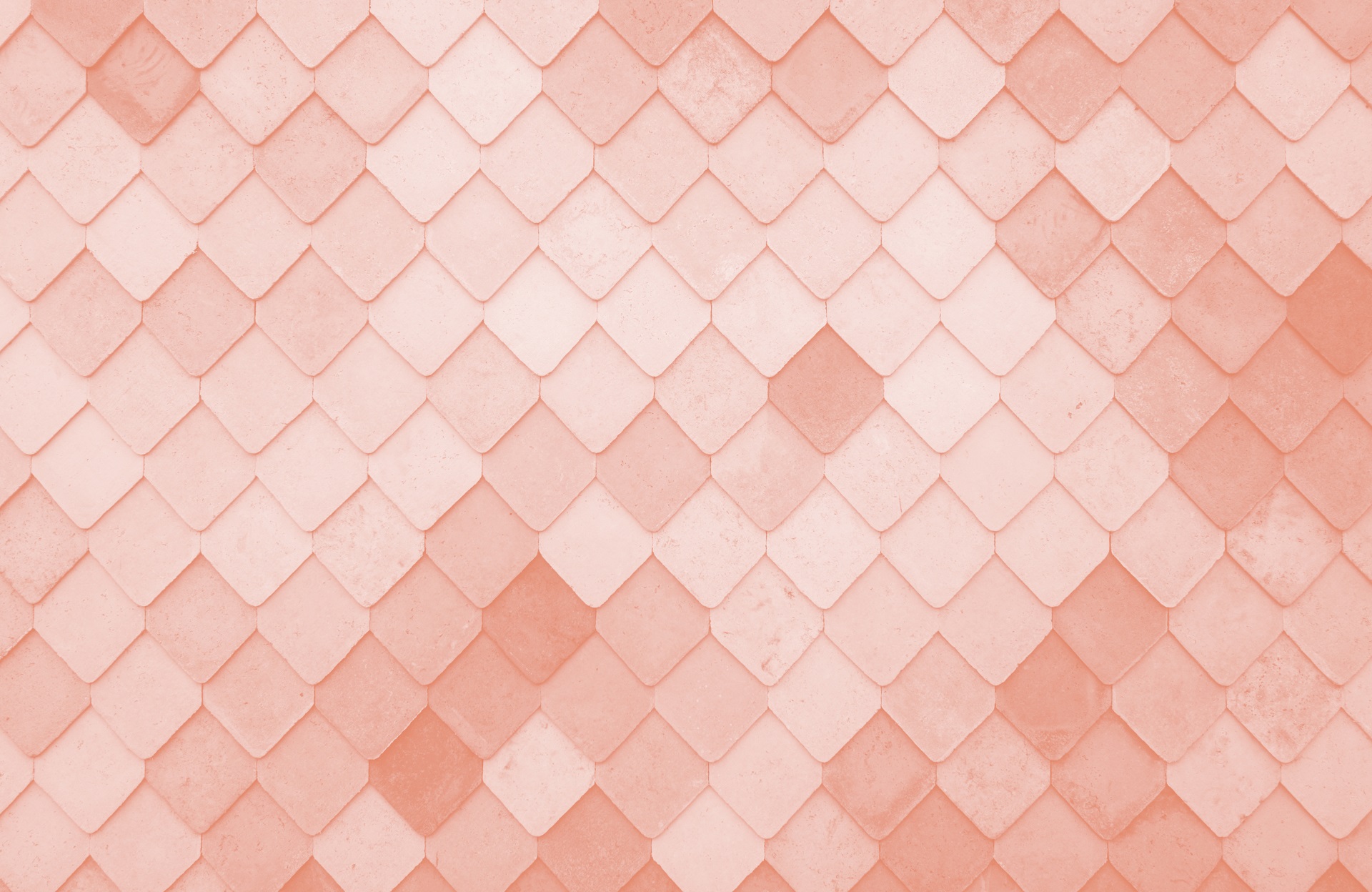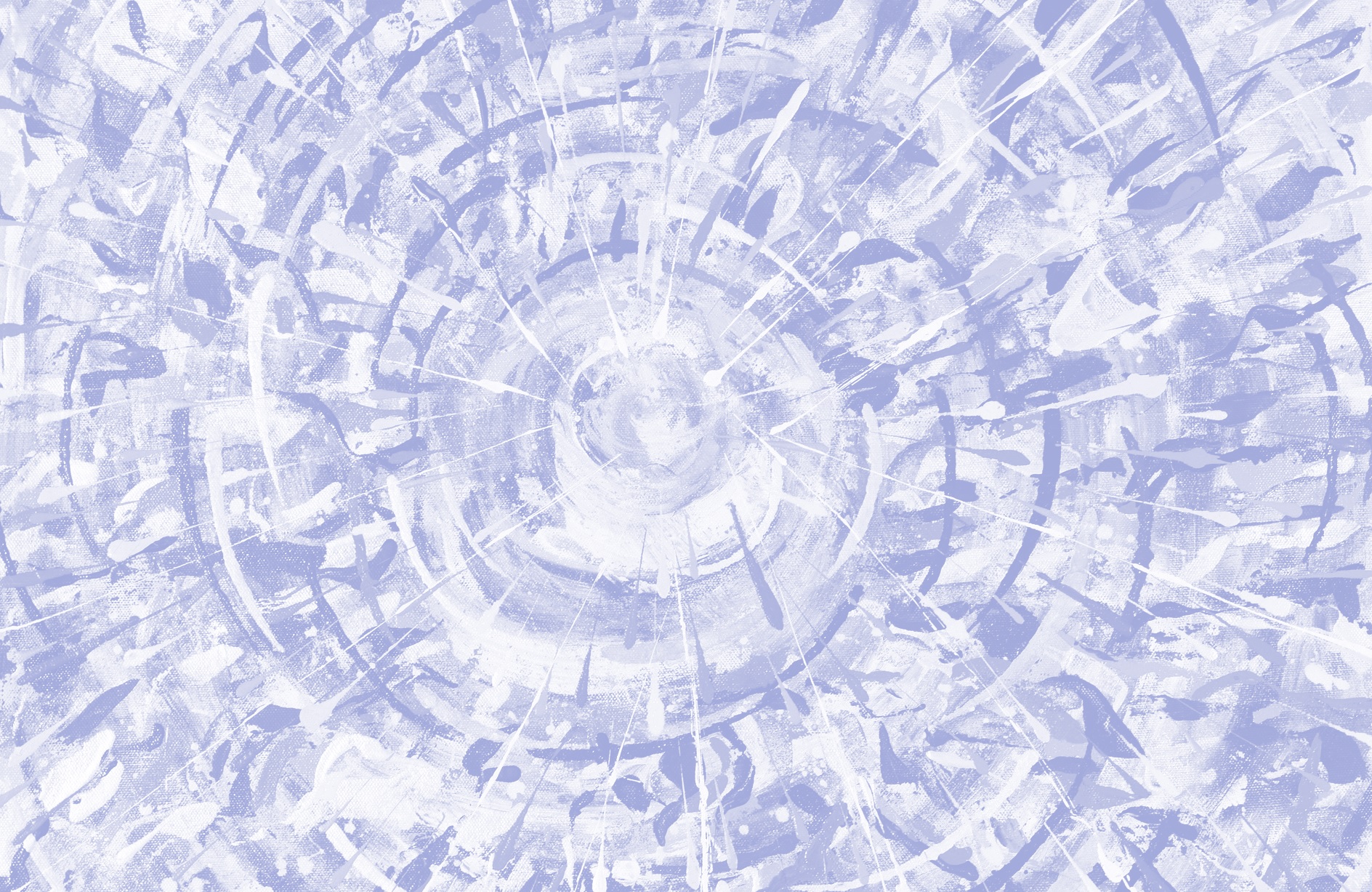Pauline Mortas est doctorante à l’Université Paris 1, et mène des recherches sur l’histoire des problèmes sexuels en France entre les années 1850 et les années 1930. Elle est aussi l’autrice d’un livre, Une rose épineuse. La défloration en France au XVIe siècle, publié en 2017.
À quel moment est apparue en France l’expression « se faire déflorer » ?
Il est difficile de dater précisément l’apparition de cette expression. Elle est dérivée du terme « défloration », attesté dans un sens sexuel (la perte de la virginité féminine) au XVIe siècle. Le terme lui-même vient du latin defloratio, lui-même issu de flos, la fleur, la meilleure partie de quelque chose. Defloratio désigne en latin l’action de prendre la fleur, de flétrir, ou, métaphoriquement, d’extraire les meilleurs passages d’un texte. Le sens figuré actuel de « déflorer », qui renvoie au fait de dévoiler quelque chose (un sujet, un thème, etc.) et par là même, de le gâcher, était donc au départ le sens premier du terme. Ce n’est que par la suite que le mot a pris une signification sexuelle.
Plus largement, la construction de l’expression « se faire déflorer » renvoie aussi à toute une conception de la sexualité et des rapports de genre qui y sont à l’œuvre. Elle participe de l’imaginaire d’hommes actifs et de femmes passives : dans cette tournure, la femme n’est pas actrice de sa propre sexualité, c’est son partenaire masculin qui agit. Tout comme pour une grande partie de notre vocabulaire sexuel : c’est l’homme qui « prend », tandis que la femme « se donne » ou « s’abandonne ».
Qu’est-ce que ce vocabulaire permet alors d’exprimer ?
L’usage sexuel du terme « défloration » est intéressant car il transporte avec lui les connotations négatives qui ont été associées à la sexualité féminine en général, et à la perte de la virginité en particulier. L’association entre la femme et la fleur est un lieu commun ancien, utilisé par de nombreux poètes pour célébrer la beauté féminine. Mais cette métaphore n’est pas toujours très bienveillante… Le terme de défloration assimile en effet la vierge à une belle fleur, et la femme déflorée à une fleur flétrie, fânée : l’entrée dans la sexualité féminine est vue de manière très pessimiste, comme une déchéance pour les femmes. En creux, l’utilisation de ce terme dit l’importance accordée à la virginité féminine.
Cette expression est-elle réservée aux femmes ?
Il existe des termes qui s’appliquent aux deux sexes, comme « dépucelage », mais le terme de défloration est uniquement féminin. Son usage croissant au cours des siècles traduit la valeur bien plus grande qui est accordée à la virginité des femmes. Cette focalisation sur la virginité féminine s’explique notamment par le fait qu’avant l’apparition de contraceptifs, elle est le moyen le plus sûr d’éviter une grossesse qui, hors mariage, aurait des conséquences sociales terribles pour une femme.
Il est intéressant de constater que les discours produits au XIXe siècle utilisent davantage le terme de défloration que celui de dépucelage : c’est déjà le cas dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert (1751-1765), qui consacre un long article au premier mais ne dit rien du second. Le Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, édité par Pierre Larousse entre 1870 et 1876, consacre un très long article à la défloration, tandis que la définition du dépucelage tient en une ligne. Les pornographes continuent à utiliser les termes de pucelage ou de dépucelage, mais l’ensemble des médecins se détournent de ce vocabulaire, et lui préfèrent celui de la défloration. Cela peut s’expliquer par le fait que prédomine, à partir du XVIIIe siècle, un modèle de la différence sexuelle au sein des discours scientifiques : les corps masculin et féminin ne sont plus pensés selon un continuum, mais comme incommensurablement différents, à tous les points de vue. Alors que les organes génitaux masculins et féminins étaient pensés en miroir, ils sont désormais pensés comme radicalement différents, et l’hymen, dont la médecine du XIXe siècle affirme l’existence chez toutes les jeunes filles, constitue de ce point de vue un organe proprement féminin, sans équivalent chez l’homme. Cette conception de la différence des sexes peut expliquer que les médecins aient choisi d’employer, pour désigner le premier rapport sexuel féminin, un terme proprement féminin : par l’emploi du mot « défloration », ils soulignent le fait que cette entrée dans la sexualité a des conséquences anatomiques chez les femmes.
Dans cette conception de la virginité, la femme perd pour toujours son innocence (qui fait son identité) au moment de son premier rapport. En même temps, il est impossible pour elle de s’accomplir autrement : ce n’est qu’ainsi qu’elle « devient femme ». Comment cette contradiction est-elle alors perçue ?
Le XIXe siècle soumet en effet les femmes à un difficile paradoxe, puisqu’il sublime l’innocence virginale tout en glorifiant la maternité. Ce n’est pas un hasard si, au XIXe siècle, on assiste à un véritable culte de la Vierge Marie (aussi appelé « mariolâtrie ») : celle-ci rassemble dans son image ces deux valeurs qui sont difficilement conciliables ! On a ainsi plusieurs cas d’apparitions de la Vierge, qui sont très médiatisées (à Paris en 1830, à La Salette en 1846, à Lourdes en 1858…), mais aussi la proclamation du dogme de l’Immaculée Conception par Pie IX en 1858, qui renforce la sainteté de Marie en affirmant qu’elle a elle-même été conçue virginalement.
Mais les conceptions virginales sont plutôt rares… et la France du XIXe siècle est de plus en plus inquiète pour son dynamisme démographique : la défaite de 1870-1871 contre la Prusse est imputée à un taux de natalité trop faible, et elle provoque une crainte de la dépopulation. On va alors encourager la maternité – et donc, indirectement, la sexualité féminine –, mais dans un cadre bien précis : celui du mariage. On assiste à ce moment à l’apparition de manuels conjugaux, petits ouvrages à mi-chemin entre vulgarisation médicale et littérature, qui érotisent la sexualité conjugale. La sexualité féminine n’est donc acceptable que si elle est étroitement contenue dans le cadre du mariage et procréative.
Vos recherches montrent tout de même que le XIXe siècle constitue un tournant dans la perception de la virginité féminine.
Le XIXe siècle est en effet un moment important dans l’histoire des représentations de la virginité et de la défloration. Pendant des siècles, c’est l’Église catholique qui a, si l’on veut, eu un certain monopole discursif sur la virginité. Depuis les origines, le christianisme a associé le corps et la chair à une culpabilité majeure ; par conséquent, la virginité, assimilée au plus haut degré de chasteté et de continence, a été érigée en une vertu cardinale, élevant l’âme humaine vers Dieu. La sexualité est donc assimilée au péché, et seul le mariage, qui a pour but la procréation, lui fournit un cadre acceptable. Au sein du cadre conjugal, la sexualité fait malgré tout l’objet d’injonctions et d’interdits très nombreux, relatifs aux temps, aux lieux, aux pratiques et même aux pensées acceptables ou intolérables. Mais alors même que les pratiques sexuelles sont étroitement codifiées par l’Église, la défloration est passée sous silence.
Ce qui est nouveau au XIXe siècle, c’est l’émergence d’un discours médical qui va se saisir de cette question de la défloration, lui donner une véritable épaisseur et la transformer en un événement décisif : déterminant pour la vie de la femme, important dans la construction de la masculinité, et crucial pour l’avenir du couple. Cette transformation des discours repose sur des évolutions propres au champ de la science médicale : l’émergence de la médecine anatomo-clinique, fondée sur une observation attentive du corps humain ; l’institutionnalisation progressive de la médecine et de la gynécologie, mais surtout, une transformation de la conception de la virginité féminine. Alors que depuis des siècles, des grandes autorités scientifiques telles qu’Ambroise Paré ou Buffon avaient soutenu que l’hymen était une pure invention, les médecins du XIXe siècle affirment son existence constante chez les jeunes filles vierges. On voit se multiplier les ouvrages qui y sont consacrés : Charles Devilliers publie en 1840 ses Nouvelles recherches sur la membrane hymen et les caroncules myrtiformes, Eugène Ledru et Félix Roze y consacrent leur thèse de médecine (respectivement en 1855 et en 1865), etc.Ils mettent tout de même en garde sur le fait que les formes de l’hymen sont très variées, que celui-ci peut se rompre sans rapport sexuel, ou au contraire persister même après l’accouchement… en bref, que l’hymen ne constitue pas une preuve certaine de la virginité féminine. Mais, plutôt que de reconnaître la diversité des situations, ils préfèrent établir l’existence de l’hymen comme une norme, quitte à lui reconnaître de multiples formes (les typologies décrivent parfois jusqu’à 13 types d’hymen) et de nombreuses exceptions. Le fait d’isoler comme un organe spécifique ce qui n’est qu’un repli de la membrane vaginale, de lui donner un nom et une signification, constitue un geste important, qui a des conséquences sur la manière de penser la virginité et la défloration.
Quelles sont les conséquences de cette conception nouvelle de la virginité et de la défloration ?
Cela accroît d’abord le contrôle pesant sur le corps des femmes et de leur sexualité : on va chercher dans des traces anatomiques la preuve d’un vécu sexuel. Le premier acte sexuel pénétratif est désormais pensé comme occasionnant une transformation physique de la femme : l’hymen est supposé se déchirer, et ses lambeaux forment ensuite des « caroncules myrtiformes ». Mais certains médecins vont plus loin, et font de la défloration un moment qui transforme le corps féminin dans son ensemble. L’entrée dans la sexualité est dépeinte dans les manuels conjugaux comme une véritable métamorphose, qui donne à la femme une vie et une santé nouvelles.
Les médecins vont aussi insister de manière croissante sur l’effusion de sang que la rupture de l’hymen est censée provoquer, mais aussi sur la douleur ressentie par les femmes lors de leur défloration. Cette dramatisation du premier rapport sexuel s’accompagne plus généralement, dans la seconde moitié du XIXe siècle, d’une remise en question du modèle éducatif féminin dominant, qui entend préserver l’innocence des jeunes filles en les maintenant dans l’ignorance en matière de sexualité. Sous la plume des romanciers, mais aussi d’auteurs d’ouvrages de vulgarisation médicale, la défloration lors de la nuit de noces est dépeinte comme un véritable traumatisme pour les jeunes femmes. Elle peut provoquer une mésentente durable dans le couple, l’infidélité de l’épouse ou encore des pathologies sexuelles – vaginisme ou frigidité. L’époux est jugé responsable du bon déroulement de ce moment crucial, et les médecins multiplient les conseils pour améliorer son comportement. Ils dénoncent la brutalité masculine et l’égoïsme des maris guidés par leurs pulsions, et appellent à un nouveau modèle de masculinité, caractérisé par une certaine vigueur, mais aussi par la maîtrise des désirs, l’empathie et la douceur envers l’épouse.
Le XIXe siècle est donc un moment important de l’histoire de la virginité et de la défloration : c’est au cours de ce siècle qu’on voit s’imposer une définition physique de la virginité, et que la défloration est conceptualisée comme un moment crucial et lourd d’enjeux.
Vous montrez aussi que cette conception de la virginité féminine se retrouve aussi bien dans le monde religieux que pornographique, scientifique que littéraire.
La virginité féminine est une thématique qui obsède en effet, au XIXe siècle, tant les médecins que les hommes d’Église, les romanciers et les pornographes. La conception physique de la virginité mise en avant par les médecins infuse progressivement le discours des hommes d’Église. René Louvel, auteur d’un Traité de chasteté datant de 1858, évoque le fait que certains hommes ne sont pas assez puissants pour « déflorer une vierge », mais peuvent cependant « se conjoindre à une femme ayant perdu sa virginité » : on retrouve ici l’idée d’une « cloison virginale » à déchirer lors du premier coït, et donc l’idée que la vierge est anatomiquement différente de la femme qui a déjà eu des rapports sexuels.
Dans les manuels conjugaux, il est assez rare de retrouver des mentions explicites de l’hymen et de sa déchirure : parce que la censure pèse sur ces ouvrages, qui risqueraient, en dépeignant trop en détail l’acte sexuel, d’être poursuivis pour outrage aux bonnes mœurs. Le style employé est généralement très lyrique et métaphorique. Mais certaines métaphores couramment employées, comme celles du « voile de l’inconnue », ou du « voile tendu devant l’innocence virginale », déchiré par le mari lors de la nuit de noces, semblent tout de même renvoyer implicitement à une conception hyménale de la virginité. Dans les romans, qui sont aussi soumis à la censure, on trouve peu de mentions de la défloration, mais celles qui existent témoignent en effet d’une imprégnation par la conception médicale de la virginité : dans L’Assommoir (1877), Coupeau dit à propos de Nana qu’il faut « se presser joliment si l’on [veut] la donner à un mari sans rien de déchiré » ; Stendhal, dans Lamiel (1889), évoque quant à lui l’effusion de sang et la douleur provoquée par la défloration.
C’est sans doute dans la littérature pornographique que l’on observe le plus l’influence de la conception anatomique de la virginité. Au fil du siècle, les scènes de défloration sont décrites avec un usage croissant d’un vocabulaire anatomique : « membrane », « hymen », « petite peau », et mentionnent fréquemment l’effusion de sang et la douleur. Toutefois, le filtre du fantasme vient exagérer les caractéristiques mises en avant par les médecins : la douleur ressentie est exacerbée, l’effusion sanguine se fait hémorragique et l’hymen, plutôt que membrane fragile, se fait « barrière résistante », « cloison » : le fantasme masculin de la défloration se pare de colorations sadiques. Toutefois, la pornographie développe aussi son propre imaginaire de l’anatomie virginale, distinct de celui des médecins : elle insiste en effet bien davantage sur l’étroitesse vaginale des vierges, supposée procurer un plaisir sans égal, que sur l’hymen.
Est-ce qu’on retrouve encore aujourd’hui cette conception de la virginité féminine ?
Les significations sociales et culturelles de la virginité féminine ont sans aucun doute évolué depuis le XIXe siècle. L’accessibilité croissante à la contraception, via sa légalisation dans les années 1960 en France, a permis aux femmes de vivre une sexualité préconjugale sans la « peur au ventre », c’est-à-dire sans crainte de tomber enceinte. Pour autant, je ne sais pas si on peut dire que la question de la virginité féminine a totalement perdu son importance aujourd’hui. J’aurais plutôt tendance à dire que ses significations se sont reconfigurées.
Si la sexualité féminine préconjugale est socialement plus acceptée qu’autrefois, l’aura de la virginité n’a pas totalement disparu : le lien fait entre l’honneur d’une femme et ses pratiques sexuelles ne me semble pas totalement défait, et le slutshaming semble avoir encore de beaux jours devant lui… On observe des résurgences très contemporaines de l’importance de la virginité, motivées par des raisons religieuses ou par un rejet de l’hypersexualité qui caractériseraient nos sociétés contemporaines (les mouvements évangélistes américains comme True Love Waits qui prônent la virginité jusqu’au mariage, par exemple).
Le premier rapport sexuel me semble encore cristalliser des questionnements et des angoisses individuels, qui sont en partie liés à la permanence de représentations anciennes. L’idée d’un hymen qui se déchire, de l’effusion de sang et de douleur sont encore très présentes dans les productions culturelles, malgré l’effort porté par certain·e·s féministes pour déconstruire ces représentations. Le recours croissant à l’hyménoplastie, chirurgie réparatrice de l’hymen, révèle aussi la prégnance de l’idée d’une virginité anatomique.
Les expressions « première fois » et « dépucelage », qui se sont désormais imposées, vous semblent-elles moins problématiques ?
Je ne sais pas si ces expressions sont problématiques ou pas ; je dirais en tout cas qu’elles sont toutes porteuses de significations particulières. Le terme de défloration renvoie ainsi exclusivement au féminin, avec une connotation plutôt négative, et, comme certaines expressions anglaises (« to pop the cherry », par exemple), à l’idée d’un acte plutôt violent, consistant à déchirer une membrane, ce qui est inexact. Il me semble que le terme de « dépucelage », qui peut être appliqué aux deux sexes, est aujourd’hui plus fréquemment utilisé pour parler des hommes : si autrefois, le pucelage était l’apanage du féminin (qu’on pense au surnom de Jeanne d’Arc, la « Pucelle d’Orléans »), j’ai l’impression qu’on parle aujourd’hui plus aisément de « puceau » que de pucelle, et que donc, le terme renvoie davantage au masculin. Et à mon sens, il est loin d’être neutre : on l’utilise souvent comme une insulte, le puceau étant déprécié ou moqué pour son inexpérience sexuelle. Il est intéressant de remarquer que ce gendering des termes varie selon les contextes nationaux : en France, le substantif « vierge » renvoie quasi exclusivement à des femmes, tandis qu’en anglais, « virgin » est davantage utilisé de manière indifférenciée.
Quant à l’expression de « première fois », elle a au moins le mérite d’être égalitaire du point de vue du genre, et de ne pas avoir une charge négative : elle souligne davantage l’entrée dans la sexualité qu’elle ne marque la perte de la virginité. Elle contribue malgré tout à sacraliser et/ou dramatiser le premier rapport sexuel, avec tout ce que cela peut créer de pressions sociales et d’appréhensions. Elle fait perdurer l’idée d’un avant et d’un après le premier rapport sexuel, bien visible dans le slogan français du teen movie After, sorti au printemps 2018 au cinéma : « On n’oublie jamais sa première fois ».
Revenons-en à vos recherches. Comment expliquer que les discours des médecins de l’époque aient été autant imprégnés par des considérations morales ?
Les science studies et la critique féministe des sciences ont beaucoup travaillé sur cette question, et ont montré que la science, loin d’être détachée du reste du monde, constituait un ensemble de pratiques et de discours devant être réintégrés dans la culture au sein de laquelle ils sont produits. Anne Fausto-Sterling, dans Myths of Gender (1985), s’est par exemple intéressée à la manière dont la biologie conditionnait les comportements sociaux tout en étant elle-même conditionnée par les normes sociales. On pourrait aussi évoquer les travaux d’Emily Martin, qui montre comment les récits scientifiques de la fécondation de l’ovule par le spermatozoïde sont empreints de stéréotypes de genre et reproduisent les imaginaires sociaux du prince secourant une demoiselle en détresse, ou au contraire de la femme fatale piégeant l’homme. Les discours scientifiques, malgré leur prétention à l’objectivité, ne naissent pas hors sol, mais bien dans une société et une culture qui les imprègnent.
Les discours médicaux du XIXe siècle portent ainsi l’empreinte des normes morales en vigueur dans la société française de cette époque, et ils contribuent à leur donner un soubassement scientifique. Ils traduisent l’importance sociale de la virginité lorsqu’ils décrivent la défloration comme une flétrissure de l’ensemble du corps féminin ; ils contribuent à légitimer cette norme en affirmant que la virginité a des effets bénéfiques sur la santé. C’est cette porosité du discours médical aux idées de son temps qui explique certaines contradictions à l’œuvre en son sein : lorsque l’angoisse de la dépopulation se fait jour à la fin du XIXe siècle, certains médecins vont au contraire décrire la virginité prolongée des femmes comme mauvaise pour leur santé, et faire de la défloration une panacée guérissant la jeune vierge de tous les maux qui la guettent : indispositions, vapeurs, éruptions cutanées, etc.
Un autre exemple de cette influence des normes sociales de l’époque est la référence constante au modèle conjugal. Les exemples de défloration choisis par les médecins concernent en général des personnes mariées. Georges Cuvier, dans le Dictionnaire des Sciences médicales (1812-1822), définit ainsi l’hymen comme une membrane qui se rompt « au moment de la consommation du mariage », ou comme une « fleur que cueille l’époux lors des premiers embrassements ». Ce faisant, les médecins traduisent un fait social majoritaire, mais contribuent aussi à l’ériger en norme.
Ce sujet a jusque-là été assez peu étudié en France. Comment l’expliquez-vous ?
On pourrait plaider pour le manque de sources : les études historiques seraient peu nombreuses car, contrairement aux sociologues, les historien·ne·s ne peuvent pas susciter leurs sources. L’histoire de la virginité et de la défloration aurait donc pâti d’un déficit de sources pour documenter ces questions. Mais les historien·ne·s savent rivaliser d’ingéniosité pour trouver des sources susceptibles de répondre aux questions qu’ils et elles posent au passé, et les sources ne manquent pas pour écrire une histoire des représentations et des imaginaires de la virginité ou de la défloration. Et de nos jours, on peut difficilement accuser la discipline de négliger l’histoire de la sexualité ; les historien·ne·s s’en sont saisi depuis plusieurs décennies. Toutefois, la manière dont ce champ s’est construit, en étroite collaboration avec des mouvements militants, peut fournir une piste d’explication : l’histoire de la sexualité s’est beaucoup intéressée à l’homosexualité et à sa répression, à l’invention des « perversions », et a laissé de côté l’hétérosexualité majoritaire et plus ordinaire.
Plus largement, je pense que la virginité et la défloration ne se sont imposées comme des sujets d’histoire que récemment, sans doute parce qu’on considérait que ces notions étaient dépassées en Occident depuis la « révolution sexuelle » des années 1960, qui les aurait définitivement réglées. La virginité, c’était, en quelque sorte, le problème des autres – et notamment des cultures musulmanes. La question de la virginité féminine et de sa perte a en effet été beaucoup étudiée par des ethnologues ou des sociologues, dans des contextes musulmans (voir Fatima Moussa, Abdelwahab Boudiba), mais aussi parmi les diasporas nord-africaines (voir Nacira Guénif-Souilamas, Christelle Hamel) ou les populations roms (Claire Cossée).
Mais des phénomènes plus récents sont venus redonner une actualité à ces sujets : des purity rings des évangélistes américains à la médiatisation autour de jeunes femmes vendant aux enchères leur virginité, en passant par les revendications d’asexualité, l’augmentation des hyménoplasties, ou encore, tout récemment, le scandale provoqué par le rappeur T.I. qui a annoncé sur internet qu’il faisait certifier chaque année par un gynécologue la virginité de sa fille… Tout cela a contribué à remettre sur le devant de la scène ces questions, et a sans doute suscité l’intérêt des historien·ne·s. Plusieurs travaux se sont d’ailleurs intéressés récemment à l’histoire de la virginité : Anke Bernau a écrit une histoire culturelle de la virginité (Virgins. A Cultural History, Londres, Granta Books, 2007) ; Yvonne Knibiehler a consacré un livre à la virginité féminine (La Virginité féminine. Mythes, fantasmes, émancipation, Paris, Odile Jacob, 2012), et Alain Cabantous et François Walter viennent d’écrire Les Tentations de la chair (Paris, Payot, 2020), qui retrace l’histoire de la virginité et de la chasteté masculines et féminines du XVIe au XXIe siècle.
La plupart des sources historiques sur le sujet ont été écrites par des hommes. Que sait-on de la manière dont les femmes percevaient à l’époque leur propre virginité ?
C’est un problème qui se pose à tou·te·s celles et ceux qui veulent écrire l’histoire des femmes : les sources écrites par des hommes ne nous renseignent-elles pas uniquement sur les représentations qu’ils ont des femmes, et pas sur les femmes elles-mêmes ? S’il faut avoir conscience de ce biais, je pense que l’étude de ces discours masculins sur les femmes est utile, dans la mesure où ils sont producteurs de normes, et que ces normes modèlent, à des degrés variables, l’expérience, le vécu des femmes et les représentations qu’elles ont de leur sexualité.
Pour autant, j’ai essayé dans mes recherches de m’intéresser aussi aux pratiques, et donc de traquer la parole des femmes à ce sujet. Anne-Marie Sohn a montré l’usage que l’on pouvait faire des archives judiciaires, qui donnent accès à la voix des oublié·e·s de l’histoire, et qui révèlent des informations importantes sur la vie privée, la sexualité, etc. On peut aussi s’intéresser aux écrits du for privé – mémoires, journaux intimes ou correspondances – pour tenter de saisir comment les femmes se représentaient leur virginité et ont vécu leur sexualité. Mais ils sont rares, souvent produits par une fraction favorisée de la population, et en aucun cas représentatifs de ce que pensaient ou vivaient l’ensemble des femmes. Pour autant, ces cas particuliers permettent d’enrichir une histoire de la défloration, comme autant de configurations, de modulations spécifiques d’une histoire plus générale. Les écrits des jeunes femmes révèlent le peu d’éducation sentimentale et sexuelle féminine, leurs craintes face à la nuit de noces, parfois la déception causée par l’entrée dans la sexualité, etc. Les écrits masculins témoignent des fantasmes entourant la virginité, des appréhensions face au rôle qu’ils ont à jouer dans la défloration et du poids des injonctions à la performance qui pèsent sur eux.
L’entretien a été mené par Paul Tommasi.
 Les discriminations – comme les
Les discriminations – comme les