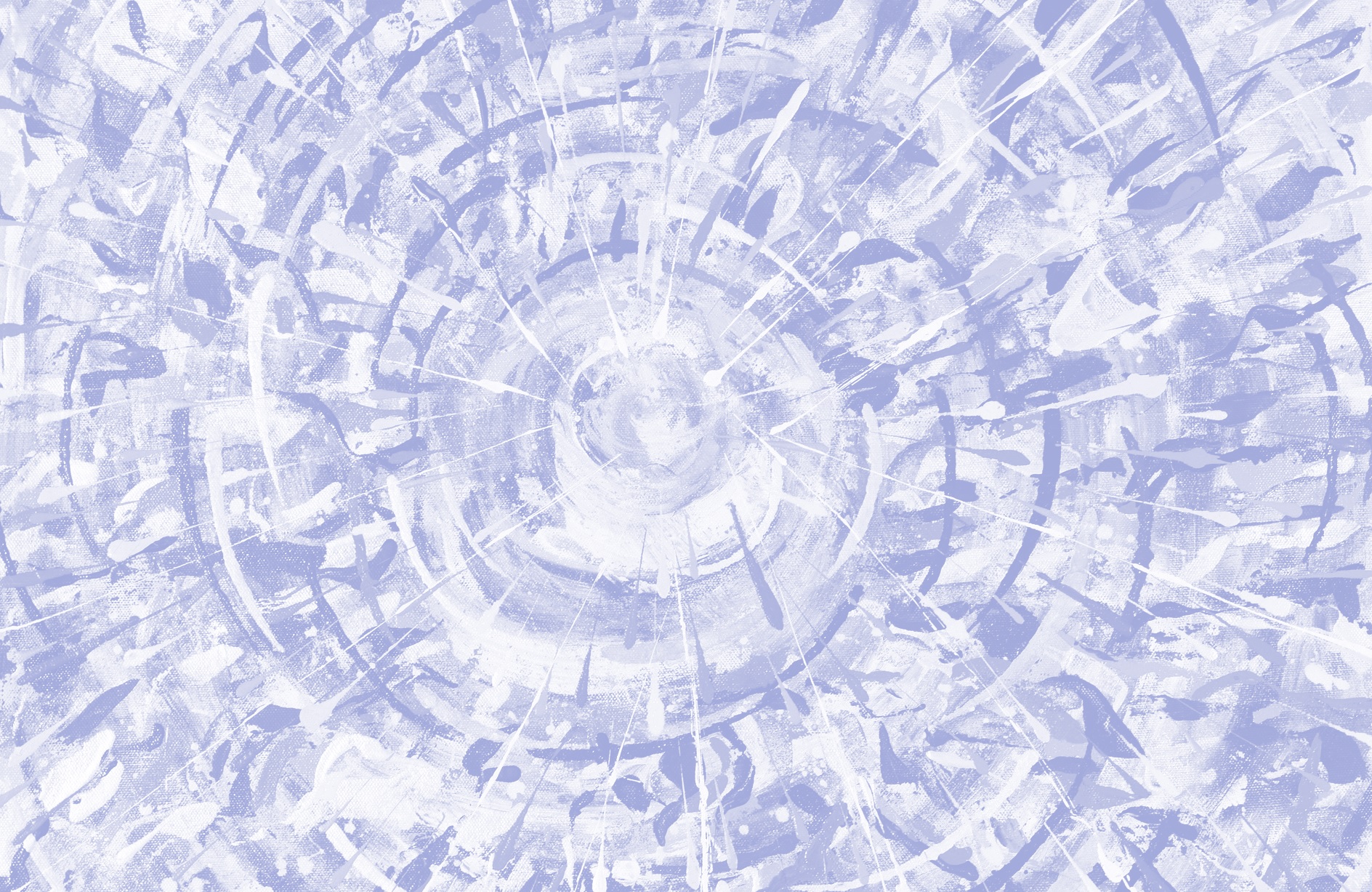Tu as préparé les documents nécessaires pour l’inscription de ton fils cadet au collège. Ton mari n’a plus qu’à les apporter à l’école. Tu as insisté sur le fait qu’il y a une erreur dans l’adresse, la directrice doit rectifier. D’habitude c’est toi qui t’occupes de ce genre de choses mais, ce matin-là, tu emmènes ton fils chez le médecin. C’est donc lui qui s’en charge. Tu ne t’inquiètes pas, il s’agit d’une formalité.
Tu rentres à la maison avant lui. Il arrive peu après le sourire aux lèvres, finalement, il s’agit bien de la bonne adresse. Tu réponds interloquée, non, bien sûr que non, l’adresse n’est pas la bonne. Il te fusille du regard et repart en claquant la porte. Il te maudit, ça résonne dans la cage d’escalier. Tu te figes. S’il t’avait laissé le temps, tu lui aurais proposé d’appeler la directrice. Lui expliquer le problème au téléphone, c’est ce qui semblait le plus pratique, le plus logique. Lorsqu’il revient, il affiche un air triomphal, j’avais raison, il n’y a pas d’erreur, l’adresse est valide. Tu t’excuses, ça arrive à tout le monde de se tromper, mais pourquoi repartir aussi vite, aussi fâché, en claquant la porte ? Il s’énerve, il crie, ah parce que c’est de ma faute maintenant ?
Depuis le temps, tu devrais être aguerrie. Mais non, tu restes médusée. Tu secoues la tête d’un air désespéré. Ce geste, lui, ça l’exaspère. Sa colère grandit. Il t’invective. Qu’il se mette dans cet état pour une histoire aussi futile, qui aurait pu être réglée en trois minutes, tu n’en reviens toujours pas. Tu dis, mais pourquoi tu cries ? Pourquoi ? C’est la question qui te taraude. Pourquoi ? Pourquoi tu cries ? Le fait que tu lui demandes des comptes ne fait que l’agacer davantage. D’ailleurs il le dit souvent. Que tu es en quelque sorte programmée pour envenimer les choses. Une harpie. Une mégère. Quand il dit ces mots, son regard n’est que dégoût et répulsion. Tu devrais te taire mais tu répètes, pourquoi tu t’énerves comme ça ?
À présent il marche de long en large dans le salon, il te jette des yeux noirs comme si tu étais le diable, il vitupère, donc c’est moi qui ai un problème, c’est ça ? C’est moi qui suis maboule ? Cette faculté que tu as de te dédouaner, grandiose, grandiose, grandioooooooose, non mais je rêve ! Il te suit dans la cuisine. Tu tentes tant bien que mal de préparer le déjeuner. Il te transperce de ses yeux noirs. De voir tant d’animosité dans ses yeux, de la haine à l’état pur, tu ne sais plus quoi dire. Est-ce possible tant de haine ? Tu devrais t’éloigner. T’enfermer dans la chambre. À la place, tu dis des mots que tu ne devrais pas dire, tu dis, t’es dingue, t’es vraiment dingue, tu devrais te faire soigner. Il s’approche, son hostilité déborde, les yeux noirs, la rage aux lèvres. La haine s’est installée dans tout son corps. Avec toute cette haine qu’il dégage, à l’évidence, ce qu’il veut, c’est te tuer. Tu l’imagines prendre le couteau de cuisine, celui qui est dans le tiroir, là, à portée de main, et te transpercer. D’imaginer cette scène, ça devrait te porter au silence. Au lieu de quoi, tu répètes, t’es complètement dingue, dingue, dingue ! Il te plaque contre l’angle du mur de la cuisine. Tu ressens un petit choc derrière le crâne. Il étreint ton cou avec ses deux mains et te maintient au mur. Une part de toi n’y croit pas, d’en arriver là, c’est trop énorme, ce genre de chose n’arrive que dans les films, sinon pourquoi dirais-tu des mots que tu ne devrais pas dire, le genre de mots qui attisent la haine, alors vas-y, tue-moi, si c’est ça que tu veux, tue-moi.
Maintenant tu es allongée sur le dos, il est sur toi, les deux mains sur ton cou. Tu ne sais pas comment c’est arrivé. Tu te vois du dehors. D’en haut. Sur le carrelage ocre et froid. Votre fils à côté pleure en criant arrêtez ! arrêtez ! Qu’il utilise la deuxième personne du pluriel, ça t’interpelle, tu te demandes pourquoi il ne dit pas « arrête » à son père, pourquoi il vous dit d’arrêter à tous les deux. Tu penses que c’est parce que tu n’as pas su te taire. Voilà ce que tu penses tandis que tu te vois, et que tu vois ton fils, depuis le plafond de la cuisine où tu es suspendue. (Mais lui, non, tu ne le vois pas : lui, bizarrement, il est absent.)
Tu vas mourir. C’est la suite logique des choses. Le temps forme une bulle suspendue, comme toi, en dehors, au-dessus. Tout est très net, et en même temps très flou. Il y a l’éblouissement, le blanc de la neige, rapide, bref, comme si tu étais tombée dans une crevasse, puis l’ombre bleutée des profondeurs qui étend ses ailes, lourdes, pesantes, et te recouvre lentement, délicatement, avec une tendresse mortelle. Tu entres dans quelque chose de ouaté, un grand silence bleu. Tu vas mourir. Que l’existence tienne à ce genre de détail ridicule – une fichue adresse –, ça te fera peut-être rire, un jour, quand, dans les limbes, tu te remémoreras ta vie. Mais, pour l’instant, mourir étranglée, sur le carrelage ocre et froid de la cuisine, devant ton fils, ça t’emplit d’un frisson couleur cobalt.
La scène défile en accéléré. Les choses ont dérapé mais quand ? Tout s’est enchaîné si vite. Il a les mains sur ton cou. Tu te vois, tu vois ton fils, mais lui, tu ne le vois pas. Et maintenant c’est figé. Maintenant rien ne bouge. Te voilà sur le dos, il a les mains sur ton cou, dans la crevasse bleue. Tu cries au-secours. D’entendre ta voix, ça donne une impulsion. C’est donc que tu n’es pas morte ? Pas morte ? Ça tient à quoi ? Il aurait pu mais il n’a pas serré, allez savoir ce qui s’est passé dans sa tête. Il se redresse. Toi, tu es comme dans un rêve. Ta vision est ronde, courbe, veloutée. Les coins des murs, des portes, des meubles glissent, tu tangues comme un bateau. Ensuite tu sers le repas. Entre les deux, tu ne te souviens plus. À table, la première chose qu’il dit, c’est que si tu t’étais tue, rien ne serait arrivé, ah si tu avais pu te taire au lieu de faire monter la sauce, la prochaine fois, je t’en prie, chérie, tais-toi, mais tais-toi donc…
Plus tard, vous décortiquez tous les deux la scène. Il s’excuse, la violence physique, plus jamais. Tu analyses dans le détail l’enchaînement des faits. Tu aboutis à la conclusion que, lors d’une crise, tu dois laisser passer l’orage. Te taire. Disparaître.
Plus tard encore, vous apprenez que c’est toi qui avais raison : ce n’était pas la bonne adresse.
Plus tard encore, il te reproche de ne plus l’aimer, tu es distante, on dirait que tu ne m’aimes plus. Tu ne veux pas remuer cette matière brûlante, c’est encore trop présent, trop douloureux, alors tu restes évasive. Comme il insiste, tu finis par admettre que tu ne peux pas oublier, ce qui s’est passé, ça ne s’efface pas d’un coup de baguette magique, j’ai du ressentiment, je n’y peux rien, ça reste, c’est comme ça. Il te regarde d’un air de petit garçon, ah bon ? Pourtant, comme tu avais compris ce qui se passait dans ma tête, je pensais que… Donc tu m’en veux encore ? Vraiment ?
***
Ton frère se marie. Les festivités ont lieu au nord de la France. Vous dansez tard. Au milieu de la nuit, tu conduis jusqu’à l’hôtel. C’est toujours toi qui prends le volant, c’est pratique parce que tu ne bois presque pas. Il est supposé t’indiquer l’itinéraire mais il se trompe. Tu prends une bretelle d’autoroute contre son avis. Tu as vu juste, vous voilà à l’hôtel. Vous dormez tous les quatre dans la même chambre. Les enfants plongent illico dans le sommeil. Il ronfle. Tu lui touches le visage. En retour, tu as droit à un petit coup de poing, c’est pas méchant mais c’est pas agréable, putain, tu fais quoi ? Tu vas polluer ma vie comme ça longtemps ? Salope !
La litanie des insultes. Ça dure des heures, des saillies marmonnées, une flopée d’injures grommelées, putain, sale chienne, t’as qu’à crever ! Tu fais semblant de dormir. La tête dans l’oreiller, tu pleures sans bouger. Tu imagines que tu es ailleurs. Loin, très loin. Voilà, il dort. Tu le déduis du silence et de sa respiration régulière. Mieux vaut ne pas remuer. Tu respires à peine. Soudain tu as chaud alors tu agites un peu les jambes, tout doucement. Il tire sur la couette, on dirait qu’il n’attendait que ça. De nouveau il crache le fiel entre ses dents, connasse ! Ton frère se marie, alors tu t’y crois, c’est ça ? Tu t’évertues à ne pas écouter. Tu voudrais mourir. Tu ne dors pas. Même quand il s’assoupit enfin, tu ne dors pas. Trop de chagrin, trop de colère, trop de tout. Il faut que tu le quittes, n’est-ce pas ? Sale chienne, t’as qu’à crever.
Tu te lèves aux aurores. Sans bruit, tu quittes l’hôtel. Tu tournes un peu dans la petite ville sans âme dont tu as oublié le nom, achètes une viennoiserie à la boulangerie, puis déniches un café terne à l’angle de feux de circulation inutiles. Il fait froid. Il faut que tu le quittes. N’est-ce pas qu’il faut que tu le quittes ? Sinon quoi ? Est-ce que tu peux continuer à vivre ainsi ? Sale chienne, t’as qu’à crever, et puis rien.
***
Les dernières semaines ont été tendues, mais la journée s’est bien passée. En tout cas, mieux que les jours précédents. Pas de dispute. Le soir, à table, ton cadet gigote sur la chaise, il pose sa tête sur son coude, la main droite et les cheveux dans l’assiette. Tu lui dis de se tenir mieux. Trois fois. La troisième fois, il sort de table en criant casse-toi. Tu lui dis qu’il n’a pas le droit de te parler de la sorte, tu confisques son portable, puis tu te tournes vers ton mari, tu pourrais peut-être dire quelque chose, notre fils vient de me dire casse-toi ? Il hurle, ambiance de merde, repas de merde ! Tu vas me dicter ma conduite longtemps ? Tu vas nous pourrir la vie jusqu’à la fin de tes jours ? En face, ton fils aîné te lance, tu vois pas que tu fous la merde. Tu le regardes interdite, puis tu regardes ton mari, voilà pourquoi je veux te quitter. Il se lève en hurlant, quoi ? Tu veux me quitter ? Après tous les efforts que je fais !
Tu me tues !
Je vais me suicider !
Dégage et reviens plus !
Dégage, dégage, dégage, prends tes affaires et dégage !
Je vais fumer, quand je rentre, t’es plus là ! Dégage !
Il claque la porte derrière lui, ça fait trembler tout l’étage. Les enfants pleurent. Tu les rassures, ça va aller. Tu prépares ta valise, ça va aller. Tu essaies de te convaincre toi-même. Ta tête fonctionne impeccablement, cependant tu es comme à côté de toi-même, tu te regardes faire dans une lumière blanche qui exacerbe tes gestes. Tu n’oublies rien. Ni tes lentilles de contact, ni ta clé USB. Tu te tiens devant la porte, ta valise à la main, tandis qu’il franchit le seuil de chez vous et se jette sur le canapé du salon. Tu hésites. Tu demandes, qu’est-ce que je fais ? Il pleure. Tu es prête à le consoler. Il reste muet alors tu dis, tu es violent, tu es un homme violent. Il se redresse. Il hurle à nouveau. Tu franchis la porte.
Tu as franchi la porte.
Dans le miroir de l’ascenseur : je suis / cette femme / qui part.
Tu scrutes le reflet de ton visage : cette femme / qui part / c’est moi.
Tu sors de l’immeuble. Les yeux secs, tu avances dans la rue en tirant ta valise à roulettes. C’est fini. Plus jamais ça. Plus jamais. Jamais. Plus jamais ça. Jamais.
***
Jamais tu n’aurais imaginé vivre ça.
Entrer dans un commissariat et déposer une main courante.
Une main courante contre lui.
(Tu as écrit main courage avant de corriger.)
Ce sont tes amies qui t’ont conseillée, pour que tu ne sois pas accusée d’abandon du domicile conjugale. L’une d’elles s’est rendue disponible. C’est un samedi, ça fait six jours qu’il t’a mise à la porte. Depuis, tu es hébergée à droite, à gauche. Le commissariat le plus proche de l’endroit où tu as dormi est fermé, alors vous marchez jusqu’à celui de l’arrondissement d’à côté. Toi en somnambule, comme si tu avais passé une nuit blanche. Depuis que c’est arrivé, tu vis au jour le jour. À l’instinct. Une chose après l’autre. Tu es dans un état second. À deux doigts de te désagréger. La veille, tu as pris le premier somnifère de ta vie, cela suffit-il à expliquer que ce matin tu chancelles ?
Tu n’as rien préparé, rien anticipé. À l’agent de police, tu exposes les faits en balbutiant, dégage, dégage, dégage, prends tes affaires et dégage. Tu donnes quelques éléments de contexte. La scène dans la cuisine. Les insultes. Le poids des mots, soudain, face à la police. Tu réalises. Ta gorge se noue. Les larmes t’engloutissent.
L’agent dit, Madame, la loi interdit ce genre de violences.
Il te tend des documents relatifs aux violences conjugales. Tu le regardes interloquée.
L’agent dit, Madame, vous pourriez porter plainte.
Ton cerveau se fendille. Se dérobe le sol sous tes pieds.
***
À 9h, tu es devant le commissariat. La policière robuste et pâle te reçoit dans un petit bureau sans fenêtre, pas celui où tu as déposé la main courante, un autre, au fond. Porter plainte, c’est ta décision. Tu l’as prise dans la nuit. Voilà pourquoi tu es seule ce matin. Porter plainte, c’est ce que tu dois faire. Tu dois. Te protéger. Tu dois. Faire en sorte que ton mari cesse de rejeter la faute sur toi. Tu dois. Agir pour que tes enfants ne reproduisent pas la violence une fois adultes. En trois semaines, tu as eu le temps de comprendre des choses. Pas tout. Mais certaines choses. Tu as repéré des mécanismes. Des répétitions. Tes yeux commencent à se dessiller. Porter plainte, c’est ta décision. Tu veux t’en sortir, c’est ça qui te rend forte. Cependant, tu ne sais pas où tu vas, alors tu doutes. À chaque instant, tu doutes. Si tu te bats, c’est parce qu’en toi il y a un élan. Quelque chose qui te pousse à avancer. Tu découvres que tu as envie de vivre. Et à présent tu es là.
Tu es là, au commissariat, alors il faut dire. Tu essaies de dire. Dire. Les violences verbales. La maltraitance psychologique. À cet instant, c’est ça qui t’importe. Cette violence-là. Celle qui durait depuis des années. Celle qui faisait que tu te détestais. Celle qui t’avait fait intégrer que tu étais une merde sale chien t’as qu’à crever connasse. Mais la policière te scrute de ses yeux délavés, enfin, Madame, vous n’allez pas porter plainte pour ça. Aussitôt tu te recroquevilles sur ton sac à main, tu bredouilles, on m’avait dit que… dans ce cas, je… je… Tu essaies de te lever mais ton corps ne répond pas. L’ordinateur vrombit, la policière fixe ton visage, puis son écran, puis ton visage, puis son écran. Alternance fantomatique. Elle tire ses épaules en arrière en soupirant, bon, vous avez parlé de placage au sol ? Allez-y, je vous écoute.
Tu serres ton sac contre toi. À travers les larmes, le bureau laiteux, liquide, fade, abîmé comme les cheveux ternes de la policière. Allez-y, je vous écoute. Ce que tu fais ici, soudain, tu n’en es plus très sûre. Mais tu es là, donc il faut bien. Tu te redresses un peu. Un tout petit peu. Le plus dur, c’est de commencer. Ta voix est mal assurée, néanmoins tu racontes la scène dans la cuisine. S’en tenir au fait. Il crie. Il te plaque contre le mur. Il te plaque au sol. Les mains sur le cou. Tu ne sais pas si tu dois en dire plus. Mais tu es là, à présent, alors tu laisses venir les souvenirs et tu dis. Tu dis la nuit d’insultes lors du mariage de ton frère. Tu dis. Pas tout mais tu dis. Tu dis qu’il y a eu d’autres insultes, d’autres crises, à d’autres moment. Tu dis en te demandant si tu es assez précise. Tu as peur de te perdre dans les détails, ou alors d’être trop superficielle. Tu as le sentiment de te plier à un exercice codifié dont les règles t’échappent. L’agente de police t’enjoint de répéter certaines phrases, ou alors elle reformule à haute voix ce qu’elle inscrit sur son formulaire numérique. Comme à chaque fois que tu racontes l’histoire, ton histoire – est-ce la troisième, la quatrième fois depuis qu’il t’a mise à la porte ? –, tu te noies. Les mots arrivent et le monde s’écroule autour de toi. C’est toujours avec la même intensité que tu débites les événements. Exposer le passé décuple – décuple la douleur. Tu as dilué ton chagrin des années durant dans l’illusion que tout irait mieux, que vous trouveriez une solution, qu’avec du dialogue et de l’intelligence votre couple évoluerait positivement. Tu réalises que tu t’es voilée la face.
Tu émerges. De l’endroit des souvenirs douloureux, tu émerges, étourdie, surprise de retrouver le bureau sans âme et la policière maussade. Qui se détend, ébauche un sourire. Bientôt la pause. Tu dis, j’ai trouvé un studio, par une amie, pas cher. C’est alors qu’il y a un chuintement. Comme un pneu qui se dégonfle. Le. Visage. De. La. Policière. Se. Décompose. Merde ! Mon ordi ! Elle tape sur la machine. Disparaît sous la table. Réapparaît. Des éclairs de détresse plein les yeux, putain, une heure de travail et pchiitt ! J’ai rien sauvegardé ! Tu ressens une angoisse froide entre tes omoplates, mais quelque chose te retient au bord de la panique. En même temps, elle restait à l’extérieur, en observatrice, cette phrase de Virginia Woolf, celle que tu lis et relis depuis trois semaines, à la page 68 de Mrs. Dalloway, te submerge. Tu attends. Dodeline le destin. Droite. Gauche. Filent en étoile – les pensées. Crache la lave – le temps. Quand la fatalité tient à quelques particules électriques, le sort, c’est quoi ? La providence reprend son souffle. L’écran se rallume. Ainsi soit-il. Ta plainte est enregistrée.
***
Tu expérimentes le fait de ne plus te regarder systématiquement à travers ses yeux à lui. Tu te réappropries ta version des événements, stupéfaite de constater combien tu as été capable de la minimiser, et même de la nier, de crainte de sombrer dans la complaisance. Tu tentes de décortiquer les rouages qui t’ont amenée à démolir ce que tu ressentais, à déprécier tes jugements, à dévaloriser tes émotions – il te faudra néanmoins davantage que quelques semaines pour apprendre à t’aimer. Certaines paroles qu’il a prononcées t’ont atteinte bien plus profondément que tu ne le pensais. Après chaque crise, la vie reprenait son cours, tu refusais de voir que les phrases assassines, les insultes, le dénigrement laissaient des traces. Il se peut même que tu t’enorgueillisses de croire que tout cela glissait sur toi.
***
Hôtel-Dieu. Tu attends l’heure de ton rendez-vous à l’Unité médico-judiciaire dans la grisaille à côté de trois voitures Vigipirate. La proximité de l’hôpital et de Notre-Dame, des malades et des touristes, te tourne un peu la tête. Tout devient intense et triste. Les moineaux picorant à tes pieds. Le souffle du vent sur ta peau. La lumière terne piquetée d’éclats jaunes. Le granulé du bitume comme un paysage cramé dont tu es sûre, soudain, qu’il abrite quantité d’êtres minuscules bien plus essentiels que toi. Les événements des dernières semaines, des derniers mois, des dernières années défilent comme s’ils étaient gravés au cœur du goudron craquelé et humide. Dans les fissures, les crevasses, la moindre craquelure, te voilà qui t’infiltre à ton tour, pénétrant dans les interstices de l’asphalte là où se logent les nuits d’insultes, le placage au sol et la détestation de soi – tu deviens le macadam des violences subies.
Tu pensais raconter ton histoire, toute ton histoire, mais ce qui intéresse la jeune psychiatre de l’Unité médico-judiciaire, ce sont les conséquences des faits mentionnés dans ta plainte. Les conséquences ? Tu cherches où poser ton regard, mais il n’y a aucun point de fuite dans cette petite pièce qui ressemble plus à une chambre de bonne qu’à un cabinet médical. Les conséquences ? La psychiatre te parle d’après, alors que tu voudrais parler d’avant. Remonter à la source. Faire le récit des mille et une étapes. Expliquer pourquoi tu es là aujourd’hui. Les conséquences ? Tes oreilles bourdonnent. Tu fouilles dans ton sac à la recherche d’un mouchoir, essuies tes yeux, marmonnes des excuses. La psychiatre est décontenancée. Il te vient à l’esprit – quel âge a-t-elle ? vingt-cinq ans ? – que c’est sa première consultation.
Peut-être que vous pourriez commencer par me parler de l’impact de l’acte de violence physique ? Tout s’éclaire : les mille et une étapes, ça ne rentre pas dans sa grille. Les « salope » et les « connasse », les « j’en ai rien à foutre de ce que tu dis », les regards de haine, ce n’est pas répertorié. En revanche, un placage au sol, une tentative d’étranglement, oui, évidemment, ça coche les cases. Ce que la psychiatre ne saisit pas, ce que tu as toi-même du mal à formuler, c’est que la scène dans la cuisine n’est que la partie émergée de l’iceberg. Tu aimerais faciliter le travail de la jeune psychiatre, au lieu de quoi, tu t’égares dans des vétilles tout en répétant que tu es navrée de te répandre de la sorte – les pleurs et le reste. La psychiatre prend un air contrit, je vais quand même devoir vous poser quelques questions, finit-elle par dire en indiquant du menton le questionnaire sur son ordinateur. Lorsque votre mari vous a plaquée au sol, avez-vous eu peur de mourir ?
– Je me voyais par au-dessus, je regardais la scène d’en-haut, il aurait pu serrer et…
– Avez-vous eu des troubles du sommeil ?
– Oui. Ceci dit j’ai des problèmes de sommeil depuis des années…
– Avez-vous fait des cauchemars ?
– Non.
– Avez-vous eu des troubles de l’appétit ?
– Oui mais j’ai un appétit d’oiseau, rien d’inhabituel.
– Avez-vous eu des difficultés de concentration ?
– Non. Enfin si. C’est pas évident de se concentrer quand la scène repasse en boucle dans sa tête…
Soumise à la moulinette du protocole psychiatrique, ton histoire rentre dans la grille d’évaluation standardisée. Grâce aux croix dans un formulaire, la jeune psychiatre t’attribue cinq jours d’incapacité temporaire de travail, ou ITT, un acronyme t’évoquant jusque-là des affaires « sérieuses », genre violences policières ou agression sexuelle. Elle explique, ces cinq jours correspondent aux répercussions du placage au sol. Pour le reste, la maltraitance psychologique qui durait depuis des années, je vais demander une expertise. Une expertise ? Devant mon visage décomposé, la psychiatre me rassure, le juge décidera, ça risque de prendre un peu plus de temps mais ce sera un appui en vue du procès.
***
Émergeant du parvis gorgé de lumière, les blocs géants du tribunal de Paris flamboient dans un miroitement métallique. Ton opinel fait les frais du portique de sécurité, confisqué, Madame, un couteau, c’est une arme, mais tu refuses d’y voir un mauvais présage. Le hall ressemble à un hall d’aéroport avec sa lumière bleue, ses escalators, ses sièges en plastique et sa cafétéria. Sixième étage, les sept salles d’attente languissent en enfilade. Tu as rendez-vous dans la troisième pour l’ordonnance de non-conciliation qui fixera des mesures provisoires jusqu’au divorce. Il est là. C’est idiot mais tu ne t’attendais pas à le voir. Tu articules un bonjour du bout des lèvres, puis tu rejoins ton avocate un rang plus loin. Tu optes pour une attitude froide et distante, toute autre conduite te semblerait grotesque et déplacée. Son avocate est en retard. Tu désertes le huit clos pesant de la salle d’attente au profit du hall bleu, aseptisé et sans charme du rez-de-chaussée avec ses rumeurs judiciaires et son froufrou de robes noires. Une assistante sociale relate d’une voix puissante la situation d’une famille suivie pour des faits de violences conjugales. Tu changes de place. Tu attends. Tu attends. Tu attends. Ta tête vide – pourrait – éclater – à force de vacuité.
Il est midi et des poussières. L’audience était fixée à 10h30. La juge aux affaires familiales, long corps frêle perdu dans sa toge sombre, fronce les sourcils, très agacée, allons-y, on ne peut plus se permettre de patienter, l’avocate de Monsieur nous rejoindra au cours de l’audience, enfin si elle arrive un jour… Parce que la requête en divorce est de ton fait, tu es entendue la première. Sur les conseils de ton avocate, tu tentes d’expliquer le contexte du divorce, mais la juge te cloue le bec, cette audience n’est pas le lieu du contentieux, nous n’abordons pas les motifs du divorce, je tiens juste à vérifier que vous maintenez votre demande.
– La plainte ne sera donc pas évoquée ?
– Ah parce qu’il y a une plainte. Non.
Trois minutes plus tard, lui est entendu à son tour. Son avocate surgit enfin, à bout de souffle, enfilant sa robe et se répandant en excuses. L’audience peut commencer. À part lever les yeux au ciel, ni lui ni toi n’avez l’occasion d’intervenir. C’est un ping-pong entre vos avocates et la juge. L’échange est technique, précis, sans humanité. Les enjeux et le récit circonstancié des faits n’ont pas leur place ici. Seuls comptent les fiches de paie, les attestations d’hébergement, les avis d’imposition… La juge est pressée, d’autant que l’électricité risque de sauter encore, tiens, d’ailleurs ça recommence, plus d’éclairage, allez, dépêchons-nous, je n’y vois plus rien, et puis Monsieur, cessez de fixer pesamment l’avocate de Madame, on n’est pas au cirque quand même ! Il est midi trente. La juge ramasse ses papiers, raide et sévère, très bien. D’après ce que j’ai compris de ce que m’a dit Madame, il n’y aura pas de procès-verbal d’acceptation, je vous informe que le jugement est fixé au mois de mai. Ton avocate soupire en te raccompagnant sur le parvis, je n’ai pas eu le temps de plaider. Vous avez trouvé ça comment ?
***
Dans l’ascenseur, la policière te demande comment tu te sens. Tu réponds d’une voix blanche que ça va, puis, après une pause, enfin, ça reste un peu difficile quand même, mais je suis tellement heureuse de vivre de nouveau avec mes enfants, ça faisait dix mois que je ne les voyais que par intermittence. Ton fils aîné s’exclame alors, tout sourire, ah oui qu’est-ce que ça fait du bien ! Ton cœur frémit, tu ne t’attendais pas à un tel élan de sa part. Depuis que tu es hébergée dans un appartement assez grand pour les accueillir, ils sont chez toi une semaine sur deux, ça reste du camping, tu n’as pas encore de logement à toi, mais les choses s’améliorent.
Cuisine en plastique, piano en plastique, boulier en plastique – ton esprit divague devant les jeux d’enfants. Tu te dis que tu dois – que tu peux – leur faire confiance, tes fils sauront quoi dire, ils trouveront les mots justes, et leurs mots, dans ta tête, se mélangent aux phrases des affiches de la salle d’attente du quatrième étage du commissariat : « Contre les violences, la loi dénonce », « Je craque. Je frappe. J’ai besoin de me faire aider », « Quand c’est oui, c’est oui. Quand c’est non, c’est non ». La policière t’a prévenue en amont : l’enquête étant intrafamiliale, il n’est pas dit que tu auras accès aux dépositions de tes enfants. Pourtant, à l’issue de l’audition du cadet, elle te demande de la suivre pour la lire en sa présence. Il est au bord des larmes, tu lui prends la main pour le réconforter. Pour ton fils aîné, il en va autrement. Peut-être est-ce lié à son âge ou alors est-ce lui qui en a fait la demande, toujours est-il que tu es invitée à lire sa déposition dans le bureau de la policière pendant qu’il attend dans la salle d’attente.
Sur le chemin du retour, ton fils cadet t’interroge, je le sais qu’il s’est passé quelque chose dans la cuisine, je le sais, mais alors pourquoi je m’en souviens plus ?
***
Devant le tribunal de Paris, tu n’éprouves ni la grandeur ni la solennité que tu avais ressenties lors de l’audience liée au divorce. Une pluie fine écrase tout d’humidité méchante, enveloppant la monumentalité de l’édifice dans la grisaille. Six mois ont passé, le printemps était propice à l’émerveillement, l’automne à la morosité. Te voilà à la porte de la 24e chambre correctionnelle, salle 4.04, au quatrième étage, information que tu as lue sur un des tableaux numériques dans le hall, ce qui signifie que ton cerveau fonctionne malgré tout. Lui est devant la porte, amaigri dans un pantalon de toile beige. Tu le salues – enfin, peut-être.
Ce qui suit est flou, engoncé dans un halo de blancheur. Toi, assise côté victimes. Lui, côté accusés. En face, la procureure sur la gauche, les trois juges au centre, la greffière sur la droite. Entre eux et les juges, ton avocate fait face à son avocate. Derrière, sur les bancs réservés au public, une vingtaine de lycéens et quelques badauds attendent le début du procès. La première affaire concerne un jeune homme prévenu pour des faits de harcèlement à l’encontre d’une vendeuse du Bon Marché. Sur le banc, tu attends. Tu es toute seule sur le banc. Tête vide. Rien. Tu ne penses à rien. Tu entends les mots de la première affaire – bornage téléphonique et suivi psychiatrique. Tu entends. C’est donc que tu es là. Mais qui est là de toi ? Ton corps ? Tes oreilles seulement ? Ton esprit ? Un reflet de toi-même ? Une dispersion ? Un éparpillement ? En instance de décomposition – c’est toi.
Il est appelé à la barre. L’affaire – ton affaire, votre affaire –, c’est maintenant. Le jeune homme, celui d’avant, a écopé de plusieurs mois de prison avec sursis. Combien ? Une ombre en toi, une ombre recouvrant ta mémoire. Tu as cru comprendre – il se peut que ce jeune homme soit aussi accusé de tentative de viol par une autre femme. Mais tu es restée au bord. La mémoire te fait défaut. Ici sur ce banc, assez loin. Tu es flottante. Les informations sont entrées-sorties. Un courant d’air. On ne s’y accroche pas. À quoi se raccrocher ?
Il est à la barre. Toi, à présent, tu es assise sur un strapontin, tournant le dos à ton avocate, de profil par rapport à lui, par rapport à la salle. Tu écoutes. De toute ton attention. Tu écoutes. Tu ne te souviens de rien. Tes larmes ont séché. À part ça rien n’arrive jusqu’à toi. Pourtant tu te vois et tu vois la salle autour. Les gens à droite, les juges à gauche. Ça bruisse un peu mais lui tu ne l’entends pas. Tu entends ses paroles, tu les entends. Toutes ses paroles. Toutes. Elles sont là. Gravées. Elles sont gravées mais rien. Tu n’as pas de souvenir.
Tu es à la barre. Tu ne sais pas comment tu y es. Tu y es. Derrière il y a les gens. Devant il y a les juges. Tu ne vois rien. Tu dois parler. La juge du milieu pose une question. À toi. Tu t’agrippes à la barre. Tu dois parler. Il faut répondre. Il y a des mots dans ta bouche comme du coton – de toute façon tout est blanc. Peut-être que tu trembles un peu. On dirait une femme fragile. Tu es toute frêle à la barre. Les juges te regardent. Tu dois parler. Les mots de coton. Tu trembles – dans les mots – dans le corps. Toujours pareil : quand tu parles de ça, quand tu dois raconter ça, ce que tu as vécu. Toujours pareil, des mois après, quand tu dois raconter. Quand tu dois. Ce n’est plus toi mais l’autre qui prend ta place. Celle qui a subi. Cette haine en lui pour elle. La haine qu’il avait. Tu es celle-là.
Tu dis – tout est blanc. Tu dis, ce n’est pas tant la scène dans la cuisine. Tu dis, et tout le reste. Tu dis, quand il dit qu’il a subi des violences psychologiques de ma part depuis notre mariage, parce qu’il dit ça, tu dis, je ne comprends pas comment est-ce possible qu’il dise ça parce que moi je voulais me séparer, je disais tu m’insultes, tu es violent, alors il le faut, mais il disait tu vas m’achever, si c’est ça je vais me suicider ou bien il disait pars, casse-toi, dégage.
La juge dit quelque chose. Ça doit être une question. Une autre question. Ils te regardent. Les trois juges, celle du milieu et les deux autres. Ils te regardent. Ils sont désolés pour toi, ça se voit. Tu le vois. Bizarrement ça tu le vois. Tu perds le fil. Quelle question ? Tu veux expliquer les choses. Tu voudrais qu’ils comprennent. Tu dis, j’ai déposé une main courante, on m’a conseillé de le faire, c’est à ce moment-là, avant je ne savais pas, c’est à ce moment-là, l’agent m’a dit c’est pas normal votre mari n’a pas le droit de vous insulter, il n’a pas le droit de vous plaquer au sol, moi je ne savais pas, jusque-là je ne savais pas. La juge demande, vous ne saviez pas quoi ? Tu répètes, je ne savais pas… je ne savais pas… les mots, on dirait des flocons de neige, je ne savais pas que j’étais… les mots s’éparpillent en cristaux, je ne savais pas que j’étais… les mots disséminés en blanc, je ne savais pas que j’étais victime de violences conjugales.
Peut-être que c’est avant que tu as dit ça. Comment se rappeler l’ordre des phrases ? Tu as dit aussi, à un moment, avant ou après, tu ne sais plus, que tu avais été soulagée, quand je me suis retrouvée en bas de l’immeuble, avec ma valise, je me suis dit ça y est, c’est fini, plus jamais. Tu dis, ça a été dur, de partir comme ça, sans mes enfants, sans logement ni travail, ça a été dur mais maintenant ça va, maintenant oui ça va, c’était dur mais à présent la vie pour moi c’est mieux.
Son avocate à lui. Elle est censée t’interroger – toi cette femme qui tremble à la barre. Toi dont les mots flottent, flocons de neige recouvrant la salle de grésille, une fine couche de poudreuse protectrice. Ce que tu entends qui sort de la bouche de l’avocate, tu te demandes si ça s’adresse à toi, étant donné l’état de Madame, je vais me dispenser de lui poser des questions. L’état de Madame ? Est-ce en raison des flocons de neige ? Est-ce parce que trembler dans la poudre blanche fait de toi une femme vulnérable ? Quand on te renvoie sur le strapontin, les flocons volent tout autour. Tu fais ce qu’on te demande, pourtant tu as encore des choses à dire. Si peu a été dit. Qu’as-tu dit ? Ni des mots. Ni des mots. Ni des mots. Tu ne te souviens pas.
Vous vous faites face, lui et toi. Ton corps, là, sur le strapontin – mais où es-tu ?
Ton avocate, ce qu’elle dit, c’est bien – mais que dit-elle ?
La procureure, elle te défend. Elle a des mots durs contre lui – ça, tu t’en souviens, si vous n’avez pas serré la gorge de votre femme, c’est parce que votre fils était là, c’est ce que vous avez dit, n’est-ce pas ? Donc s’il n’avait pas été là, vous auriez serré, c’est bien ça ? Ces mots, ceux-là, oui, ceux-là, tu t’en souviens.
Son avocate à lui, voyez les mails échangés, une histoire d’amour de vingt ans. Les insultes, oui, quelque fois, mais bon ça va, par-ci par-là. Il le dit lui-même, il vient d’un milieu populaire, il a grandi avec ça, les insultes, vous savez, dans ce milieu, c’est l’ordinaire. En plus, elle n’était pas facile. Les enfants n’en pouvaient plus, eux aussi. Lisez leur audition. Qu’il est chou, le petit. Monsieur essayait d’arranger les choses. En larmes, dans mon bureau. Le pauvre. Deux êtres fragiles qui s’aiment, voilà.
La neige est partie. Il y a comme un juste retour des choses. Tout est net, lavé des fioritures. L’éthéré glisse par dessous les bancs de la salle désertée par les lycéens – ici, on entre, on sort. Tu écarquilles les yeux, les oreilles, tu t’écarquilles tout entière. Puis tu te lèves comme les autres et tu quittes la salle – les juges ont dit, c’est la délibération.
***
Vingt minutes après, le verdict tombe, quatre mois de prison avec sursis et un stage pour les auteurs de violences conjugales. Toi, tu comprends. Lui, non. À moins que ce soit l’inverse.
***
Du soulagement. D’abord du soulagement. Près d’un an et demi après qu’il t’a mise à la porte, tu ressens l’immense réconfort d’être reconnue victime, et que lui ne puisse plus se faire passer pour tel. Un tiers a tranché, tu n’es ni folle, ni énervée. Ce n’est pas lui la victime, c’est toi. Tes enfants sauront qu’il est des actes interdits. Tu as de l’espoir pour eux. L’espoir qu’ils ne reproduisent pas. Ça te console. Pour l’avenir. Ce que ça te fait ? Trop, ça te fait trop. La culpabilité prend le dessus. Voilà que tu le plains. Ne souffre-t-il pas par ta faute ? Ce que ça te fait. Un sentiment d’imposture et d’illégitimité. Tu l’entends cracher son fiel. Dire à ses amis, à sa famille, que tu es une fieffée manipulatrice – même les juges sont tombés dans le panneau. N’es-tu pas cette personne odieuse qui fout la merde, cette sale chienne t’as qu’à crever ?
***
Pendant huit jours, tu n’as aucune nouvelle de tes fils en vacances chez leurs grands-parents paternels. Ni l’un ni l’autre ne répond à tes appels et SMS. Tu reçois un message d’une vieille connaissance qui, bien qu’elle ne se soit jamais inquiétée de toi pendant l’année écoulée, trouve soudain que la « judiciarisation » de votre conflit est « disproportionnée et injuste ». Une amie t’encourage à lui répondre. Elle voudrait que tu lui expliques que ta plainte n’a jamais été dictée par une volonté de gagner quelque chose, comme cette personne le sous-entend, mais d’acter qu’il est interdit d’insulter sa femme et de la plaquer au sol. Mais toi tu aspires à faire le deuil de la validation : ceux qui ne veulent pas entendre ta version des faits, ceux qui estiment que tu exagères, ceux qui auraient préféré que tu gardes le silence – tant pis pour eux. Oui mais on fait quoi, alors, pour changer les choses ?, t’interroge ton amie. Tu te rends compte que, finalement, c’est toi qui paies pour tout. Tu paies parce que tu es la victime. Tu paies parce que tu as eu le courage de porter plainte. Tu paies quand l’auteur des violences est condamné par la justice. Donc tu paies tout le temps ? Donc c’est toujours de ta faute ?
Tu ne désespères pas. Tu ne veux pas désespérer. Il ne faut pas désespérer. La façon dont chacune pose une petite pierre – la façon dont tu as posé la tienne – la façon dont tes amies t’ont soutenue – la façon dont vos liens s’en sont trouvés renforcés – la façon dont il en résulte de la puissance – tout cela ne peut pas être vain – tout cela n’est pas vain.
Iris Boréal est un pseudonyme. Ce témoignage est une compilation d’extraits d’un texte à paraître sur le même sujet. L’autrice a également publié un article sur la dissonance à l’œuvre au sein de la gauche radicale au sujet du féminisme et des violences sexistes, à lire sur le Club de Médiapart.
 Les discriminations – comme les
Les discriminations – comme les