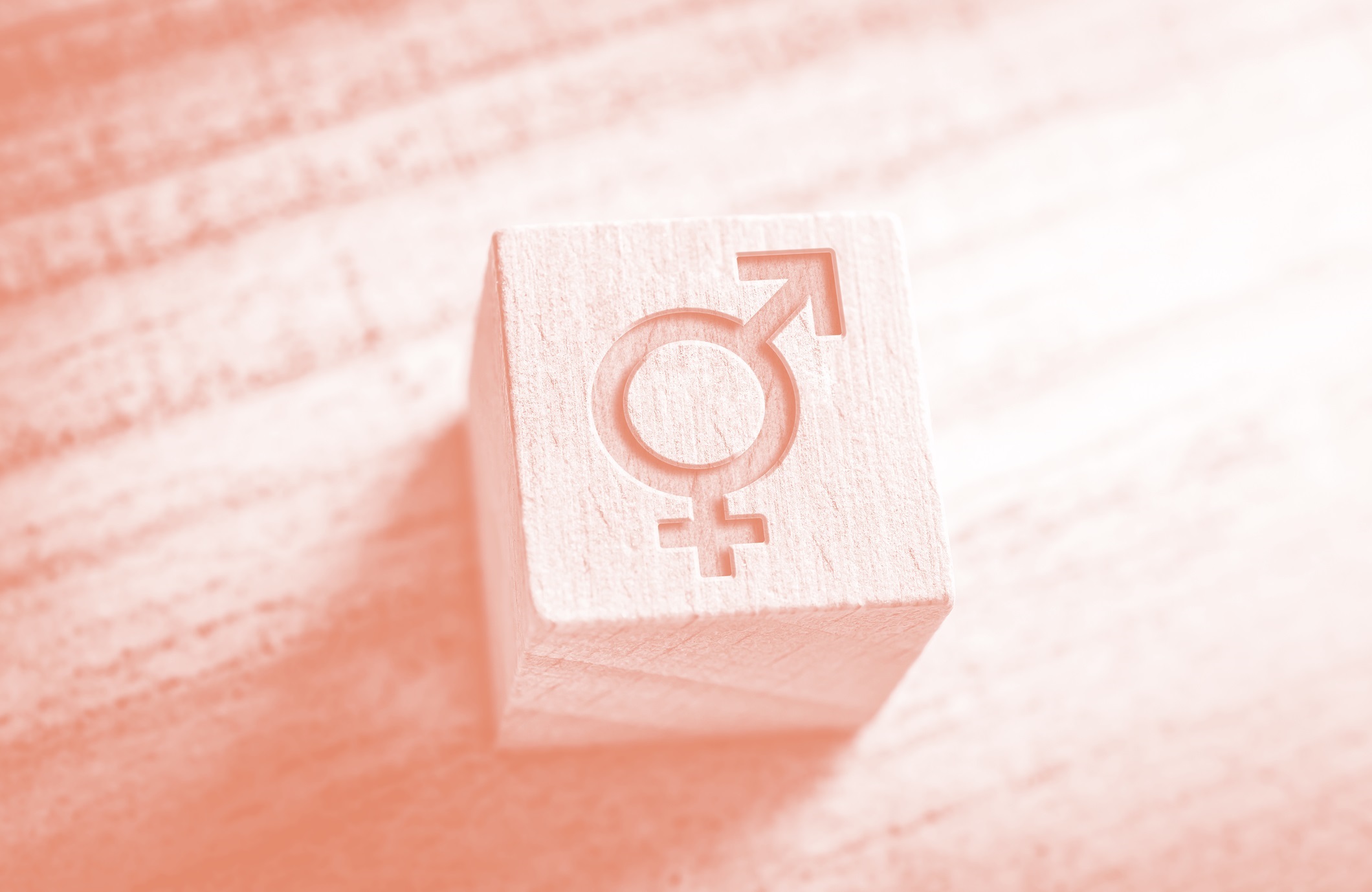Riss s’insurge : « Le mot “victime” a envahi notre vocabulaire », dit-il après la fusillade à Charlie Hebdo dont il fût « victime ». Et il explique, corrige : « À l’hôpital où je fus par la suite évacué, un type vint me rendre visite. Il travaillait au ministère des Affaires étrangères, et m’informa que j’allais être pris en charge par un “Fonds d’indemnisation des victimes”. Je n’avais jamais entendu parler de cette institution. C’est à cette occasion qu’on me qualifia pour la première fois de “victime”. Je n’avais jamais pensé me définir ainsi. J’étais blessé, j’étais chanceux, j’étais convalescent, j’étais mal en point, j’étais triste, j’étais honteux, j’étais mélancolique, j’étais déterminé, j’étais en colère, j’étais abattu, j’étais vivant, j’étais mal rasé, j’étais énervé, j’étais dessinateur, j’étais en pyjama, j’étais sous morphine, j’étais seul. J’étais vivant. Mais pas “victime” […]. “Innocent”, j’étais innocent1Riss, Une minute quarante-neuf secondes, Paris, Actes Sud et Charlie Hebdo, Les échappées, 2019, p. 74-5. ».
L’ombre de la victime
Si Riss peut préférer être reconnu innocent, c’est que la victime ne se comprend qu’en opposition et donc en association avec le coupable. Plus précisément, la victime est indissociable de la culpabilité : puisque je suis victime, quelqu’un est coupable. La victime est contrainte de vivre avec son ombre, le coupable ; et ce coupable, qui que ce soit d’autre, c’est souvent au moins moi-même. Ainsi Philippe Lançon, gravement blessé au cours de l’attentat contre Charlie Hebdo, raconte : « Plus je comprenais que j’étais victime, plus je me sentais coupable. Mais de quoi étais-je coupable, si ce n’est d’avoir été au mauvais endroit au mauvais moment ? C’était déjà beaucoup, c’était trop. J’ai regardé mes parents, solides, en bonne santé, debout à droite et à gauche de mon lit. J’étais au moins coupable de ça : leur imposer cette épreuve à la fin de leurs vies2Philippe Lançon, Le lambeau, Paris, Gallimard, Folio, 2018, p. 130.. »
Simon Fieschi, dont la colonne vertébrale a été touchée par les balles de la kalachnikov de Chérif Kouachi le 7 janvier 2015, n’aime pas non plus entendre dire qu’il est « victime » : au tribunal, il a trouvé plus juste le mot « survivant3Yannick Haenel et François Boucq, Janvier 2015, Le procès, Hors-série Charlie Hebdo, Paris, Les échappés, 2020, p. 28. ». Le survivant, dit-il encore, a des devoirs, une responsabilité, dirions-nous : témoigner. Et responsabilité n’est pas culpabilité. Au contraire du couple victime-coupable, le survivant implique l’autre comme celle ou celui à qui il survit et avec qui il survit : survivre implique vivre après et avec la mort d’un ou d’une autre. Ainsi la survie est-elle une impossible solitude et ainsi engage-t-elle une responsabilité : le survivant est responsable de n’être pas mort, responsable de vivre, responsable de vivre après et avec la mort de l’autre, responsable de la mort de l’autre, responsable de la porter, d’en porter témoignage auprès des vivants, afin que la mort de l’autre ne soit pas son anéantissement, que trace en soit gardée.
Pas une simple bataille de mots
Victime, coupable, innocent, survivant – cela n’est pas une bataille de mots, ou si c’en est une, elle ne vaut la peine que parce que ces mots-là ne sont pas sans effet sur ceux qui les portent. Imaginons par exemple que l’on permette aux personnes exilées de témoigner de leur survie, au lieu de leur demander de prouver ce dont elles sont victimes, cela ne ferait-il pas une différence majeure ? À celui à qui on demande de prouver qu’il est victime, on demande de parler des coupables. C’est ce qu’il se passe chaque jour dans les bureaux de l’OFPRA – Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides. Et c’est seulement si le récit aura convaincu l’officier que le demandeur d’asile sera reconnu comme « victime » et suffisamment victime pour mériter refuge. Est-ce que cela pourrait se passer différemment si les officiers de l’OFPRA n’était pas mis en position de juger mais d’accueillir – d’accueillir, non pas des preuves de la violence dont celle et celui qui arrivent sont victimes, mais des témoignages de leur survie ?
Et imaginons encore : imaginons-nous écouter une personne qui nous parle de ce dont elle aura été victime, imaginons qu’il soit possible de l’écouter et d’entendre que sa parole témoigne qu’elle-même survit. Nous entendrions alors, dit Jacques Derrida, « la vie au-delà de la vie, la vie plus que la vie […] car la survie, ce n’est pas simplement ce qui reste, c’est la vie la plus intense possible4Jacques Derrida, « Je suis en guerre contre moi-même », propos recueillis par Jean Birnbaum, Le Monde, 12 octobre 2004. Republié dans Apprendre à vivre enfin, Paris, Galilée, 2005. » : la vie la plus possible, au bord de l’impossible, donc. À écouter la survie en tant que telle, peut-être entendrions-nous alors la victime se découpler du coupable, voire de la culpabilité ; par sa parole, parce que sa parole est écoutée, peut-être la victime s’entendrait-elle survivre, et peut-être entendrait-elle que, par là-même, elle n’est pas seule, qu’elle survit avec les morts, dès lors qu’elle témoigne pour eux, pour qu’ils aient une place auprès des vivants ; et qu’elle survit avec les vivants, dès lors qu’elle témoigne pour eux des morts dont la trace que nous portons fait de nous des survivants, des vivants qui vivent plus que la vie.
Survivants, peut-être pourrions-nous alors entendre que les tueurs, parfois, ces tueurs peut-être, sont « morts à eux-mêmes, au monde, au désespoir », ils sont « morts chez les vivants » et sont, dès lors, « invincibles : nul sexe entre leurs jambes, des armes ; pas de chair au bout des doigts, pas d’Autre, mais du métal ; pas de plaisir à prendre, de la mort à donner5Mathieu Riboulet, Les Portes de Thèbes, Eclats de l’année deux mille quinze, Lagrasse, Verdier, 2020, p. 25. ». La survie pourrait alors répondre à ces tueurs morts-vivants, car c’est tout autrement que les survivants portent en eux la mort : non pour tirer la vie à elle, non pour que ne reste que la mort, mais pour ne pas effacer la mort de la vie, pour ne réduire à néant ni la vie ni la mort, pour tenir ce fil à l’équilibre instable, tendu entre la vie et la mort.
Dorothée Legrand est psychologue clinicienne, psychanalyste et chercheuse en philosophie au CNRS.