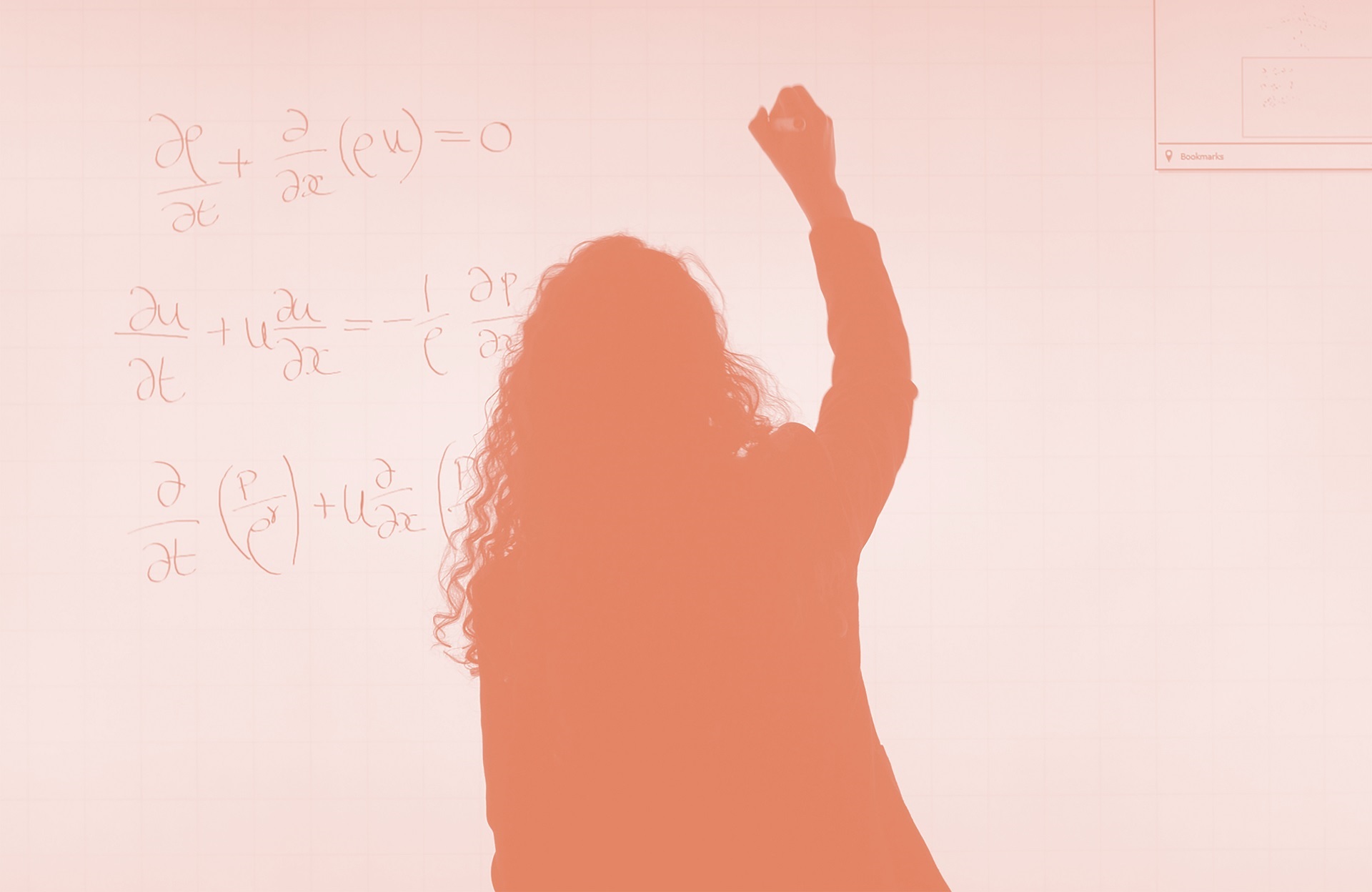Mon livre La littérature à l’heure de #MeToo1Hélène Merlin-Kajman, La littérature à l’heure de #MeToo, Paris, Ithaque, 2020. a pour point de départ une controverse née de l’interprétation d’un poème d’André Chénier (1762-1794). Le poète a 18 ans quand il écrit en alexandrins une traduction presque littérale d’une idylle du poète grec Théocrite (IIIe siècle av. J.C.), L’Oaristys. Ce mot savant signifie à la fois « dialogue érotique » et « ébats amoureux » : à la fois des mots et des actes. Faute de place pour le reproduire intégralement (il comprend 88 vers), je commencerai par citer les vers principalement incriminés, comme je l’ai fait dans mon livre. Mais, comme dans mon livre, ma réflexion essaiera de déplacer et d’approfondir une évidence qui semble immédiate et incontournable pour un lecteur contemporain, évidence selon laquelle ces vers mettraient en scène le viol de Naïs (la première à parler dans l’extrait ci-dessous) par Daphnis :
Adresse ailleurs ces vœux dont l’ardeur me poursuit / Va, respecte une vierge. […] / Non ; déjà tes discours ont voulu me tenter. […] / Berger, retiens ta main,… berger, crains ma colère […] / Berger, retiens ta main,… laisse mon voile en paix. […] / Satyre, que fais-tu ? Quoi ! ta main ose encore… […] / Berger, au nom des dieux… / Ah !… je tremble… […] / Non ; arrête… […] Dieux ! quel est ton dessein ? Tu m’ôtes ma ceinture ? […] / Tu déchires mon voile !… Où me cacher ? Hélas ! / Me voilà nue ! où fuir ! […] Ah ! méchant ! qu’as-tu fait ?2André Chénier, « L’Oaristys », dans Poésies, édition Louis Becq de Fouquières, Paris, Gallimard, 1994, p. 79-85. Ce sont respectivement les v. 8, 14, 24, 28, 65, 67-68, 69, 73, 77-79, 86 et 87.
La question de la culture du viol
L’Oaristys figurait dans un recueil de poésies d’André Chénier mis au programme pour le concours de l’agrégation de lettres modernes et de lettres classiques de 2018. En octobre 2017, un groupe féministe de l’ENS de Lyon, les Salopettes, rendait publique sur son site une lettre adressée par des agrégatifs aux jurys des deux agrégations et signée par des enseignants-chercheurs, des doctorants et de nombreux enseignants du secondaire3« Lettre d’agrégatifs⋅ves de Lettres modernes et classiques aux jurys des concours de recrutement du secondaire », 3 novembre 2017, Les Salopettes, Association féministe de l’ENS Lyon.. Pour expliquer leur démarche, les auteurs de cette lettre-pétition évoquaient des cours de préparation sur Chénier assurés par des spécialistes de la littérature du XVIIIe siècle. Certains avaient refusé de valider l’interprétation selon laquelle L’Oaristys représentait un viol, au motif qu’au XVIIIe siècle, le consentement explicite d’une femme, a fortiori d’une jeune fille vierge, à une relation sexuelle non conjugale entraînait son déshonneur. De ce fait, la convention littéraire libertine, c’est-à-dire favorable à l’érotisme, aurait donc toujours représenté les femmes dans une attitude de protestation et de refus, afin de défendre (et montrer) le plaisir érotique féminin sans en passer par une dégradation misogyne. Reconnaître un viol dans L’Oaristys aurait donc constitué, selon ces spécialistes, un contresens, ou plutôt un anachronisme4La lettre ne détaille pas aussi précisément en quoi consistent l’anachronisme et la convention littéraire. J’ajoute donc ici une glose afin de faciliter la compréhension des enjeux épistémologiques de la controverse – qui ne sont pas ceux qui vont m’occuper..
Outre des enjeux d’histoire et de théorie critique, la lettre-pétition, suivie d’une réaction de sept des signataires à un court commentaire du poème que j’avais fait sur le site du mouvement Transitions, et où j’évoquais un « quasi-viol » plutôt qu’un viol5Hélène Merlin-Kajman, « Saynète n°73 », Transitions, 23 décembre 2017 (http://www.mouvement-transitions.fr/index.php/exergues/saynetes/sommaire-des-saynetes-deja-publiees/1502-saynete-n-73-a-chenier-h-merlin-kajman) ; et Camille Brouzes, Roxane Darlot-Harel, Anne Grand d’Esnon, Anne-Claire Marpeau, Jeanne Ravaute, Lola Sinoimeri et Matthias Soubise, « Voir le viol. Retour sur un poème de Chénier », Malaises dans la lecture, 10 avril 2018 (https://malaises.hypotheses.org/242). Une polémique s’en est suivie : Brice Tabeling, « Voir ou ne pas voir le viol. L’Éthique du métadiscours », Transitions, 30 juin 2018 (http://www.mouvement-transitions.fr/index.php/litterarite/articles/n-5-b-tabeling-voir-ou-ne-pas-voir-le-viol-l-ethique-du-metadiscours) ; Hélène Merlin-Kajman, « Encore Chénier – et au-delà », Transitions, 12 janvier 2019 (http://www.mouvement-transitions.fr/index.php/litterarite/articles/n-7-h-merlin-kajman-encore-chenier-et-au-dela) ; Lise Forment, « Plus qu’une saynète. Beaumarchais », Transitions, 3 novembre 2018 (http://www.mouvement-transitions.fr/index.php/exergues/saynetes/sommaire-des-saynetes-deja-publiees/1605-plus-qu-une-saynete-beaumarchais-l-forment), Marc Hersant, « Chénier, Eschyle, Ronsard, etc. : les classiques en procès », Transitions, 6 juin 2019, (http://www.mouvement-transitions.fr/index.php/litterarite/articles). Après la publication de la contribution de Marc Hersant la polémique s’est poursuivie par des voies non universitaires. Brice Tabeling a fait le point par un dernier article publié sur le site de Transitions : Brice Tabeling, « Via Twitter, fatalement… (Post-scriptum à “l’Éthique du métadiscours”) », Transitions, 28 juillet 2019 (http://www.mouvement-transitions.fr/index.php/litterarite/articles/n-11-b-tabeling-via-twitter-fatalement-post-scriptum-a-l-ethique-du-metadiscours). On trouvera des références à des prolongements médiatiques sur le blog Malaises dans la lecture : https://malaises.hypotheses.org/1003. (j’y reviendrai), engage aussi des enjeux pédagogiques justifiant le nombre de signatures d’enseignants du secondaire. Les auteurs de ces deux textes insistent en effet sur le fait que, l’agrégation étant un concours d’enseignement, la question de l’interprétation de L’Oaristys est une question qu’ils devront se poser une fois devenus enseignants : comment ne pas perpétuer la « culture du viol » en transmettant des textes littéraires qui en relèvent si l’on ne s’accorde pas le droit de les lire dans la perspective militante d’un combat actuel contre cette culture, indépendamment de leur signification dans le contexte de leur production ? En défendant ainsi l’importance d’une « réception contemporaine », les signataires font alors de ce poème de Chénier un cas, particulier mais exemplaire, d’un problème plus général, non seulement celui des « textes mettant en scène des violences sexuelles », mais encore des « nombreux textes présentant des discours idéologiques oppressifs (racisme, antisémitisme, sexisme, homophobie, etc.) ».
L’idée qui habite les signataires ne date pas d’hier : certains courants féministes ont très tôt adopté l’assimilation, marxiste ou marxienne, de la littérature à l’idéologie bourgeoise, en insistant sur sa dimension phallocratique (voire phallogocentriste). La littérature serait même un véhicule particulièrement redoutable en raison de ses euphémisations rhétoriques et du bénéfice de plaisir apporté par son travail esthétique, lequel ferait pernicieusement avaler sans méfiance, incorporer, la culture du viol. Puisque l’enseignement doit non seulement conduire les élèves à maîtriser des connaissances mais encore leur apprendre à lire et à développer leur esprit critique, il serait donc nécessaire de soulever le masque du discours pour leur révéler la manipulation, et, ici, déceler, derrière le berger charmeur, le violeur habile.
Ces enjeux pédagogiques sont en effet importants, d’autant plus que l’enseignant reste, en classe, le maître des interprétations. D’où un délicat problème : celui de la différence entre l’ordre du savoir ou des connaissances, dont le professeur est le dépositaire incontesté, et l’ordre de l’interprétation. Selon moi, l’interprétation devrait relever d’un partage dialogique où les réactions différentes voire conflictuelles des étudiants ou des élèves devraient pouvoir librement trouver leur place. Certes, elles doivent être reformulées par l’enseignant pour introduire des notions de linguistique, de poétique, de rhétorique, d’histoire, propres à l’enseignement de sa discipline : la question de l’interprétation rejoint alors celle du savoir, et leur frontière est évidemment instable. Du côté du savoir : comment lire un texte littéraire, avec quels instruments ? Du côté de l’interprétation, la question est celle de la marge d’indétermination, voire la dimension d’inconnaissable, d’un texte littéraire, marge qui est peut-être condition de sa réussite : comment évaluer qu’un texte littéraire représente sans contestation possible un acte extra-littéraire comme le viol, quand son intention signifiante diverge de cette interprétation ? Peut-on fixer une interprétation ? Quel en serait le bénéfice ?
L’hypothèse d’un « quasi-viol »
Revenons à L’Oaristys. Les vers que j’ai cités me paraissent imposer l’hypothèse selon laquelle le poème, quoique ce ne soit pas son but, représente bien en effet quelque chose qui se rapproche du viol (c’est ce que mon expression de « quasi-viol » voulait traduire). Cette hypothèse me parait non seulement légitime, mais nécessaire. Mais je répète ma question antérieure : peut-on fixer une interprétation, et pour quel bénéfice ? Le poème ne se donne pas pour une représentation d’un viol, mais pour celle d’une sorte de transaction érotique et matrimoniale à dénouement heureux : que faire de cet écart entre une évidence contemporaine militante et une intention poétique de signifier différente ? Je propose de saisir cette divergence comme une chance, l’opportunité d’amener des lecteurs à faire jouer le poème. Le tourner et le retourner en tous les sens, regarder comment il est fait, permet, selon moi, de ne pas agresser les échos intimes, culturels, idéologiques, pulsionnels qui peuvent surgir dans l’intériorité des élèves : il s’agit d’inviter les élèves à se hasarder (ou à avancer) subjectivement au fil des déplacements du sens, et ceci, sans exiger leur reddition, cette reddition à laquelle au contraire tout mot d’ordre oblige son destinataire, tout particulièrement en situation scolaire. Pour le dire autrement, la lecture de L’Oaristys en termes de viol, dès qu’elle passe de l’hypothèse interprétative à l’affirmation dogmatique, transforme la fonction pédagogique de la littérature. En faisant d’un poème le support d’un message exclusivement militant, elle le prive d’autres ressources peut-être plus importantes, non sans produire au passage d’invisibles effets d’autorité également discriminants.
Revenons, donc, à L’Oaristys. Les vers que j’ai cités plus haut ne s’enchaînent pas les uns après les autres. Certes, les isoler fait apparaître l’expression répétée d’un refus, voire d’une détresse. Mais ce qui les sépare les inscrit dans une intrigue au cours de laquelle la répétition déplace sa signification. Voici par exemple les vers 47-60 :
NAÏS
Mais, tes vœux écoutés, quel en serait le prix ?
DAPHNIS
Tout : mes troupeaux, mes bois et ma belle prairie ;
Un jardin grand et riche, une maison jolie,
Un bercail spacieux pour tes chères brebis ;
Enfin, tu me diras ce qui pourra te plaire ;
Je jure de quitter tout pour te satisfaire :
Tout pour toi sera fait aussitôt qu’entrepris.
NAÏS
Mon père…
DAPHNIS
Oh ! s’il n’est plus que lui qui te retienne,
Il approuvera tout dès qu’il saura mon nom.
NAÏS
Quelquefois il suffit que le nom seul prévienne :
Quel est ton nom ?
DAPHNIS
Daphnis ; mon père est Palémon.
NAÏS
Il est vrai, ta famille est égale à la mienne.
DAPHNIS
Rien n’éloigne donc plus cette douce union.
NAÏS
Montre-les moi, ces bois qui seront mon partage.
Transposé dans la pastorale, il s’agit du contrat de mariage à venir, des biens et de la qualité de Daphnis, tous détails auxquels Naïs s’intéresse. Pendant les 28 vers qui restent, Daphnis va cependant faire plus que « montrer » à Naïs « les biens qui lui sont destinés » (v. 64). À l’abri du « bois qui de joie et s’agite et murmure » en anticipant un autre « partage » (v. 76), Daphnis presse Naïs érotiquement, sans cesser toutefois de répondre à ses objections – c’est-à-dire sans que le dialogue argumentatif s’interrompe. Et par leur seul échange verbal, le lecteur comprendra qu’ils ont fait l’amour, union sexuelle par laquelle Daphnis a « signé [s]a promesse », affirme-t-il, avant leur dernier échange : « NAÏS : J’entrai fille en ce bois et chère à ma déesse. / DAPHNIS : Tu vas en sortir femme et chère à ton époux. » La déesse invoquée ici par Naïs est Diane, déesse de la virginité, sous l’autorité de laquelle elle s’est précédemment rangée. Daphnis lui oppose la loi de Vénus, sous laquelle il place son mariage futur avec Naïs.
Une « émancipation » pour le moins ambigüe
Quand le dialogue commence sans qu’aucune narration y introduise, Daphnis a déjà abordé Naïs qui lui a déjà accordé un baiser. On comprend l’intrigue grâce aux commentaires (questions, exclamations, refus) de Naïs sur les gestes de Daphnis, et grâce aux arguments échangés. Le berger est pressant. Il veut deux choses : épouser la bergère, et faire l’amour avec elle séance tenante. C’est-à-dire, dans la perspective culturelle d’une valorisation, voire d’une sacralisation de la virginité féminine, inverser l’ordre chronologique du mariage et de sa consommation sans les désolidariser totalement : on peut comprendre que Daphnis émancipe la sexualité féminine de l’ordre moral, social, patriarcal, qui la surveille et la contraint.
Mais, dira-t-on à juste titre, il l’émancipe malgré elle.
La bergère hésite et refuse de deux façons. Si l’une d’elles consiste à repousser les gestes érotiques de Daphnis, l’autre consiste à dire ses appréhensions, et Daphnis lève une à une ses objections : Naïs a peur du mariage, peur de la maternité, peur de son père, et finalement, devant l’imminence de l’union charnelle, peur de l’infidélité ou de l’abandon (d’où l’importance de la « promesse » dite par le berger, et de son engagement performatif aux derniers vers).
Le passage où, pour la seconde fois, Naïs fait surgir la figure paternelle mérite d’être cité :
DAPHNIS
Eh ! laisse-moi toucher ces fruits délicieux…
Et ce jeune duvet…
NAÏS
Berger,… au nom des dieux…
Ah !… je tremble…
DAPHNIS
Et pourquoi ? Que crains-tu ? Je t’adore.
Viens.
NAÏS
Non ; arrête… Vois, cet humide gazon
Va souiller ma tunique, et je serais perdue ;
Mon père le verrait.
DAPHNIS
Sur la terre étendue Saura te garantir cette épaisse toison6Vers 66 à 72.
« Vois, cet humide gazon / Va souiller ma tunique, et je serais perdue ; / Mon père le verrait » : si le sens érotique (physiologique) voilé de ces vers se laisse aisément déchiffrer, leur interprétation, au-delà de ce sens crypté, n’est pas évidente : à qui attribuer sa signification ? le lecteur peut-il comprendre que Naïs, à travers ce sens voilé, avoue un désir dont la réalisation ne serait empêchée que par l’ordre du père (et de Diane) ?
Questionner l’objectif de l’enseignement
Cette question difficile (et même extrêmement délicate à présenter dans un cadre pédagogique) oblige à s’intéresser au statut du poème lui-même. Puisqu’on doit y déchiffrer des allusions érotiques qui ne sont pas forcément à mettre au compte des personnages eux-mêmes, il faut comprendre que, derrière leur voix, l’auteur glisse la sienne et joue avec son lecteur. Ni Daphnis ni Naïs n’ont de consistance réaliste ; ni le rythme des actions évoquées, ni leur décor, ne sont plausibles : le poème ne demande pas au lecteur d’y croire – il lui demande même explicitement l’inverse. Tout va trop vite pour prétendre au vraisemblable : les bergers, qui ont surgi de nulle part, se déplacent comme par magie ; et l’union sexuelle finale n’échappe ni à cette rapidité, ni à cette stylisation magiques (sans parler des symboles précis dont elle s’accompagne7Cf. mon livre pour plus de précisions.).
Puisque l’un des buts de l’enseignement, ou du commentaire critique, est d’apprendre à des élèves, des étudiants et des lecteurs, à bien lire, il est important de leur faire prêter attention à cette absence délibérée, joueuse, de réalisme. De même, il convient de leur apporter les quelques informations permettant d’éclairer les points de franche obscurité du texte : d’expliquer qui sont Vénus et Diane, pourquoi la bergère invoque son père (dans la « vie réelle », c’est en principe lui, et lui-seul, qui choisit le mari ; et, une fois le mari choisi, il organise l’alliance avec le père du futur époux : le dialogue subvertit la domination patriarcale, je l’ai dit). L’intrigue ne se déroule pas dans l’ici-maintenant d’une société occidentale contemporaine. Son décor champêtre est moins agricole que presque sauvage : les idylles de Théocrite se déroulent dans cet espace bucolique peu « civilisé » où l’on mène paître des troupeaux ; et les humains s’y comportent avec une sorte d’innocence naturelle. Idéalisation ? Oui : mais il s’agit d’une idéalisation dotée d’une fonction critique : cette innocence pastorale est opposée à la fureur guerrière, généralement chantée par l’épopée, un genre poétique sans femmes où les hommes rencontrent la gloire en s’entre-tuant.
Même si le XVIIIe siècle français n’accorde plus une valeur analogue à l’honneur militaire (côté littérature, l’épopée guerrière a disparu), l’utopie pastorale épicurienne contredit d’autres repères idéologiques puissants, dont le récit biblique de la chute d’Adam et d’Ève par la faute de cette dernière, puisque c’est elle qui prend la pomme diabolique, emblème de la sexualité. L’Oaristys innocente la sexualité, féminine comme masculine. Certes, le poème conserve pourtant, comme attribut féminin, la pudeur, émotion incorporée par les filles dans de telles sociétés. Certes aussi, l’érotisme de Daphnis violente cette pudeur. Mais il ne s’agit pas d’une violence exercée dans le cadre des sociétés occidentales contemporaines où la liberté sexuelle égalitaire est en principe un acquis culturel (quoique loin d’être général, ni simple). Le désir de Daphnis devait-il respecter la pudeur de Naïs ? Oui. Et non : encore une fois, Daphnis, Naïs, ne sont pas « vrais » – ils figurent, ils symbolisent. Daphnis aide Vénus à vaincre Diane ; c’est-à-dire qu’il peut être compris comme l’instance du désir brusquant Naïs pour l’aider à surmonter les interdits puissants qui aliènent la sexualité féminine, l’amener à reconnaître son propre désir ; et cela, indépendamment des droits et des devoirs du mariage.
Je viens de résumer en gros, par cette lecture qui scandalisera peut-être certain·e·s féministes contemporain·e·s (mais scandaliser ou indigner n’est pas mon but : je les remercie au contraire de veiller), les raisons pour lesquelles ma génération (en tout cas à gauche) a été globalement favorable aux textes libertins. Il y avait à coup sûr une forme d’irresponsabilité et d’inconscience dans cette euphorie placée sous le signe de l’émancipation sexuelle : les récents livres de Vanessa Springora et de Camille Kouchner8Vanessa Springora, Le Consentement, Paris, Grasset, 2020 ; Camille Kouchner, Familia grande, Paris, Seuil, 2021. le montrent de façon accablante. Mais tout le monde ne prenait pas ces textes comme des leçons de conduite, des manuels pratiques : on n’était en principe d’autant moins porté à lire littéralement un poème comme L’Oaristys que l’émancipation passait par la mise en lumière des sens cachés, sens « idéologiques » comme sens « sexuels ». Ce qu’apportait un texte de ce genre, c’était de permettre de sortir la sexualité de la honte et du secret des familles ; c’était d’autoriser une parole de commentaire libérée de la pudeur. Certes, à ma génération et dans les milieux de gauche, la virginité n’était plus une affaire d’honneur. Mais pesait sur la jeunesse, celle des filles tout particulièrement, un interdit de la sexualité9On sait que Foucault a fait l’hypothèse inverse d’une incitation ininterrompue des sociétés occidentales à parler (de) la sexualité, depuis le développement de la pastorale chrétienne, la confession, au biopouvoir moderne, en passant par l’étape majeure de la psychanalyse. La thèse est forte conceptuellement parlant. Sur le plan empirique, je me contenterais de remarquer que le philosophe ne s’est pas demandé ce qu’il en était de grandir, comme fille, dans des familles « victoriennes ».. Un poème comme celui de Chénier autorisait à en parler ; il procurait le plaisir d’encourager à son évocation partagée, à sa fantasmatisation non coupable.
Je fais le pari de penser qu’il peut encore jouer ce rôle : servir de tremplin atténuant la violence des désirs de passage à l’acte par le plaisir subjectivant (plutôt que substitutif) d’un dialogue joueur, curieux de l’autre (tout autre). Car je note qu’aujourd’hui, la valorisation, sinon la sacralisation, de la virginité est de retour pour des raisons que je n’examinerai pas ici. Comment parler à des adolescent·e·s qui appartiennent à des traditions culturelles où la virginité féminine est valorisée, où la sexualité est surveillée par l’ordre des familles, des groupes sociaux ? Comment jeter des ponts sans faire intrusion brutale en projetant sur les vies une normativité privée de points de contact avec la complexité des vécus ?
Permettre une prise de conscience véritable
La littérature du passé évoque des personnes, des lieux, des sentiments, des rapports, étrangers. Car le passé est d’abord étranger au présent. Mais les ponts qu’il jette vers le présent sont moins périlleux que les comparaisons horizontales entre lieux, personnes, cultures, opinions, convictions, du présent. La littérature du passé permet de séjourner du côté de l’altérité, de l’étrangeté (Diane et Vénus ne sont ni le Christ, ni Allah, ni Adonaï, ni Bouddha, etc.) tout en les partageant ensemble. Elle facilite ainsi, sinon une certaine légèreté, du moins un minimum de mise à distance des enjeux présents les plus névralgiques. Elle nous parle évidemment de nous, aujourd’hui (sans quoi l’ennui et le désintérêt seraient au rendez-vous), mais par un détour, en en voilant un peu les enjeux plutôt qu’en les exposant brutalement en plein jour dans un langage cru, binaire, frontal, trop conflictuel.
À condition que la parole d’accompagnement et de commentaire du professeur (ou du critique savant) y veille, les textes littéraires peuvent donc offrir à leurs lecteurs la possibilité d’ouvrir une scène de débats greffés sur des émotions (plaisir et déplaisir), sans contraindre à les trancher : sans contraindre à une conversion immédiate de leur opinion, sans faire le sacrifice soudain de l’entièreté de leur affectivité, de leurs attachements familiaux, de leurs identifications, de leurs fidélités. C’est un bénéfice précieux dans la situation d’une classe, encore plus quand cette classe est très hétérogène, ou bien unanimement rétive, en raison des origines culturelles de ses élèves, aux véhémences des luttes actuelles menées contre toutes les formes d’abus sexuels ou de jugements sexistes.
Aristote recommandait que la tragédie représente des personnages ni tout à fait bons ni tout à fait méchants : c’était une des conditions de la catharsis. Cette prescription, désuète en apparence, est transposable à Daphnis : elle indique comment un texte littéraire réussi conduit son lecteur à hésiter, à osciller – à remplir d’imaginaire ce qui se présenterait, dans la réalité ou dans la lutte directement politique, sous la forme d’expériences traumatiques ou de choix binaires, rapidement terrifiants, haineux, persécutifs.
Le message militant féministe qui fait du texte littéraire le terrain d’une lutte seulement idéologique risque au contraire d’installer une nouvelle normativité sans déboucher sur ce qu’on appelle, d’une expression un peu obscure, une « prise de conscience ». Car qu’est-ce que peut être une bonne prise de conscience, si elle n’est pas subjectivée, c’est-à-dire si la conscience perd le contact avec les mouvements psychiques intimes, forcément moins clairs et faciles à convertir (ou contraindre) qu’une opinion ? si la conscience se retrouve seulement acculée, par la prise de conscience (ou le mot d’ordre), à la honte de soi et des siens ?
Une chose est le message militant que des femmes (des dominés, des racisés, etc.) veulent diffuser pour défendre leur lutte. Une autre est la transmission ou relance de la littérature. Elle peut bien sûr se concevoir aussi comme un tremplin pour lutter contre les discriminations : mais grâce à une autre scène que celle du rapport de force, du front et de l’affrontement, en tablant au contraire sur le travail des élaborations imaginaires et dialoguées.
Hélène Merlin-Kajman est professeure en littérature française à l’Université de Paris III, et directrice de la revue littéraire Transitions.
 Les discriminations – comme les
Les discriminations – comme les