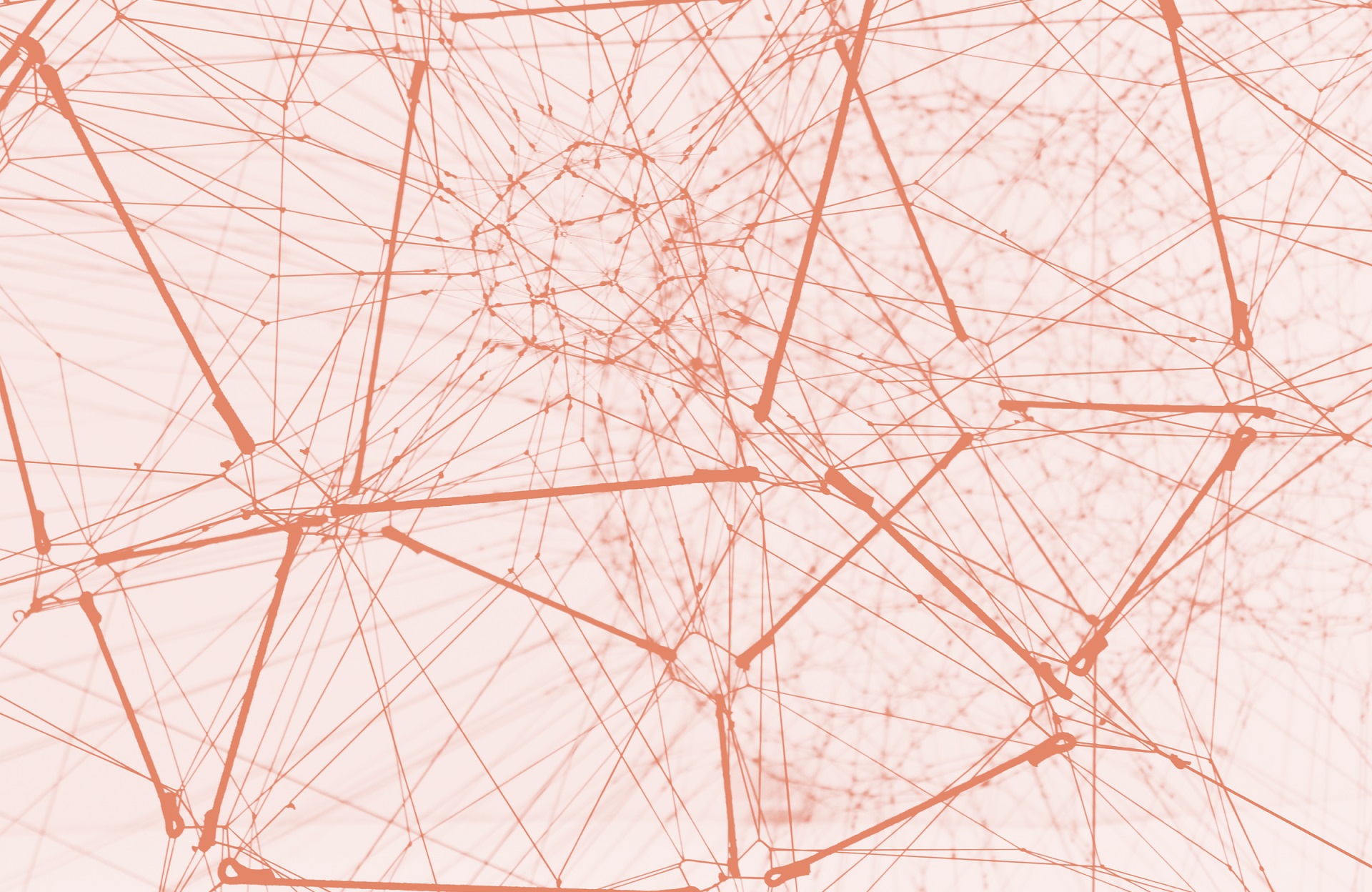« La surveillance des citoyens au nom de l’ordre public, tantôt généralisée et tantôt ciblée sur des ‘classes dangereuses’ est vieille comme l’État moderne. Il ne s’agit pas seulement des pratiques de régimes autoritaires telles que le fichier des Juifs de Vichy : c’est dès le règne de Louis XIV que l’on fiche prostituées, mendiants, nomades et mal-pensants ; et l’on sait aussi le profit que tira la police de ‘l’invention’, deux siècles plus tard, des empreintes digitales… sous un régime républicain et démocratique. »
C’est ainsi qu’en 2009 la Ligue des droits de l’Homme (LDH), ouvrait sa résolution de congrès, « Société de surveillance, vie privée et libertés ».
Des changements depuis 2009 ?
Dans le rapport d’information de la délégation sénatoriale à la prospective « Répondre avec efficacité pour retrouver nos libertés », les sénateurs constatent la méfiance de la population vis-à-vis des outils numériques proposés par le gouvernement pour lutter contre l’épidémie de Covid (StopCovid, puis TousAntiCovid) : « La sensibilité française sur le sujet est ancienne et profonde, et elle n’est pas dénuée de toute justification historique. On rappellera par exemple ‘l’affaire des fiches’ – [… ] – qui avait conduit à la chute du gouvernement d’Émile Combes en 1904, après la révélation d’une opération de fichage politiques et religieux dans l’armée française, dans le contexte des suites de l’affaire Dreyfus. On pourrait aussi évoquer, bien sûr, le régime de Vichy […] Dans l’imaginaire collectif, la collecte des données est associée à l’idée d’un État policier et d’un ‘fichage’ de la population… »
Une défiance largement justifiée
Dans la période récente, il faut bien admettre que les gouvernements successifs n’ont rien fait pour dissiper cette idée d’un « État policier ».
Sans remonter à 1974 et au projet d’interconnexion de plusieurs fichiers administratifs sous le nom de SAFARI (projet révélé par le journal Le Monde sous le titre « La chasse aux Français »), la liste des fichiers que la LDH a combattus est longue. La campagne contre le projet SAFARI avait à l’époque permis de faire reculer le gouvernement, et de voir la mise en place d’une Commission Informatique et Libertés qui donna en 1978 la loi « Informatique et Libertés », créant alors la première autorité indépendante, la CNIL, chargée de veiller à ce que l’usage de l’informatique ne puisse pas nuire aux individus. Ainsi la loi interdit le fichage des opinions politiques des individus (par l’État ou par un acteur privé) au même titre que celui de l’origine ethnique ou de l’orientation sexuelle. Ces données sont considérées comme des informations particulièrement sensibles. Mais cette loi, dont il faut souligner le caractère visionnaire de ses rédacteurs à une époque où l’internet n’était même pas imaginé, a subi de nombreuses révisions, liées à l’évolution des technologies. L’une d’elles, lourde de conséquences, est la perte du droit d’opposition de la CNIL à la création de fichiers de police. La CNIL n’a plus depuis 2004 que la possibilité de donner un avis non contraignant sur les décrets de création de fichiers.
Une liste infinie de fichiers dangereux pour les droits et libertés…
Pour la défense des droits et des libertés, la LDH s’est toujours opposée à la surveillance de l’État, au fichage indiscriminé des citoyens et a toujours veillé au respect de la vie privée, garant de la liberté de conscience et de la liberté d’expression. Les combats les plus emblématiques ont été ceux menés contre une série de fichiers de police ou administratifs : Faed, Fnaeg, Stic et Judex fusionnés en TAJ, Edvige, Evirsp, Cristina, TES et dernièrement ADOC.
Ainsi, la lutte contre le fichier EDVIGE (Exploitation Documentaire et Valorisation de l’Information Générale) en 2008 a certainement été le combat le plus retentissant. Une campagne de forte mobilisation avait permis de faire reculer le gouvernement. EDVIGE autorisait les policiers à ficher toute personne de plus de 13 ans exerçant ou ayant exercé un mandat politique, syndical ou économique, jouant un « rôle institutionnel, économique, social ou religieux significatif », et jugée « susceptible de porter atteinte à l’ordre public », permettait d’enregistrer des données sur l’orientation sexuelle des individus ainsi que sur leur santé. Les finalités de natures très distinctes d’EDVIGE, son champ très étendu, s’agissant des personnes concernées ou des données collectées, la possibilité d’enregistrer les origines raciales ou ethniques, ainsi que d’autres données sensibles relatives à la santé ou à la vie sexuelle, constituaient des menaces, entre autres, au respect de la vie privée, du principe de non-discrimination, du secret médical, du droit syndical ou encore du droit du travail. Dans ces combats les citoyens ont pu trouver le soutien d’institutions ou d’autorités administratives. Ainsi, le fichier EDVIGE avait fait l’objet de recommandations précises relatives à la collecte, au stockage et à l’utilisation de données personnelles sensibles par le Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies enjoignant la France à se conformer aux obligations qui lui incombent, notamment en vertu de l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. À cette occasion, la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme avait demandé que la création des fichiers de police ne puisse être autorisée que par une loi, en raison des menaces particulièrement graves qu’ils font peser sur les libertés publiques et la nécessité d’un large débat au Parlement.
Des évènements qui ont renforcé la surveillance…
Si les combats menés par de nombreux défenseurs des libertés ont permis quelques reculs, de nombreux évènements ont entraîné des logiques de plus en plus sécuritaires de la part des gouvernements successifs, et une volonté de surveiller de plus en plus de personnes. Les attentats terroristes ayant touché la France (2012, 2015, 2016), les manifestations des « gilets jaunes », puis la pandémie de Covid-19 ont prétendument « justifié » la mise en place de l’état d’urgence terroriste – puis de l’état d’urgence sanitaire – entraînant et justifiant une série de mesures liberticides. L’état d’urgence terroriste a vu, après 6 prorogations, l’intégration dans le droit commun en 2017 de nombreuses de ses dispositions liberticides précédées d’une inflation de textes législatifs. Le journaliste Marc Rees a ainsi pu dénombrer, de 2012 à 2017, pas moins de quatorze lois à caractère sécuritaire.
Parmi elles, la loi renseignement, validée par le Conseil Constitutionnel le 23 juillet 2015 malgré les combats des défenseurs de libertés. Nous avions pourtant dénoncé ses finalités, si larges que toute « atteinte à l’ordre public », comme la participation à une manifestation, peut faire l’objet d’une mise sur écoute, voir toutes ses actions sur internet surveillées avec les systèmes des « boites noires ». De même, nous avions dénoncé les pratiques illégales des services secrets que cette loi entérinait, et la mise en place de méthodes de surveillance lourdement intrusives sans autre garantie pour les libertés individuelles et le respect de la vie privée qu’une commission de contrôle, la CNCTR (Commission Nationale de Contrôle des Techniques de Renseignement), aux pouvoirs réduits. Nous avions surtout déploré la mise à l’écart du juge, gardien des libertés.
Un mouvement qui se poursuit depuis 2017
Depuis 2017 le gouvernement et les élus de la majorité présidentielle ne sont pas resté inactifs en matière de surveillance et nous avons assisté à une poursuite de ces mesures et une aggravation de leur caractère liberticide.
Lors d’une interview au media Brut, le 4 décembre 2020, le président de la République osait déclarer « Je ne peux pas laisser dire qu’on réduit les libertés en France… », alors qu’au même moment trois décrets étaient publiés modifiant les fichiers EASP, PASP et GIPASP dans un sens liberticide, tout comme l’ont été notamment deux textes de loi : la loi anti-casseurs et la loi Sécurité globale.
La loi dite « anti-casseurs » d’avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations (en s’attaquant à l’organisation illicite d’une manifestation, la dissimulation du visage, le port d’une arme) a également introduit des mesures de police administrative, en particulier l’interdiction de manifester pour une personne à l’égard de laquelle il « existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public » et qu’elle « appartient à un groupe ou entre en relation de manière régulière avec des individus incitant, facilitant ou participant à la commission de ces mêmes faits ». Son article 3 permettant au préfet d’interdire « par arrêté motivé » à une personne de participer à une manifestation au motif que celle-ci constituerait « une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public » par « ses agissements » a été censuré par le Conseil constitutionnel en raison de « la latitude excessive » que le texte laissait aux préfets. Compte tenu du caractère subjectif des motifs susceptibles de justifier l’interdiction préventive de manifester et du fichage des potentiels casseurs, ces mesures constituaient une atteinte disproportionnée à la liberté de manifester.
Sous prétexte de « protéger ceux qui nous protègent », la « loi pour une sécurité globale préservant les libertés » du 25 mai 2021 renforce l’impunité des forces de l’ordre mises en cause dans des violences graves ou mortelles. Son article 24 dispose par exemple qu’est « puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, dans le but qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l’image du visage ou tout autre élément d’identification d’un agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale autre que son numéro d’identification individuel lorsqu’il agit dans le cadre d’une opération de police ». Ces dispositions, ainsi que l’utilisation généralisée des drones et des caméras embarquées qui ouvre des perspectives de surveillance sans précédent, ont encore donné lieu à une mobilisation spectaculaire (y compris des plus hautes instances internationales de défense des Droits de l’Homme), parce qu’elles entravent directement la liberté d’opinion, la liberté d’informer et d’être informé, la liberté d’expression, d’association, de manifestation et de contestation légale. Le Conseil Constitutionnel a censuré ces dispositions.
La France glisse sûrement vers un régime autoritaire
Enfin, début décembre 2020, trois fichiers (créés en 2008) ont été modifiés en raison (selon le ministère de l’Intérieur) des « troubles graves à l’ordre public qui se sont développés depuis 2015 ». Il s’agit des fichiers Enquêtes Administratives liées à la Sécurité Publique (EASP), Prévention des Atteintes à la Sécurité Publique (PASP) et Gestion de l’Information et Prévention des Atteintes à la Sécurité Publique (GIPASP), dont la finalité est de « recueillir, conserver et d’analyser les informations qui concernent les personnes (…) ainsi que les groupements dont l’activité individuelle ou collective indique qu’elles peuvent être susceptibles de prendre part à des activités terroristes, de porter atteinte à l’intégrité du territoire ou des institutions de la République ou d’être impliquées dans des actions de violence collectives, en particulier en milieu urbain ou à l’occasion de manifestations sportives ». Les trois fichiers permettent de collecter des informations sur les opinions politiques (et non plus les activités), l’appartenance syndicale, l’orientation sexuelle, les données de santé… ou les activités sur les réseaux sociaux (identifiants, photos, commentaires…) des personnes physiques ou morales « susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, à l’intégrité du territoire, ou des institutions de la République ». Ces décrets ont permis de consulter des fichiers par croisement, dont notamment le TAJ (Traitement des Antécédents Judiciaires), qui permet la reconnaissance faciale et donc le fichage biométrique. Ces fichiers sont devenus également consultables par le procureur de la République : on voit là une porosité de la police administrative (préventive) et judiciaire (répressive), très préjudiciable pour la vie privée et les libertés publiques. Ces extensions ont fait l’objet de plusieurs recours au Conseil d’État, notamment en raison du changement des termes « activités » pour « opinions », ouvrant la porte à toutes les suspicions. Malheureusement, le Conseil d’État a validé les finalités des trois fichiers, et si la suppression des données se rattachant aux opinions politiques et aux convictions religieuses et philosophiques a été ordonnée, elle ne sera effective que si le gouvernement ne vient pas « couvrir » cette illégalité par de nouveaux décrets dans un délai de 4 mois. Autant dire que le Conseil d’État ouvre la porte à ce fichage extensif ! Dans la même veine, en mars 2020 le Conseil d’État a validé l’interconnexion du fichier Hopsyweb (fichier des personnes hospitalisée en psychiatrie sans contentement) avec le FSPRT (fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste) et ce malgré les risques sérieux d’atteinte aux droits des patients, de violation du secret médical ou encore du respect de la dignité humaine. Ces trois décrets du 2 décembre 2020 élargissant les possibilités de fichage des militants et de leur entourage constituent donc une nouvelle offensive sécuritaire, qui pose les fondements d’une société de surveillance et montre que l’offensive contre nos libertés fondamentales se poursuit.
Toutes ces mesures liberticides conduisent à considérer que la France glisse sûrement vers un régime autoritaire, un État illibéral, un État de police. En effet, lorsque le pouvoir décide du sort des individus (y compris des mineurs de 13 ans) à partir des données qui concernent le passé, le présent, la vie familiale, la vie sociale, la santé, et les opinions politiques et religieuses supposées, la sécurité juridique est compromise et l’État de droit menacé. Il est urgent que la société civile tout entière en prenne conscience.
Maryse Artiguelong est vice-présidente de la Ligue des Droits de l’Homme.
 Les discriminations – comme les
Les discriminations – comme les