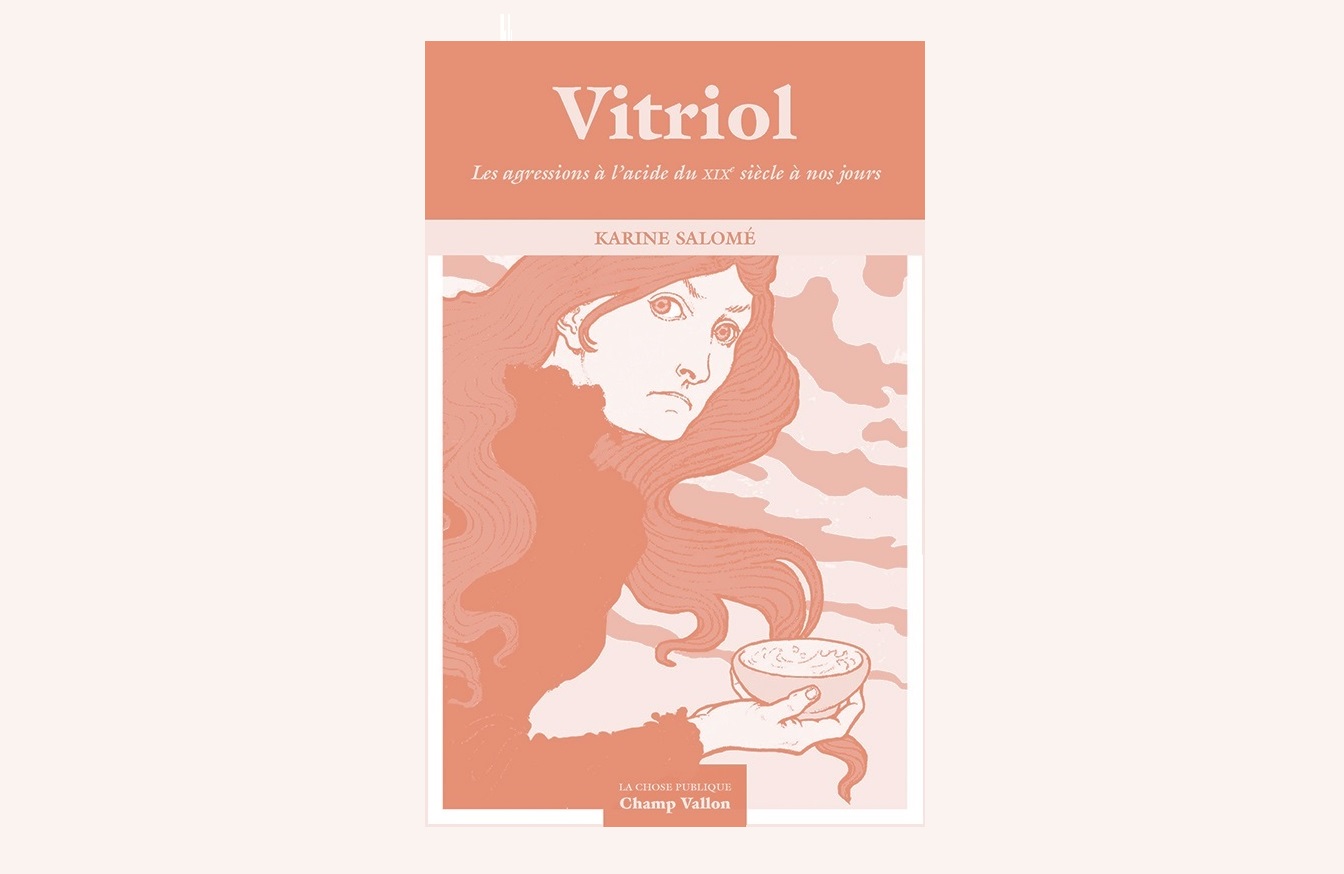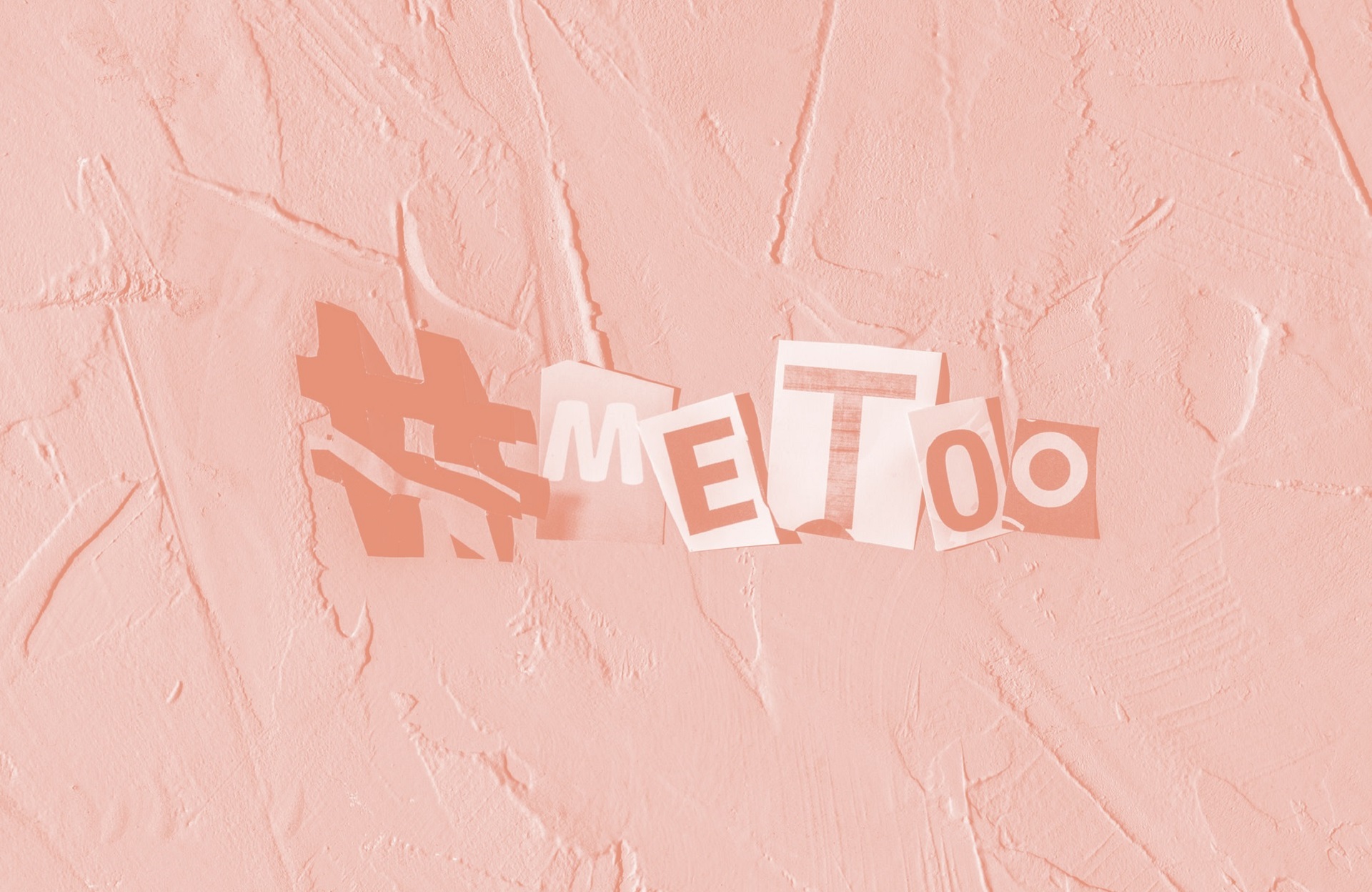Marcia Burnier a publié en septembre Les orageuses, un premier roman foisonnant où elle aborde dans toute leur complexité les questions de survie après les violences, de justice et de sororité – sans oublier non plus les relations queers.
Il nous a donc semblé évident de lui proposer un entretien, à l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.
Peut-on dire que votre livre a été écrit pour aider les personnes qui ont subi des violences sexuelles ?
Je pense effectivement que c’est le public premier de ce livre, non pas pour les « aider » mais parce que je l’ai écrit d’abord pour moi, pour aller mieux, ainsi que pour mes copines, en ayant en tête toutes celles dont l’histoire n’était que rarement racontée.
Je ne sais pas si je l’ai écrit uniquement pour elles, mais je voulais que les personnes qui ont été victimes de violences sexuelles puissent le lire et s’y retrouver. C’est un point qui n’est souvent pas assez pris en compte dans la littérature qui parle de viol, d’agression sexuelle ou d’inceste. Souvent, l’auteur a une envie très forte de montrer l’horreur des violences sexuelles, et il va donc décrire avec emphase et détails certaines scènes qui peuvent être extrêmement difficiles à lire lorsqu’on a été victime de viol. J’ai tenté d’éviter ça le plus possible.
Je n’avais pas non plus envie d’écrire un livre qui se termine très mal, ou qui propose des personnages de survivantes très fortes, qui n’ont pas d’angoisse, pas de peur, et qui vont entreprendre des vengeances complètement sorties du réel. J’avais envie de montrer une possibilité de réparation qui soit « plausible », qui donne un peu d’espoir.
Après j’ai aussi écrit ce livre pour d’autres publics, et pour qu’il puisse sortir du cercle des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles. Je l’ai écrit en pensant à tout ce que j’aurais envie de dire à mon entourage mais que j’ai la flemme de répéter encore, et encore, et encore. Évidement, c’est aussi potentiellement un livre que des hommes qui n’auraient pas été victimes de viol peuvent lire pour essayer de se mettre un tout petit peu plus à la place des survivant·e·s. Et, avec surprise, j’ai eu de nombreux retours d’hommes qui m’écrivaient pour me dire qu’effectivement, le livre les avait fait réfléchir, et c’est tant mieux.
Restituer l’épuisement des victimes de violences vous semblait donc important ?
Il me semble en effet assez essentiel de montrer à quel point tenter de continuer sa vie après un viol peut fatiguer et prendre du temps.
C’est quelque chose qu’on passe souvent sous silence : on fantasme parfois sur les vengeances qui pourraient arriver, et on oublie de rappeler que lorsqu’on a été victime de viol, essayer de survivre, de continuer à fonctionner, de retrouver une vie qui soit satisfaisante prend beaucoup de temps et d’énergie. Toutes les victimes de viol ne sont pas dans cet état post-traumatique, mais elles sont beaucoup à s’y trouver. On n’a donc pas toujours beaucoup de forces à accorder au fait de se « rendre justice ». Ce que je répète souvent, c’est que ce livre montre que les victimes font ce qu’elles peuvent pour se réparer, et qu’il n’y a pas de standards à avoir sur le sujet.
Vous montrez aussi toute la complexité des conséquences du viol, avec des femmes qui ne s’en remettent pas de la même manière – et qui n’en sont pas moins proches.
Oui. Il est important de rappeler que lorsqu’on a été victime de violences sexuelles, les réactions et les conséquences ne sont pas uniformes : nous n’avons pas toutes le même traumatisme, les mêmes symptômes ou le même timing. On se perd vite lorsqu’on commence à plaquer une seule réaction, ou une seule conséquence possible sur tout le monde, qu’on essaie à tout prix de faire rentrer les victimes de viol dans un moule qui serait unique.
C’est souvent là que ça coince : soit on imagine que la personne devrait être complètement détruite, soit on imagine qu’elle devrait aller de l’avant. On projette énormément des choses sur la victime, alors que les réactions des victimes sont souvent loin de ce qu’on imagine.
Je voulais donc montrer cette diversité de traumas, de réactions – et qui, en en effet, n’est pas du tout un frein pour la sororité. Ces femmes se rejoignent pour dénoncer ces hommes, et dire qu’ils n’avaient pas le droit de leur infliger ces violences-là. L’essentiel est que chaque réaction soit respectée. Virginie Despentes le dit dans King Kong Théorie : les injonctions contradictoires sont très difficiles à supporter pour les victimes. On leur en veut d’être en vie. Une bonne victime de viol pour la société, c’est une victime tellement dévastée qu’elle en est morte. La survie est donc quelque chose qu’on vient reprocher aux victimes de viol. Non seulement on survit, mais on ne survit pas comme les gens aimeraient qu’on survive. On en parle trop, trop fort, on va trop mal, ou au contraire pas assez, on sort trop ou trop peu, notre vie sexuelle est trop impactée, ou pas assez, etc. Cela laisse une espèce d’entre-deux que j’ai essayé de décrire dans le livre : non seulement il faut arriver à survivre, mais il faut aussi réussir à naviguer entre les différentes injonctions qu’on a dans l’entourage, au travail…
Vous avez dénoncé dans un entretien le côté « punitif » de certaines décisions de justice. De l’autre, les protagonistes de votre livre font le choix de se « rendre justice » elles-mêmes, et vont chez les hommes qui les ont violées pour détruire ou voler du mobilier. Bien sûr, il s’agit d’un procédé littéraire… et elles-mêmes parlent plus de réparation que de vengeance. Mais quelle distinction faites-vous entre le fait de se « rendre justice » soi-même et de se venger ?
C’est une longue question : qui a la charge de nous rendre justice, et de nous offrir réparation ? En l’occurrence, sur la question des violences sexuelles et sexistes, la justice d’État échoue complètement. Qu’on soit pour ou contre une justice punitive ou carcérale, le fait est qu’en France aujourd’hui, cette justice ne fonctionne pas. Elle n’existe presque pas. Ce sont environ 1% des violeurs qui sont condamnés, et ce chiffre ne rend pas compte du parcours du combattant qui attend les victimes de viol ou d’agression sexuelle, mineure ou majeure pour obtenir justice, de la difficulté à accéder à la plainte, des refus d’enregistrements, des requalifications des viols en agressions sexuelles, en atteinte sexuelle, etc. On voit au quotidien que la justice est incapable de rendre compte d’un viol, de comprendre ce qui s’y joue. Et dans une société qui n’est plus en capacité de donner justice, il me semble difficile de décider que les victimes de viol ou d’agression sexuelle n’auraient pas d’autre choix que l’oubli ou le pardon.
Cela me semble difficile à entendre, pour des raisons de santé mentale, d’équilibre, de récidive bien évidemment – puisque s’il n’y a jamais de conséquence, il n’y a aucune raison que les violeurs s’arrêtent de violer –, mais aussi pour des questions économiques – aller de l’avant coûte très cher : la thérapie, le déménagement si besoin, le divorce éventuel, tout ça a un coût qui pour l’instant repose presque exclusivement sur la victime, et qui crée donc évidemment des discriminations fortes.
Cette non-justice est un non-sens, et nous donne des raisons de s’interroger sur ce qu’on peut faire nous. Je ne crois pas que la justice prise en charge par les victimes puisse être une solution durable : elles ont d’autres choses à faire. Mais dans notre société actuelle, elles n’ont pas tellement d’autres choix.
Ce que je propose avec ce livre, c’est de penser la question de la sororité, et la possibilité de se rendre justice entre nous, de réimaginer les possibles qui nous font du bien, de s’autoriser à les penser, à les interroger.
Dans les Orageuses, toutes les filles n’obtiennent pas justice par rapport à leur propre viol, certaines ont été violées par quelqu’un qui n’est pas retrouvable, et de fait, les « vengeances » qui sont menées ne sont pas très violentes… Ces femmes cherchent surtout à accomplir quelque chose de faisable, qui leur fasse du bien. L’idée pour elles est de marquer la vie du violeur à un moment donné. Cela ne va évidemment pas la marquer à hauteur du traumatisme, mais elles espèrent laisser un petit point à un endroit de sa vie pour qu’il se souvienne de ce qu’il a fait, et de sentir qu’ensemble, elles peuvent avoir de la force.
Je trouve très intéressantes les mobilisations autour du féminisme anticarcéral, mais je pense que dans le cas des violences sexuelles ou conjugales, l’injonction de justice doit surtout cesser de reposer sur les victimes. Je pense que la limite est là. Je trouve très intéressant de parler des alternatives à la prison, et de montrer à quel point celle-ci n’est pas un outil de réparation mais un outil de domination des populations pauvres et/ou racisées. Mais je n’ai pas envie qu’il y ait un glissement et qu’on dise que les victimes ne doivent pas porter plainte et qu’elles doivent tout porter elles-mêmes, alors qu’elles font ce qu’elles peuvent pour se protéger. Tant qu’il n’y aura pas de réponse collective et communautaire aux violences sexuelles et sexistes, tant qu’on ne pourra pas s’appuyer sur le groupe pour gérer les agresseurs, alors on ne peut pas non plus mettre tout le poids de l’anticarcéralisme sur les victimes.
Pour finir, y a-t-il des questions que vous regrettez de ne pouvoir aborder plus souvent dans vos entretiens ?
Je m’interroge sur le fait qu’on discute peu de la manière dont la littérature peut s’emparer des expériences de vie. Je trouve intéressant qu’en France on peine à imaginer que l’expérience vécue des femmes notamment puisse mener à une œuvre littéraire, une œuvre de fiction. C’est encore difficile d’envisager, notamment quand il s’agit de personnes minorisées, que l’expérience vécue puisse donner lieu à autre chose qu’un témoignage.
L’autre chose qui m’interroge, c’est que je n’ai jamais de question sur le fait que les deux personnages principaux du livre ne sont pas hétéros. C’est un angle mort des interviews, et je me pose la question du pourquoi. Est-ce que c’est une bonne nouvelle, qui montre que c’est aujourd’hui tout à fait normalisé ? Est-ce une forme de pudeur, ou la conviction que ce sujet n’est pas essentiel ? Est-ce qu’on a du mal à imaginer que des femmes non hétéros puissent être victimes de viol, ou que la sexualité puisse être autre chose que très scindée en deux (des femmes lesbiennes qui n’auraient jamais eu de contact avec des hommes cis, et des femmes hétéros qui n’auraient eu que des contacts avec de hommes cis, sans entre-deux ou possibilité d’un parcours de vie différent) ?
En tant que lesbienne, je pense que c’est un sujet dont il est intéressant de discuter. Je pense aussi que la représentation des femmes non hétéros dans la littérature n’est pas toujours très abondante, et il était important pour moi qu’elles aient une présence dans ce livre.
L’entretien a été mené par Paul Tommasi.