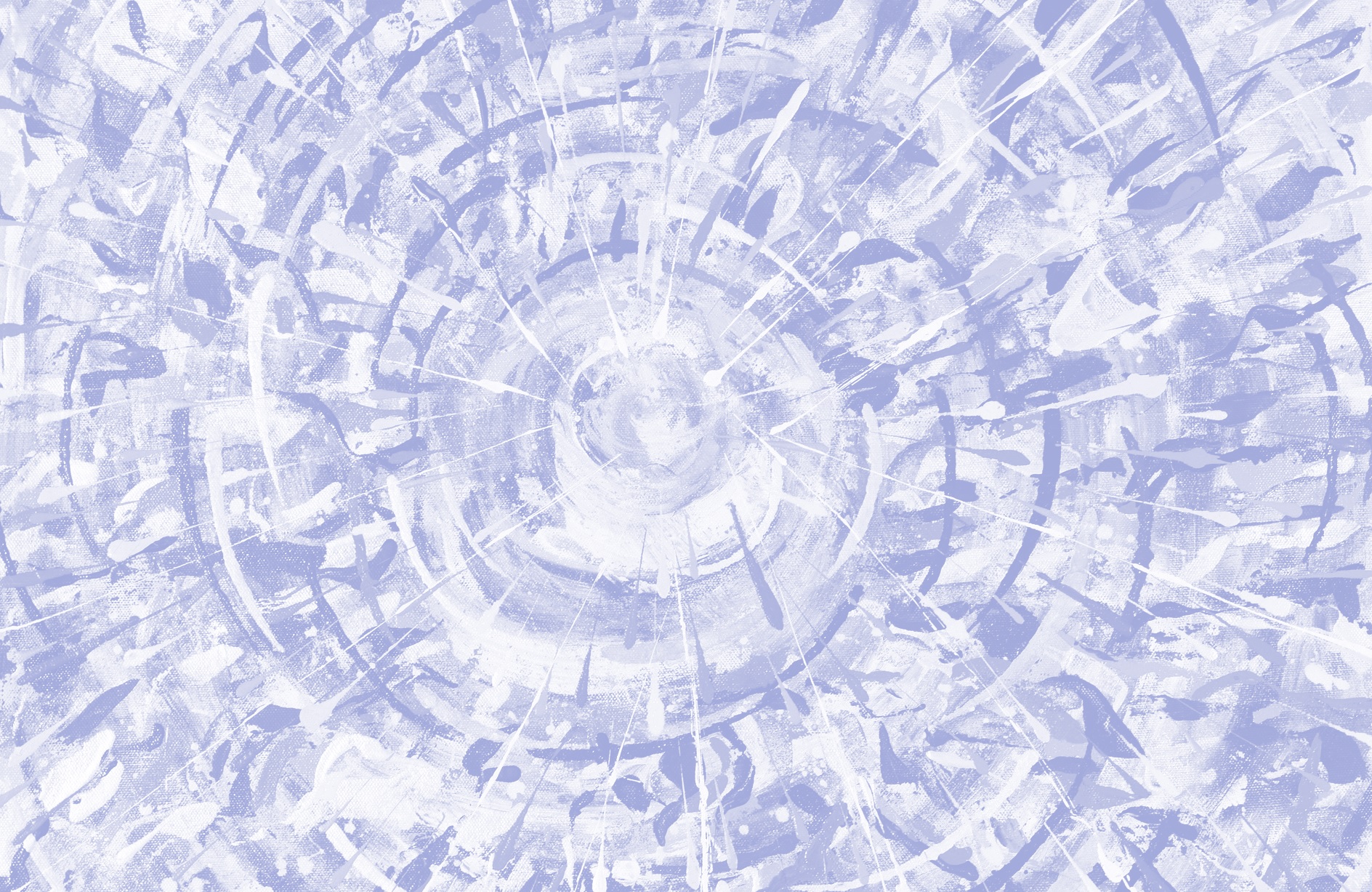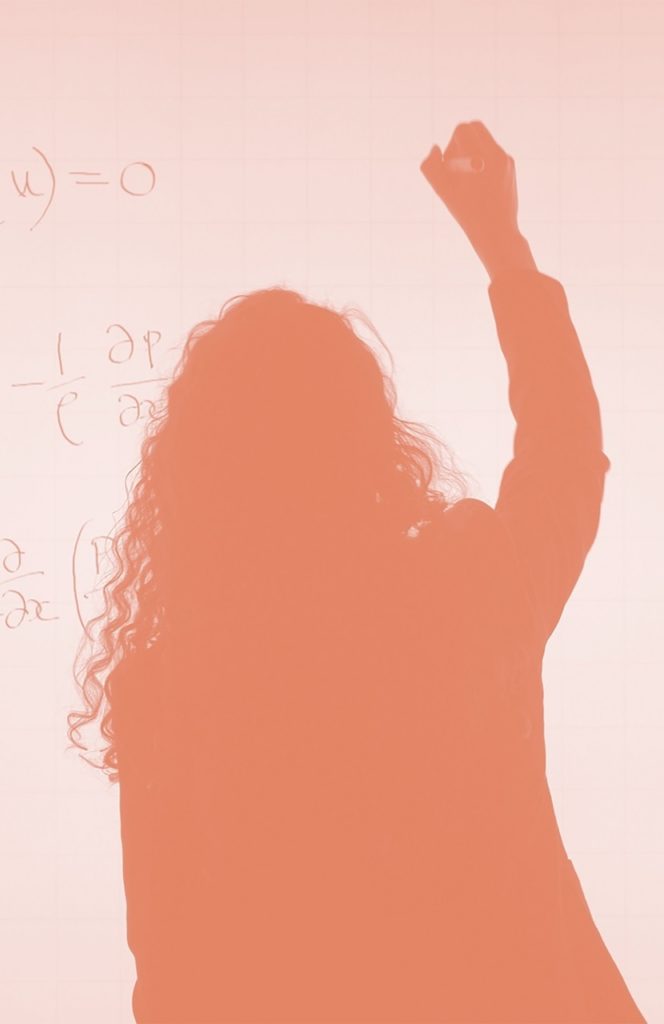
Un souvenir d’enfance me revient à l’esprit : moi, assise à mon bureau, échouant une soirée entière à résoudre des inéquations trigonométriques. Ma mère, passant par là, m’explique que je n’y pouvais rien car, comme mes aîné·e·s, j’étais une littéraire. Et voilà qu’aujourd’hui je consacre un article à l’ouvrage de Clémence Perronnet, La bosse des maths n’existe pas (Éditions Autrement, 2021), fruit d’une thèse présentée en 2018. Docteure en sociologie et maîtresse de conférences en sciences de l’éducation à l’Université Catholique de l’Ouest, l’auteure s’est consacrée, tout au long de ses travaux, à la culture sociale en matière de sciences selon le genre, l’origine sociale et raciale. L’inéquation que tente de résoudre l’auteure porte sur les inégalités des chances face aux sciences. Elle croise ici le cas des dominé·e·s: femmes, classes populaires et minorités ethnoracisées. Si l’étude des discriminations de genre dans les sciences est amorcée depuis plus de trente ans, tel est moins le cas pour celles concernant les milieux populaires et minorités ethnoracisées. Cette recherche entrecroisée permet de comprendre les mécanismes de marginalisation des groupes dominés en trouvant le dénominateur commun entre ces dominations. La documentation du livre, faisant appel à des études nationales mais également mondiales, permet de prendre conscience de l’ampleur de la situation en France. D’après un rapport de l’OCDE1OCDE, PISA 2012 : Savoirs et savoir-faire des élèves. Performance des élèves en mathématiques, en compréhension de l’écrit et en science (Volume I), Éditions OCDE, 2013, figure II.1.2., le pays des Lumières est le champion de l’inégalité face aux mathématiques. La source principale de l’auteure est une enquête qualitative menée pendant quatre ans dans des établissements classés REP+, au cours de laquelle une cinquantaine d’enfants ont été interrogés et suivis de leur CM1 à leur 5e. Chaque thèse présentée dans le livre est illustrée par le portrait d’un·e élève. Ce travail est rythmé par des données chiffrées conséquentes, offrant une vision réelle des discriminations face aux sciences.
Le mythe de la « bosse des maths »
La sociologue ouvre le sujet en s’attaquant aux mythes dûment établis depuis des siècles. Les premières lignes de l’ouvrage retracent l’histoire de ces inégalités, qui se cristallisent dès l’avènement de l’école républicaine. On distingue alors les disciplines scolaires en deux pôles : un premier englobant celles relevant de la nature et de la matière qu’on nomme « science », et un second correspondant aux langues, humanités et beaux-arts formant ce qui est appelé « culture ». Très vite, le premier pôle devient celui qui ouvre la voie aux filières les plus prestigieuses. Les sciences sont alors perçues comme vectrices d’une réussite par le mérite. Ne parle-t-on pas de voie d’or pour l’ancienne filière S ? Perçues comme neutres, les sciences seraient non discriminantes et assureraient la mécanique de l’ascenseur social.
Pour autant, plusieurs groupes de populations sont éloignés de la culture scientifique. Et c’est bien là que s’ancre la problématique de l’ouvrage. Pourquoi une frange de la population n’aurait-elle pas « la bosse des maths » ? Cette expression française, fondée au XIXe siècle, renvoie à l’idée qu’une part de la population aurait une appétence naturelle pour les mathématiques. Cet amour des mathématiques développerait une bosse visible sur une partie du crâne. Cette théorie se fonde sur l’idée d’un don inné pour la matière. Bien que contestée depuis plusieurs décennies, cette idée a toujours le vent en poupe dans l’imaginaire collectif. Ainsi, les femmes auraient une appétence naturelle plus forte pour les lettres que pour les mathématiques. Parallèlement, la vision défendue par l’école républicaine d’un acquis en science générateur d’égalité des chances pose problème. Cette vision sous-entend en effet que les classes populaires se désintéresseraient volontairement des sciences, et refuseraient de comprendre leurs avantages individuels et collectifs. Ainsi, l’accusation est continuellement portée à l’encontre des dominé·e·s. En effet, on n’interroge jamais le rôle des institutions et de la culture scientifique dans ces inégalités. La présomption d’innocence accordée aux sciences et institutions est toujours en vigueur. Mais voilà, études en mains, Clémence Perronnet met à mal tous ces mythes.
Des inégalités diverses
L’auteure recense trois grandes inégalités vis-à-vis de la formation en sciences, à commencer par celle qui forme le cœur de l’ouvrage : la discrimination en raison du sexe. Elle est la plus étudiée et souvent présentée comme étant la plus prononcée et violente. En effet, les femmes ont moins de postes à haute responsabilité. Leur présence dans le domaine scientifique se caractérise principalement dans les professions liées au secteur du « care« , comme la médecine. Ceci est lié à la représentation sociale du personnage féminin qui a une vocation unique : celle de la figure maternelle.
Seulement, d’autres discriminations existent – et génèrent autant, si ce n’est plus d’inégalités. En 2013, si 41% des enfants de cadres font un bac S, seuls 10% d’élèves issus des classes populaires s’y consacrent. Cette statistique explique notamment que les enfants racisés ou/et issus de classes populaires soient plus présents dans des professions subalternes, et ce plus encore pour les garçons. Convaincu·e·s de leur impossible réussite dans ces domaines, les dominé·e·s se laisseraient porter par une « autocensure ». Ces « prophéties autoréalisatrices » seraient en réalité la conséquence directe des « lois sociales »
Clémence Perronnet note ici que la dotation en capital culturel dans les foyers populaires, à l’instar des jeux, magazines éducatifs et sorties culturelles, est souvent bien maigre. Un tiers des enfants interrogés n’a pas de contact avec la culture scientifique, en dehors de celle transmise par l’audiovisuel. Contrairement à ce qui est rendu visible dans la pensée collective, ce fait n’est pas lié à une révulsion pour les sciences de la part des familles populaires. En réalité, la culture scientifique est un luxe hors de portée de ces milieux. Les lieux de culture, générant à leur tour une violence symbolique, renforcent l’exclusion. Parallèlement, l’école française promeut le modèle d’une gestion des loisirs dans un but éducatif. Ce mode de productivité éducative est pratiqué par les familles les plus aisées et non par les classes populaires. En effet, ces dernières ne considèrent pas que les loisirs représentent des enjeux dans la construction éducative de leur enfant. L’institution scolaire fait ainsi émerger un sentiment de honte chez les classes populaires et immigrées.
De plus, les familles immigrées privilégient les domaines littéraires, la première violence scolaire vécue par les mères restant celle d’un défaut de maîtrise de la langue française qu’il faut à tout prix pallier. Quoi qu’il arrive, le succès en science est perçu par les familles comme inné.
Concernant les médiateurs du savoir auprès des enfants, la figure maternelle, affiliée à l’éducation des enfants, est une des intermédiaires de la culture scientifique. Cependant, c’est un autre membre de la famille qui semble être le plus souvent déterminant dans ce processus. Les ainé·e·s qui ont réussi à l’école, et en particulier les grandes sœurs, jouent ainsi le rôle d’un rouage fondamental dans l’appropriation des sciences.
L’école est bien évidemment un autre médiateur privilégié. On constate que dans les établissements en milieu populaire, comme ceux au cœur de l’étude, bon nombre de programmes scolaires et extra-scolaires visent à l’appropriation de ce savoir. Toutefois, ces dispositifs restent trop maigres pour pérenniser le goût des sciences. Par ailleurs, plus l’élève est en difficulté, plus le sentiment de rejet des sciences émerge pour symboliser une résistance face à l’institution scolaire. La réussite dans les matières scientifiques étant l’outil de classification des élèves utilisé par l’école, rejeter les maths revient à rejeter cette hiérarchisation et l’institution qui en est à l’origine.
Des stéréotypes présents dans la culture littéraire et audiovisuelle
Émettre cette dernière idée revient cependant à placer à nouveau la responsabilité du désamour des sciences sur les dominé·e·s, garçons ou filles. Pour ces dernières, l’auteure détruit le mythe d’un sexisme prépondérant dans les milieux populaires et immigrés. Les enfants interrogés expriment une vision égalitaire quant à l’accès à l’emploi pour les deux sexes… à l’exception près de la figure du scientifique. Cette dernière est perçue, par les enfants, sous des traits masculins. Pour autant, eux-mêmes n’ont ni capital culturel scientifique ni hommes dans leur entourage pouvant représenter ce modèle. En réalité cette représentation du scientifique est due au monde de l’audiovisuel, des manuels scolaires et de la littérature jeunesse. Principales sources de documentation et de loisir des enfants, les femmes y sont dissociées des professions scientifiques. Par exemple, les femmes ne représentent que 13% des personnages scientifiques dans les dessins animés. C’est donc la culture scientifique qui est sexiste. Elle définit les rôles attribués aux hommes et femmes selon leur genre. De plus, la présence de grandes figures scientifiques féminines est niée au profit de celle de leurs époux. Le cas le plus parlant reste celui de Marie Curie. Même quand la présence des femmes scientifiques s’accroît, celles-ci sont souvent « hypersexualisées » ou bien « déshumanisées », à l’image de Sandra Bullock dans Love Potion (1992). Si une femme s’adonne aux sciences, c’est donc qu’elle rejette ses caractéristiques genrées et sociales, ou qu’elle n’est pas vraiment scientifique. Si on en croit la culture littéraire et audiovisuelle, on ne peut être femme et scientifique. Et c’est de cette représentation qu’héritent les enfants. C’est notamment le cas des filles dont l’amour pour les sciences reste incompatible avec la projection qu’elles ont d’elles-mêmes. Les filles ne sont néanmoins pas les seules exclues. Puisque le scientifique est masculin mais aussi un génie issu des élites blanches, il est difficile aux garçons des classes populaires et immigrées de s’y identifier.
Le système scolaire classifie intellectuellement les élèves selon leurs performances mathématiques. Les « intellos » sont donc naturellement orientés vers les sciences. Du fait d’une « prophétie autoréalisatrice » orientant les garçons issus des milieux populaires vers les filières professionnalisantes, et d’un taux de réussite scolaire plus élevé chez les filles, c’est à celles-ci que les enfants pensent en premier lieu. Toutefois, les attributs masculins du scientifique les disqualifient dans l’imaginaire des enfants. C’est pourquoi les filles ainsi que les enfants des classes populaires et immigrées se perçoivent souvent inaptes aux sciences ; et dans le cas inverse, un futur dans le domaine leur semble impossible en raison des différentes discriminations genrées et raciales. En réalité l’autocensure pratiquée par les dominé·e·s est le fruit d’une disqualification générée par les représentations sociales de ces disciplines.
Des inégalités à déconstruire
Alors, comment déconstruire ces inégalités ? Dans un dernier chapitre l’auteure présente ses conclusions quant aux différentes théories abordées et proposent des solutions. Clémence Perronnet invite à déconstruire l’idée d’un don naturel pour une discipline selon son genre ou origine sociale. Les outils de médiation scientifique aussi bien télévisuels, éducatifs que littéraires doivent s’ouvrir à la pluralité des modèles scientifiques hommes et femmes. Ces derniers ne doivent pas se fonder uniquement sur des figures d’exception comme Marie Curie qui, avec ses deux prix Nobel, peut engendrer l’idée qu’il faut des compétences exceptionnelles pour devenir une scientifique. Le marketing doit quant à lui connaître une révolution. Il est temps de délaisser les outils ludiques du type cosmetic lab qui reposent sur un référentiel genré – et qui limitent les ambitions des filles aux seuls domaines du « care » ou de la cosmétique. Les ateliers pédagogiques dans les milieux populaires qui usent trop souvent de stéréotypes proposant des activités autour des emplois subalternes comme le bricolage doivent offrir d’autres perspectives. Enfin, il faudrait repenser la langue de manière inclusive afin que le féminin réinvestisse le champ linguistique.
Malgré un sujet au cœur des études scientifiques, le bilan de l’auteure est plus que mitigé concernant le progrès vers l’égalité face aux sciences. Ces dernières restent aujourd’hui encore pensées par les dominants et pour les dominants. Véritable « outil de pouvoir », le dégoût des maths ne relève pas du choix ou de prédispositions naturelles, mais bel et bien d’un mécanisme d’une politique sociale qui a pour effet la marginalisation d’une part de la population. Ce n’est donc ni le manque de confiance, ni le manque d’investissement mais bien la culture scientifique qui met au ban des sciences une part de la population. Or, comme l’indique à juste titre Clémence Perronnet, les inégalités face aux sciences sont un enjeu primordial pour assurer la viabilité économique et la compétitivité d’un État à l’échelle internationale.
Rezlane Kamli est historienne de formation et contributrice de dièses.