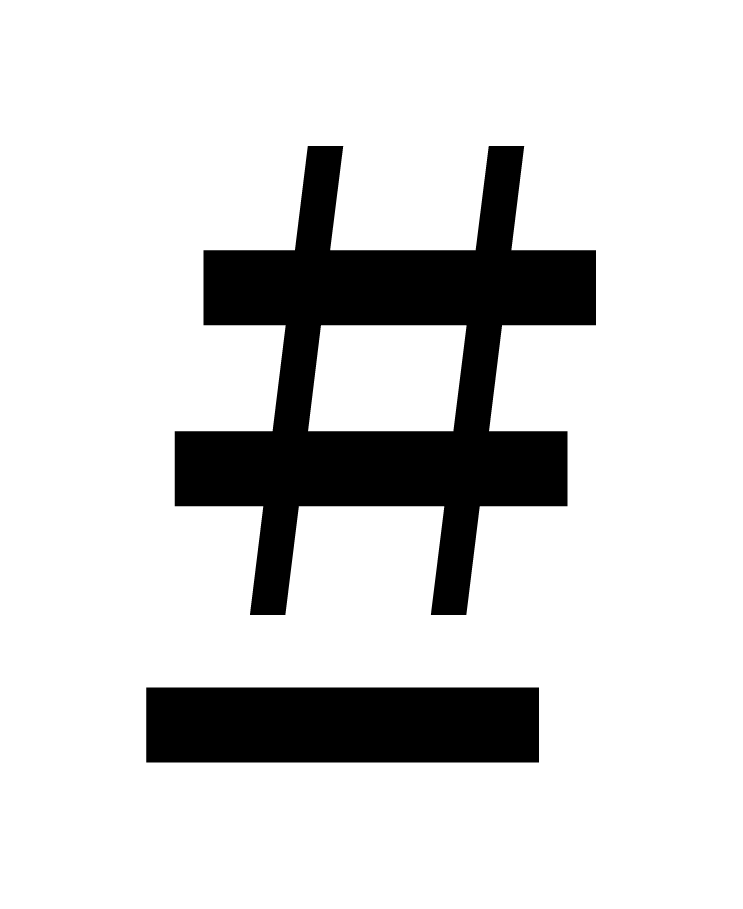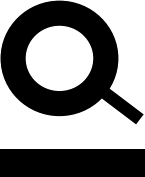Dans Écrire sa vie, devenir auteur. Le témoignage ouvrier depuis 1945 (Éditions de l’EHESS, 2021), l’historienne Éliane Le Port, elle-même petite-fille et fille d’ouvriers qui ne voulaient pas qu’elle le devienne à son tour, prend pour objet de recherche un univers et une condition qui lui sont familiers depuis l’enfance.
Issu d’une thèse d’histoire contemporaine, l’ouvrage, riche et dense, aborde l’évolution des mondes ouvriers et de leurs représentations depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Leurs profondes mutations professionnelles, politiques et sociales sont étudiées à travers un matériau principal : les témoignages, socialement improbables, rédigés entre 1945 et 2016 en France par une centaine d’ouvrier·e·s de différentes générations. Prenant ces écritures ouvrières au sérieux, Éliane Le Port les saisit sous un prisme véritablement original : celui des parcours, des publications et des pratiques concrètes dans un univers où prendre la plume pour se raconter ne va pas de soi. L’angle choisi par l’historienne consiste ainsi à mettre en lumière des points aveugles des travaux scientifiques, notamment d’histoire sociale, qui ont jusqu’alors essentiellement exploité ces témoignages ouvriers pour leur dimension documentaire. Sont analysées les propriétés sociales et les trajectoires scolaires, post-scolaires, professionnelles et militantes de ces auteur·e·s, les conditions matérielles de production de leurs textes, c’est-à-dire les contextes, motivations et modalités concrètes (lieux, moments, rythmes, incitations à écrire…). Leur entrée en écriture, les filiations littéraires revendiquées, les formes variées de ces prises de parole écrites et leurs logiques, les représentations que les ouvrier·e·s y construisent et (re)composent d’eux/elles-mêmes, sont aussi objectivées. Sont étudiées, enfin, les modalités de publication, en autoédition, à compte d’auteur·e ou d’éditeur·rice, chez quel éditeur (politisé), exprimant quelles attentes, et, au-delà, les conditions d’édition et de reconnaissance de ces écrits, ainsi que les effets produits par la publication sur les trajectoires sociobiographiques des auteur·e·s.
Ces hommes et ces femmes de catégories populaires qui se mettent à écrire sur leur expérience du travail ne constituent pas un groupe aux propriétés homogènes. Si une majorité est syndiquée (les deux-tiers des ouvrier·e·s du corpus, soit nettement plus que dans la population ouvrière totale, majoritairement à la CGT), d’autres ne le sont pas. Un quart est militant politique, essentiellement au Parti communiste ou, selon la période, dans des mouvements d’extrême gauche. Tou·te·s n’évoquent d’ailleurs pas cet engagement dans leurs récits. Avec leurs mots, déjouant les assignations sociales, ces ouvrier·e·s-écrivain·e·s ont pourtant, sur la base de notes prises quotidiennement, pendant quelques mois ou plusieurs décennies, raconté leurs rapports à un travail épuisant, parfois dangereux, à l’usine, dans l’atelier, dans la mine ou sur les chantiers. Leurs luttes, leurs préoccupations, mais aussi leurs pratiques, notamment culturelles et cultivées dans la vie quotidienne et l’espace privé, témoignent ainsi de leurs expériences du monde et de leur condition.
L’objectif du long bornage temporel retenu par l’historienne est de mettre en évidence, à travers ces récits situés, l’évolution des représentations et de la place du monde ouvrier, qui affecte tant les attentes des éditeurs que les formes de l’écriture. La première période, qui s’étend de 1945 à la fin des années 1970, est caractérisée par la centralité politique de la classe ouvrière, la seconde par la désindustrialisation, les fermetures d’usines et des mines, la précarisation et l’effondrement du groupe, faisant de lui « un monde défait » pour reprendre l’expression de Bernard Pudal1Un monde défait – Les communistes français de 1956 à nos jours, Éditions du Croquant, 2009..
« L’écriture ne s’efface pas dans l’identité ouvrière » : le « devenir auteur » et ses effets
L’activité d’écriture des ouvrier·e·s est manifestement plus fréquente qu’on aurait pu l’imaginer. Éliane Le Port étudie ainsi 157 récits publiés au total, issus de 105 auteur·e·s investi·e·s dans 21 secteurs professionnels (les mines, l’automobile, la métallurgie et la sidérurgie étant toutefois surreprésentées). Elle repose souvent sur la volonté politique d’afficher, non pas son individualité, mais son appartenance (parfois ancienne) au groupe, de servir ses valeurs et ses intérêts, voire de participer à son émancipation présente ou future, ou encore d’accéder au porte-parolat en intervenant dans l’espace public. Si, dans un tel contexte, écrire sur soi signifie parler d’une classe, évoquer un « nous » ouvrier collectif, son univers, ses luttes et les mutations qui l’affectent, écrire ne se réduit pas à ce seul engagement. L’exercice constitue aussi une manière, faite de heurs et parfois de malheurs, de (re)construire son identité sociale et professionnelle, mais également de « sortir de son état ». Il apparaît qu’une telle pratique n’est pas socialement distribuée au hasard, et qu’elle entraîne des effets différenciés sur les auteur·e·s. « […] l’écriture ne découle pas du seul fait d’être ouvrier et ouvrière et de se raconter, elle résulte également d’actes d’écriture et de pratiques culturelles qui légitiment le fait de devenir auteur. […] Leurs récits traduisent au moins une préoccupation double : ils pensent non seulement les univers et les expériences dans lesquels ils vivent, mais aussi leur écriture. À travers les codes et les normes du genre du témoignage dont ils font usage, les scripteurs s’inscrivent dans un monde de l’écrit qui a ses pratiques et ses techniques, un monde qui préexiste à leur démarche et qu’ils reconfigurent par une écriture propre » (p. 17 et 352). Cette dernière, systématiquement marquée par des éléments de singularisation des expériences décrites, peut les amener à s’émanciper des formes attendues de l’écriture ouvrière, voire des discours convenus sur celle-ci, en particulier lorsque les scripteurs sont des scriptrices. Les plaisirs « indus » tirés de l’écriture, souvent réalisée sur des temps volés « pour soi », dérobés aux cadences de travail, aux temps de pause ou à la nuit, sont largement évoqués dans les entretiens réalisés avec certain·e·s auteur·e·s. Car, pour éclairer ces dimensions jusqu’alors inexplorées, Éliane Le Port a complété son corpus d’œuvres en le confrontant à d’autres sources, orales : des entretiens réalisés auprès de 15 auteur·e·s ouvrier·e·s (dont deux femmes), deux journalistes, deux éditeurs et un sociologue. La richesse et l’ampleur de l’enquête permettent d’analyser les dispositions et les expériences de ceux et celles qui se présentent volontiers comme des « témoins modestes », mais aussi « les articulations entre l’écriture de soi et l’écriture au nom d’un groupe » (p. 24).
Au final, il s’agit bien pour l’historienne de « repérer les éléments d’individuation qui dépassent le statut social et professionnel des scripteurs » pour « mettre en lumière la manière dont l’identité des ouvriers et des ouvrières est recomposée par l’écriture, plus encore par la publication » (p. 24). En effet, la visibilité et le capital social que cette dernière peut occasionner semblent favoriser nettement des trajectoires de mobilité professionnelle et sociale ascendante chez les ouvrier·e·s qui écrivent et sont édité·e·s. Les trois quarts des écrivain·e·s du corpus expérimentent une telle ascension. Cette mobilité n’est pas toutefois sans générer tiraillements et tensions : écrire et publier constitue déjà en soi une forme de distinction vis-à-vis du groupe d’appartenance. Sortir du statut d’ouvrier·e, en particulier pour se reconvertir dans un métier intellectuel (enseignement, formation pour adultes, métiers du livre, journalisme, fonction publique…), peut engendrer un sentiment coupable de trahir sa classe, en (s’)en sortant seul·e. Une telle posture n’est donc pas forcément facile à assumer et à évoquer.
Les voix/es des écritures ouvrières : des genres multiples, des expériences littéraires plurielles
Dans le prolongement de ce qu’avaient mis en évidence d’autres chercheurs pour le XIXe siècle britannique et français, l’historienne souligne, en particulier dans le quatrième chapitre, que les genres de l’écriture ouvrière de la seconde moitié du XXe siècle sont multiples. Cette dernière renvoie à des expériences littéraires diversifiées, très souvent liées aux pratiques de lecture antérieures précoces, souvent intensives et variées, des scripteur·rice·s. Éliane Le Port signale ainsi la « fureur de lire » (p. 102 et suivantes) de certain·e·s ouvrier·e·s-écrivain·e·s, les horizons d’attente qu’elle a créés, la maîtrise plus ou moins aboutie du « système de la littérature » qu’elle a pu favoriser. Par elle, les auteurs ont pu se réapproprier des procédés esthétiques ou stylistiques connus afin de parvenir au ton et à la forme qui leur paraissent les plus « justes » pour affirmer leur propre voix et concrétiser leur propre projet.
Se fondant sur un capital culturel plus ou moins important, qu’il soit hérité et/ou acquis, souvent de manière autodidactique ou dans des formations post-scolaires du type cours du soir, ces pratiques d’écriture ont pu commencer dès l’adolescence, même si les scolarités des auteur·e·s ont été la plupart du temps précocement interrompues. Elles se sont déployées par la suite, parfois simultanément, dans des cadres professionnels, militants et/ou privés. À l’âge adulte, l’écriture ouvrière peut se décliner, de manière assez attendue, sous la forme chronologique d’un récit sur soi recourant directement au « je » autobiographique, mais adossé à un pacte spécifique puisque adressé « aux autres » (collègues ouvriers, « grand public »). Mais elle s’exprime aussi dans des journaux, des carnets de voyage, des romans plus ou moins autobiographiques (le recours à un « personnage-écran » est ainsi fréquent), des nouvelles, des poèmes, des articles écrits pour des revues ou des écrits militants. Il faut leur ajouter les témoignages collectifs, où l’individualité des auteur·e·s s’efface au profit d’une collectivisation de l’écriture ouvrière (16 dans le corpus de l’historienne), mais aussi les récits rédigés suite à des rencontres, parfois organisées à l’initiative d’éditeurs politisés et intéressés par de tels témoignages ouvriers, avec des professionnel·le·s de l’écriture, sociologues, journalistes ou écrivain·e·s. Constituant autant d’incitations ou d’encouragements à écrire, ces rencontres ont donné lieu à des formes diverses de collaborations entre ouvrier·e·s et intellectuel·le·s acquis·es à leur cause, qui ont pu prendre la forme d’entretiens, bases du récit finalement publié (14 écrits de ce type sont ainsi étudiés).
Des usages genrés de l’écriture
L’analyse minutieuse d’Éliane Le Port se montre également attentive au genre des auteur·e·s, même si elle souligne d’emblée que « le choix de ne retenir que des récits publiés donne un accès moindre à l’écriture des femmes ouvrières ». De fait, l’historienne ne compte que 15 femmes dans son corpus qui rassemble 105 auteurs, et encore, cinq sont des intellectuelles « établies » pour un temps plus ou moins long en usine. Les dix autres sont bien originaires des classes populaires, mais seulement trois ont conservé par la suite un emploi ouvrier. Toujours soucieuse de contextualisation, Éliane Le Port rappelle encore que les hommes représentent 80% des ouvriers sur la période de son étude et qu’en outre, depuis l’émergence du courant de la littérature prolétarienne dans les années 1930, « les auteurs masculins, fréquemment militants, sont majoritaires ». Pourtant, cela ne signifie pas que les ouvrières ont moins écrit que les ouvriers : il semblerait surtout qu’elles aient été beaucoup moins éditées. Leurs témoignages non publiés sont en effet aussi nombreux que ceux des hommes dans le fonds de l’Association pour l’autobiographie et le patrimoine autobiographique (APA). Soit parce qu’elles ont rencontré plus d’obstacles dans l’accès à l’édition, soit parce que cette dernière n’était pas la finalité première de leur prise d’écriture. Quand elles ont été éditées, ces ouvrières s’éloignent majoritairement de la forme de l’introspection intime, souvent prêtée aux écritures féminines : à l’instar des hommes, elles articulent dans leurs récits « différents types de discours (discours sur soi, discours politique, discours social) ». Elles sont d’ailleurs engagées syndicalement dans la même proportion que leurs homologues masculins. Des « usages genrés de l’écriture » (p. 21) émergent pourtant là où l’individualité peut s’imbriquer davantage dans le collectif que dans les récits masculins, s’autonomisant ainsi du discours attendu sur la classe ouvrière. En effet, en particulier depuis les années 1970, les scriptrices développent des réflexions sur la condition féminine dans le monde social en général, et dans les mondes ouvriers en particulier. Elles évoquent ainsi les inégalités qui touchent les femmes dans les espaces familiaux ouvriers et militants, mais aussi l’articulation difficile entre la vie au travail et les espaces privés/domestiques, voire leur vie intime lorsque le récit prend la forme plus distanciée du roman. Il en est ainsi de deux ouvrages ayant rencontré un grand succès public : Élise ou la vraie vie de Claire Etcherelli (Denoël, 1967), récit d’une histoire d’amour impossible entre une ouvrière française et un ouvrier algérien dans une usine automobile parisienne dans les années 1950, et Le Voyage à Paimpol de Dorothée Letessier (Seuil, 1980), qui raconte l’escapade hors du foyer familial d’une ouvrière qui cherche à échapper pendant deux jours à l’aliénation ressentie à l’usine et dans son couple. Pour compléter ce tableau, et parallèlement à ces écritures féminines en nom propre, il convient d’ajouter que plusieurs scripteurs masculins évoquent aussi le rôle crucial joué par leurs épouses dans la mise au propre dactylographiée de leurs manuscrits.
De la valeur et des usages du témoignage en histoire, en sciences sociales… et en littérature
Pour l’essentiel, « les écrivains ouvriers et ouvrières reprennent à leur compte les caractéristiques du témoignage en donnant des gages sur l’authenticité du témoin, sur la vérité du récit et sur le reflet collectif des expériences » (p. 25). Par exemple, leur poste et ses transformations, les gestes techniques, les cadences, les risques, le militantisme, les luttes, les ambiances dans les collectifs de travail et les sociabilités ouvrières sont décrits avec précision. Les récits font preuve de réflexivité sur ces expériences, sur les supports de mémoire convoqués pendant l’écriture, mais aussi sur l’acte même d’écrire. Les auteur·e·s évoquent notamment les effets induits par la reprise, après coup, de leurs notes lors de la composition finale du manuscrit. Mais une question majeure se pose : celle de l’usage de telles sources par les historien·ne·s, et de la valeur et du statut épistémologique de ces témoignages, de leur authenticité et de leur « vérité ». L’écriture des établi·e·s, tels Simone Weil, Leslie Kaplan, Daniel Rondeau, Robert Linhart, illustre particulièrement la part de reconstructions plus ou moins conscientes et de subjectivité que les ouvrages peuvent comporter. Tous les récits ouvriers ne prennent pas la forme d’autobiographies explicites et revendiquées comme telles, et ils peuvent se parer d’une part plus ou moins importante et avouée de fiction (autofictions, nouvelles, romans, poésie…). Ce faisant, « les réflexions que des auteurs engagent sur la mémoire, sur le projet d’écrire vrai, sur l’importance de la référence au vécu ouvrier et/ou sur la figure de l’écrivain, enrichissent les débats historiographiques sur le phénomène du témoignage au XXe siècle » (p. 352).
C’est aussi la question plus vaste des relations entre les ouvriers et les intellectuels acquis à leur cause qui est posée dans l’étude d’Éliane Le Port. Nombre de ces derniers ont facilité la publication des récits des ouvrier·e·s-écrivain·e·s, en les incitant à écrire, en les relisant, en les orientant dans les espaces éditoriaux, voire en collaborant directement avec eux à l’écriture par la réalisation d’entretiens. Est également soulevée la question de « la place qu’il convient de faire aux ‘acteurs ordinaires’ dans l’écriture des sciences sociales » (p. 41).
Si elle constitue un apport majeur à l’histoire sociale, de la littérature et de l’écriture dans les mondes ouvriers, l’entreprise d’Éliane Le Port contribue ainsi pleinement à la réflexion sur l’écriture de l’histoire. L’un des autres grands mérites de l’ouvrage est, en effet, de s’inscrire dans le sillage de travaux universitaires qui renouvellent depuis peu, tant chez les historien·ne·s que chez les sociologues, les débats épistémologiques et méthodologiques passionnés, engagés de longue date autour de l’égo-histoire. Au-delà de la valeur et des usages scientifiques du témoignage et de la mémoire, ce sont les rapports entre histoire et littérature qui sont également interrogés. De manière érudite et nuancée, Éliane Le Port rappelle et met en perspective les origines et les principaux enjeux de ces questionnements cruciaux pour les sciences sociales dans le préambule très éclairant du livre, Témoins et témoignages au XXe siècle (pp. 33-55). On trouve des échos des débats évoqués dans des ouvrages récents, inclassables, dont certains ont été rédigés à l’occasion de la soutenance de mémoires d’habilitation à diriger des recherches (HDR), où les chercheur·e·s répondent à une injonction institutionnelle à revenir sur leurs parcours de recherche et à procéder à un retour d’expériences de/sur soi. On songe ici, par exemple, du côté des historien·ne·s, à la démarche originale initiée par Ivan Jablonka2Histoire des grands-parents que je n’ai pas eus, Seuil, 2012 ; En camping-car, Seuil, 2018 ; Un garçon comme vous et moi, Seuil, 2021., aux ouvrages de Claire Zalc3Z ou souvenirs d’historienne, Éditions de la Sorbonne, 2021. et de Camille Lefebvre4À l’ombre de l’histoire des autres, Éditions de l’EHESS, 2022. ou, du côté des sociologues, à ceux de Rose-Marie Lagrave5Se ressaisir. Enquête autobiographique d’une transfuge de classe féministe, La Découverte, 2021. et de Christine Détrez et Karine Bastide6Nos mères. Huguette, Christiane et tant d’autres. Une histoire de l’émancipation féminine, La Découverte, 2020.. Récits (auto)biographiques et formes de sociobiographies familiales s’entremêlent à des essais d’auto-analyse du parcours académique des chercheur·e·s, à des enquêtes (socio)historiques et/ou à des analyses de trajectoires sociobiographiques de leurs proches inscrit·e·s dans leurs contextes historiques, sociaux, culturels et politiques d’existence, sans que ces différentes strates ne se confondent. Tous ces écrits hybrides, qui cherchent, chacun à leur manière, à « rendre le réel », reposent sur une enquête « située », visant à concilier rigueur scientifique, exigence d’autoréflexivité et réflexion sur la forme de l’écriture elle-même. Ces entreprises s’avèrent particulièrement délicates lorsque l’on enquête sur des proches, que l’on a connu·e·s ou non.
Mémoires personnelles et familiales, tout autant que réflexions sur la profession d’historien·ne ou de sociologue, confronté·e à des témoins proches ou lointain·e·s, s’entrelacent. Ces ouvrages « braconniers » (se) jouent des frontières parfois poreuses, et sans cesse questionnées dans les textes eux-mêmes, des sciences sociales, de l’histoire et de la littérature – où de tels « récits de filiation », pour reprendre l’expression de Dominique Viart, abondent d’ailleurs également depuis les années 1980, sous la plume d’auteur·e·s aussi différent·e·s qu’Annie Ernaux ou Jean Rouaud, pour n’en citer que deux qui ont connu d’importants succès publics.
En ce sens, de telles recherches, et au premier chef celle d’Éliane Le Port qui fait ressurgir des témoignages « d’en bas » oubliés ou parfois inconnus, sont susceptibles d’intéresser un public bien plus large que celui des seul·e·s chercheur·e·s.
Isabelle Charpentier est est professeure de sociologie à l’Université de Picardie, chercheure au CURAPP-ESS et chercheure associée au CESSP-CSE.