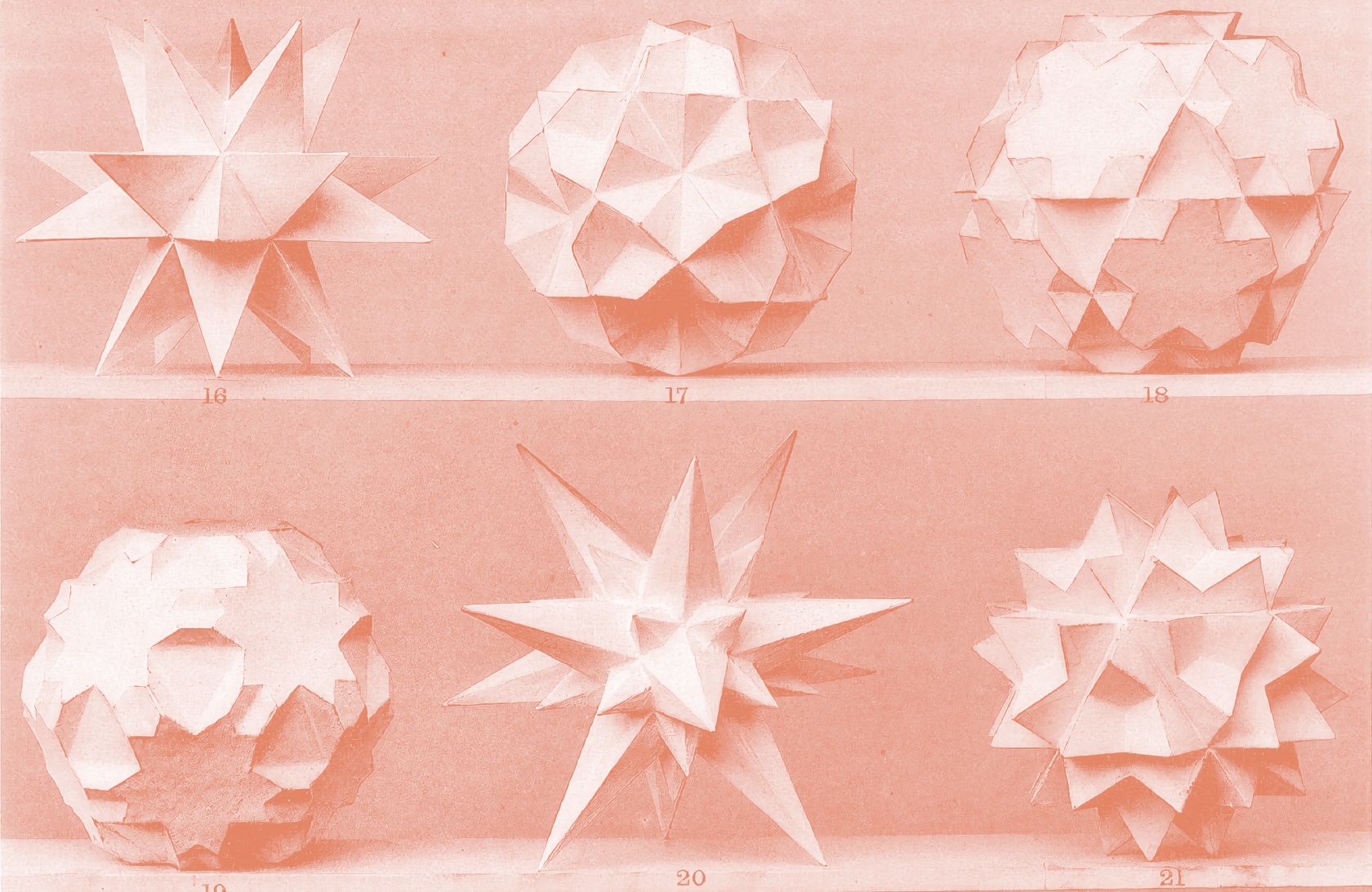Alors que le gouvernement a annoncé en juin dernier une nouvelle campagne de testing sur les discriminations à l’embauche, une question se pose : les initiatives en faveur de la « diversité » permettent-elles réellement de répondre au problème des discriminations raciales ?
Nous avons discuté avec Milena Doytcheva, maîtresse de conférences en sociologie à l’Université de Lille, pour connaître son point de vue.
L’apparition du terme de « diversité » dans le débat public est-elle récente ? Quelle est son origine ?
Son emploi est un peu moins récent qu’on a tendance à le penser. Selon une étude de la presse nationale de référence, c’est au milieu des années 1990 que son utilisation a commencé à se développer. Le terme est alors surtout employé pour évoquer la situation internationale (au Royaume-Uni ou aux États-Unis). Ce n’est qu’à la toute fin des années 1990 que l’on commence à s’en servir pour parler de la France, dans un contexte d’abord de questionnement sur la représentation des minorités dans les médias (voir par exemple l’opération « Écrans Pâles »).
Un premier moment fort de médiatisation a lieu en 2002, à l’occasion du deuxième tour de l’élection présidentielle qui oppose Jacques Chirac à Jean-Marie Le Pen. Selon les propos de Chirac, « la France trouve sa grandeur dans sa diversité et le refus des communautarismes ». C’est la première fois que le terme est utilisé par une personnalité politique de droite ; jusqu’ici, les premières utilisations venaient, tout de même plutôt de la gauche dont par exemple Élisabeth Guigou, Garde des Sceaux.
Malgré tout, durant cette période, cet emploi reste plutôt confidentiel. C’est à l’occasion de la remise du rapport Stasi sur la laïcité (2004) que le terme de diversité fait « événement de discours ». Cette apparition est tout à fait caractéristique des tensions et ambivalences qui caractérisent la notion depuis : c’est dans un contexte répressif à l’égard des convictions religieuses, et en particulier du port du voile, que l’idée est mise en avant. Dans l’esprit des rapporteurs, il s’agissait de penser des mesures compensatoires à l’interdiction des signes religieux, à travers une « valorisation de la diversité » – en proposant, par exemple, des jours fériés adaptés aux différents cultes. Or en fin de compte, cette partie du projet est tombée à l’eau : seul le volet répressif est resté dans la loi.
Qu’est-ce que la notion de diversité change par rapport à celles de lutte contre les discriminations, ou d’égalité des droits ?
C’est un point qui a beaucoup focalisé l’attention au début des années 2000. En 2004 est lancée la Charte de la diversité, qui vient du monde de l’entreprise et qui contribue, à son tour, à installer le langage de la diversité en France. Ce discours ou langage n’est alors pas tout à fait inédit. Les entreprises françaises qui l’empruntent procèdent par imitation, en reprenant à leur compte les arguments de la littérature d’entreprise états-unienne, constituée depuis les années 1980, autour du « business case » de la diversité.
Je cite souvent cette phrase tirée du rapport de Claude Bébéar (2004), qui fut le chef de file de cet engagement entrepreneurial en France : la diversité en entreprise « n’est pas une affaire de compassion, mais d’intérêts bien compris ». Dans cette perspective, ce qui est mis en avant n’est pas la lutte contre les discriminations ou l’égalité, mais l’intérêt propre de l’entreprise. Il s’agit là d’une approche instrumentale dont on mesure les effets concrets.
Il faut noter que ce rapport est produit dans un contexte politique particulier, où Jean-Pierre Raffarin est Premier ministre, sous le deuxième mandat de Jacques Chirac. L’État fait alors le choix de « faire confiance » aux acteurs économiques, qui sont censés nous « montrer la voie » dans un contexte de dérégulation économique et de refus des « contraintes » administratives ou bureaucratiques. Ce parti pris politique (qui est au fond celui des doctrines néolibérales) repose sur la supériorité postulée de l’entreprise et du marché, désormais vus comme les mieux placés pour résoudre les « problèmes de société ».
Dans cette système de régulation par et pour le marché, quelques voix sceptiques s’élèvent néanmoins pour interroger l’idée que la diversité apporte réellement une plus-value économique. De mon point de vue, ce n’est pas vraiment le sujet. On peut en revanche observer que ces débats ont contribué à escamoter les sujets plus politiques, ceux du racisme et des discriminations ou, plus largement, de la justice sociale et de l’équité.
Beaucoup d’acteurs de la diversité restent aujourd’hui dans le déni, et affirment par exemple que le racisme est le produit de la société et non de l’entreprise, où tout serait parfaitement rationnel et subordonné à son intérêt suprême qui est de faire du profit ; à les écouter, le racisme est irrationnel d’un point de vue économique – idée que l’on retrouve également dans certaines théories économiques de la discrimination. Or, le racisme peut être tout à fait rationnel d’un point de vue économique. Tout comme le patriarcat forme une des premières ressources du capitalisme (je pense par exemple au travail domestique qui assure la reproduction gratuite de la force de travail…), le racisme peut être et historiquement a été très « rationnel » dans l’optique d’un capitalisme racial, qui rime avec extraction de ressources et dépossession économique.
Vos recherches montrent que les entreprises ont souvent recours à des tiers (cabinets de recrutement, associations, …) pour aborder ces questions. Est-ce un problème de compétences, ou s’agit-il pour elles d’un moyen pour se libérer du problème ?
À mon sens, c’est un ensemble.
On aurait tort d’en faire un phénomène uniquement français. On retrouve des consultants et des cabinets de recrutement spécialisés dans la diversité dans beaucoup de pays. Mais il existe, tout de même, à mon sens, une originalité française, avec des réseaux de fondations et d’organisations spécialisées dans une offre de prestation de services aux entreprises qui va au-delà de la simple « formation » ou « sensibilisation », et qui vient en quelque sorte suppléer directement à l’action de l’entreprise. Quand les études états-uniennes soulignent les dynamiques d’internalisation du droit antidiscriminatoire par les professionnels de la diversité en entreprise, en France nous avons à faire au contraire à une logique d’externalisation ; à tout le moins en ce qui concerne la question des discriminations raciales.
Ces opérateurs et intermédiaires de la diversité, selon l’expression que j’ai proposée pour les désigner, deviennent ainsi les vraies « chevilles ouvrières » des politiques de diversité au travail. Ils proposent aux entreprises une main d’œuvre diversifiée – les « candidats de la diversité » – qu’ils trient et accompagnent à travers des dispositifs spécifiques (parrainage, accompagnement à l’emploi, etc.).
Afin de comprendre pourquoi les entreprises sont amenées à sous-traiter des aspects aussi importants de leur engagement, on peut ici penser à ce que Crozier et Friedberg appellent des « structures relais » : il s’agit de structures qui sont situées dans l’environnement de l’entreprise et ont pour fonction de faciliter ses relations avec celui-ci en réduisant les « zones d’incertitude ». Ici, il me semble que c’est précisément ce qui se passe : cette offre de services permet aux entreprises de pallier une forme d’incertitude et de se prémunir contre des risques (d’image, de réputation, et plus rarement des risques juridiques) et des critiques qui concernent en particulier le maniement des catégories ethnoraciales.
Cette logique d’externalisation joue de mon point de vue à plein sur les sujets réputés les plus « politiques » et les plus « sensibles », à savoir le racisme et les discriminations racistes. En effet, on voit que la démarche n’est pas la même selon le sujet de préoccupation : la question de l’égalité femmes-hommes est par exemple souvent portée en interne ; pour les discriminations liées à l’âge, quand bien même il existe aussi une offre de services à l’endroit en particulier des seniors, l’entreprise ne se montre pas aussi « embarrassée » de porter le sujet elle-même.
Les entreprises demandent à ces structures de les aider à recruter des employés « issus de la diversité », selon l’euphémisme habituel – et c’est aussi ce qu’en attend l’administration. De l’autre côté, il existe l’interdiction de collecter et de traiter les « données à caractère personnel qui font apparaître (…) les origines raciales ou ethniques » d’un individu. Comment concilier ces deux exigences ?
C’est précisément la raison pour laquelle les pouvoirs publics et les entreprises ont recours à cette division du travail, qui consiste à déléguer en dehors et aux portes de l’institution des tâches perçues comme fastidieuses, « délicates » ou qui exposent à la critique parce qu’elles défient des normes perçues comme légitimes. Partant, on fait aussi endosser à ces acteurs les sentiments de « gêne », d’« embarras » et de « dissonance » que l’action publique en la matière ne manque de susciter.
Rarement illégales, ces pratiques sont surtout déloyales vis-à-vis des partenaires associatifs et des personnes accompagnées à qui l’on cache parfois la raison d’être et les règles de fonctionnement des dispositifs qui les concernent. Contrairement à ce qui peut être observé dans d’autres pays, l’opacité gouverne les actions, jusque dans l’implicite des raisons et des justifications qui les sous-tendent.
À noter que cette gestion en « sous-main » de l’ethnicité n’est pas nouvelle en contexte républicain, comme j’ai pu le montrer notamment pour les politiques de la ville. Traditionnellement, en France, ce sont les catégories territoriales qui sont utilisées pour faire parler les identités ethno-raciales1On cible ainsi les REP (précédemment nommées les ZEP), les « quartiers », les « banlieues »… ; aujourd’hui, parmi les acteurs de la diversité, cette option reste bien présente (je pense notamment aux travaux de la Fondation Agir Contre l’Exclusion) ; mais la lutte contre les discriminations a aussi fait naître de nouveaux profils d’acteurs.
À noter qu’un certain nombre parmi ces derniers (et en particulier parmi les structures associatives) affichent un profil militant. De ce point de vue, ce n’est pas leur action qui est en cause mais plutôt, une fois de plus, l’inertie des entreprises, qui cooptent ces associations dans leur stratégie de communication institutionnelle sans pour autant faire toute la place aux « candidats » ainsi soutenus.
Pour l’entreprise, en effet, cette médiation à l’emploi demeure clairement non contraignante ! Et c’est bien un des problèmes essentiels soulevés par ces politiques qui continuent à bénéficier de subsides publics pour des résultats aléatoires, et en l’absence de tout périmètre de contractualisation.
Peut-on dire qu’il existe un « marché » de l’anti-discrimination et de la diversité ?
Ce que l’on peut trouver problématique, c’est lorsque les pouvoirs publics financent des actions et des associations qui sont ensuite cooptées par l’entreprise, à qui elles apportent bien souvent un « service gratuit » (pour le recrutement, par exemple), et ce en l’absence de toute contrepartie !
Plus que le financement public, c’est donc l’absence de périmètre de contractualisation qui est un vrai sujet d’interrogation. Normalement, lorsque l’État finance quelque chose, des objectifs doivent être fixés. Or, là pas du tout… Et je pense, hélas, que les choses ne sont pas en train d’évoluer sur ce point : la logique publique reste de laisser l’entreprise et les acteurs économiques libres de leurs choix ; tout au plus est-il question de « pédagogie ».
En fin de compte, que pourrait-on faire de mieux ?
Aujourd’hui, les actions de la Charte de la diversité ont été critiquées, et l’on se tourne plutôt vers des stratégies de certification par les labels (« Égalité », « Diversité », puis « Alliances »). Cependant, là aussi, l’éducation et la « pédagogie » l’emportent sur la prescription et on se retrouve avec les mêmes incertitudes quant aux manières de catégoriser la diversité que celles soulevées par l’initiative de 2004. Concrètement, les entreprises s’engagent sur le handicap, l’égalité professionnelle femmes-hommes, les âges – c’est à dire des sujets qui disposent d’une base normative légale, qui comporte des obligations.
Or le status quo (comprenons l’absence de telles mesures) perdure pour les discriminations ethnoraciales, qui continuent à incarner aujourd’hui l’Arlésienne des politiques antidiscriminatoires. La tendance est même confortée par rapport à ce que j’ai observé il y plus de 15 ans, au démarrage de la charte. L’action de l’AFNOR2L’AFNOR (Agence française de normalisation) est une organisation reconnue d’utilité publique qui s’occupe d’élaborer et d’homologuer un certain nombre de normes pour les entreprises. et la stratégie de labellisation semblent en effet avoir consolidé ce que l’ai appelé une « diversité normalisée », caractérisée par la « blanchité » des politiques antidiscriminatoires.
De ce point de vue, il est en effet aberrant de voir aujourd’hui que les entreprises, et plus largement les organisations, ont toujours le choix de se soucier ou non de ces questions dans le cadre de leurs politiques. Plutôt qu’un concept de diversité « générique » et universalisé – qui épouse les attentes des acteurs économiques – il devrait être possible de définir de manière pragmatique quelques dimensions essentielles que l’on ne puisse évincer. Le racisme et les discriminations ethnoraciales devraient en faire partie. Ce que montre cet exemple simple et très concret, c’est aussi l’absence de pilotage politique !
Les résultats de plus de 20 ans de littérature sont convergents sur le sujet : compter sur le marché comme mécanisme ultime d'(auto-)régulation nous éloigne durablement de la justice sociale et de l’équité. Et les pouvoirs publics n’ont pas pas d’autre politique – cela leur évite parmi tant de choses de prévoir un budget… –, alors qu’une action publique en la matière est plus que jamais nécessaire, afin également de soutenir les acteurs les plus impliqués qui sont aujourd’hui en train de s’épuiser.
Pour aller plus loin :
- Milena Doytcheva (2020), « Governing racial justice through standards and the birth of ‘white diversity’: a Foucauldian perspective »
- Milena Doytcheva (2015), Politiques de la diversité. Sociologie des discriminations et des politiques antidiscriminatoires au travail, Bruxelles, Peter Lang, coll. « Travail et société ».
L’entretien a été mené par Paul Tommasi.