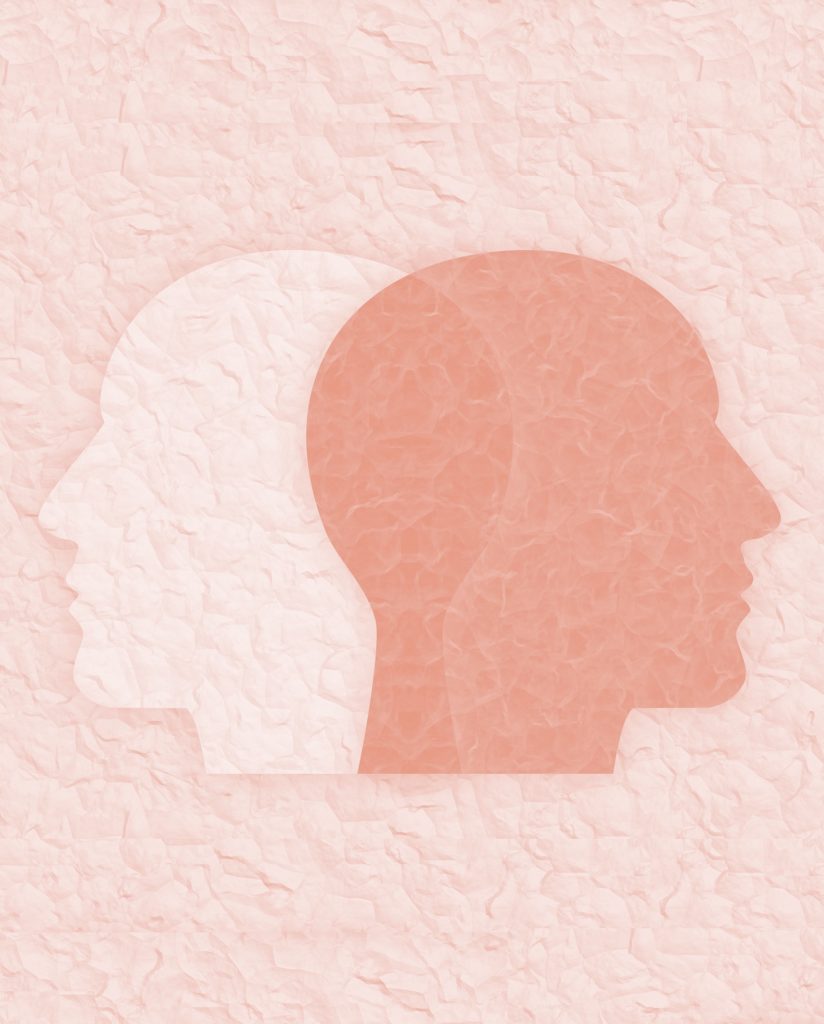
Connaissez-vous le concept de charge raciale ?
Lou Eve, créatrice du compte Instagram La charge raciale et militante asioféministe (suivez-la !), nous a accordé un entretien pour nous expliquer le sens de cette expression… ainsi que pour discuter des discriminations entre communautés et des pratiques militantes sur les réseaux sociaux.
Pouvez-vous nous définir le concept de charge raciale ?
Avant toute chose, j’aimerais bien préciser que je n’ai pas inventé ce concept : c’est la chercheuse et maîtresse de conférences Maboula Soumahoro qui en est à l’origine. Je me suis simplement reconnue dans cette notion et j’ai voulu m’exprimer publiquement sur la question. J’avais aussi la volonté de rassembler une communauté de personnes racisées subissant cette charge afin de libérer nos paroles et vécus. J’avais aussi envie de m’interroger sur d’autres sujets, tels que le fait d’être une personne racisée dans une « grande école » ou une institution telle que l’ONU, ainsi que sur certaines dynamiques militantes intracommunautaires.
La charge raciale, M. Soumahoro en parle dans son livre Le triangle et l’hexagone, Réflexions sur une identité noire. En relation à la charge mentale féminine démocratisée auprès du grand public par la dessinatrice française Emma, ce concept désigne tout ce qui se passe en amont d’une confrontation raciste, en préparation à celle-ci. La journaliste Douce Dibondo complète en définissant la charge raciale comme le fait de constamment planifier des solutions pour faire face aux préjugés ou à la discrimination raciale. C’est en fait une pression psychologique constamment ressentie chez les minorités perçues comme non blanches, les forçant à être sur le qui-vive et à anticiper tous les préjugés dans toutes les sphères de la vie. La charge raciale est selon elle un mécanisme d’existence et une « stratégie de survie permanente ».
Quels sont les effets de cette charge au quotidien ?
Maboula Soumahoro explique qu’en raison d’un « inconfort » permanent provoqué par la charge raciale, les sujets racisés se retrouvés privés de leur « droit à la légèreté ». En fait, la charge raciale crée de l’appréhension, et empêche d’être en mesure de se dévoiler entièrement aux autres, parce qu’on a peur : peur de se sentir oppressé·e, peur de devoir se justifier, peur de s’épuiser au jeu éreintant de la pédagogie… Elle nous empêche donc de baisser la garde, et ce dans tous les domaines : le milieu scolaire, le couple, le travail, la thérapie, l’amitié, etc., d’où le fait qu’il est courant d’entendre des personnes blanches dire à propos de personnes racisées que celles-ci sont froides, distantes, dans le contrôle permanent. Il est difficile de s’adonner au « lâcher prise » quand notre quotidien est ponctué de micro-agressions permanentes : pour s’en protéger, se fermer aux autres devient alors un mécanisme d’auto-défense.
Ces mécanismes de défense mis en place sont néanmoins fatigants, et les multiples masques que nous arborons en une journée ont un impact plus ou moins lourd sur la santé mentale des personnes racisées qui peinent à appréhender leur individualité et leur personne. La peur d’être discriminé·e par autrui devient si forte qu’il devient difficile d’exister par soi-même et pour soi-même, et non plus au travers de ce prisme extérieur qu’est la blanchité. La charge raciale a donc pour conséquence de ne nous faire exister qu’au travers de nos personae de personnes racisées, alors que nous sommes bien plus que cela.
Vous soulignez aussi que le mythe de la « minorité modèle » ne protège pas des violences, et que le retournement du stigmate peut (pour certaines personnes) être un moyen de retrouver une forme de dignité…
Oui, je crois que jouer ce jeu de la minorité modèle ne protège aucunement des violences racistes, au contraire. Pour rappel, le mythe de la minorité modèle est un concept mis à l’ordre du jour par un sociologue américain, William Petersen, en 1966. Dans un article, il mettait en avant la réussite sociale et économique des populations japonaises ayant immigré aux États-Unis, en les opposant notamment aux communautés noires. Il s’agit d’une instrumentalisation politique pure et dure largement reprise dans le discours politique français (par Sarkozy par exemple), visant à établir une hiérarchie entre des bon·ne·s et des mauvais·e·s immigré·e·s. En désignant des « bonnes communautés » qui réussissent, on dit implicitement aux communautés noires et arabes de France : « regardez, il y en a qui y arrivent, alors pourquoi pas vous ? » C’est aussi un mythe qui invisibilise les communautés les plus précaires des populations asiatiques de France (TDS1Travailleurs et travailleuses du sexe, NDLR., personnes trans…) et qui efface les dynamiques de pouvoir au sein-même de ces « communautés ». Il existe une hégémonie politique, culturelle et économique certaine de l’Asie de l’Est comparée à l’Asie du Sud ou encore l’Asie du Sud-Est, mais à cause de ce mythe de la minorité modèle, l’Asie est perçue comme un tout homogène et uniforme.
Ce mythe a ainsi mis dans la tête des personnes asiatiques qu’il fallait travailler dur, raser les murs et jouer aux bon·ne·s petit·e·s immigré·e·s pour être mieux intégré·e·s, or il n’en est rien. Si les événements récents de violence à l’encontre de personnes asiatiquetées (perçues comme asiatiques) dans le contexte du Covid-19 ont suscité des réactions publiques de politiques, d’organisations et de collectifs sécuritaires et bien souvent pro-police sur le « racisme anti-asiatique », il faut arrêter de croire que cette classe politique se soucie de nous le reste de temps. Elle se sert juste du mythe de la minorité modèle pour briser la solidarité qu’un grand nombre de personnes asiatiques engagées tente d’établir avec d’autres communautés racisées, et pour opprimer encore plus ces dernières. Cela ne nous intéresse pas que la majorité nous « approuve » comme des « bonnes » minorités : ce que nous voulons, c’est la justice sociale. Être asiatique n’a d’ailleurs pas empêché Liu Shaoyao d’être tué par la BAC. De même, il est inutile de s’auto-humilier en faisant des blagues racistes à l’encontre de nos communautés pour faire rire les personnes blanches. Je sais qu’il s’agit d’un mécanisme de défense naturel, que nous avons tou·te·s mis en place à un moment de notre vie, mais il s’avère vain de vouloir adopter les codes des dominant·e·s : iels ne nous offriront jamais un siège à leur table.
Entre cette déshumanisation liée à une charge raciale importante et une instrumentalisation de nos identités qui nous essentialisent de facto, retourner le stigmate peut être salvateur, ou du moins apaiser nos quotidiens meurtris par l’obligation d’avoir à justifier son existence. Cela passe par une multitude de choses : la réappropriation de l’insulte (par exemple, se désigner comme « jaune »), la revendication d’une certaine flamboyance (notion largement mise à l’honneur dans les milieux queer), l’envie de communautariser comme j’aime le dire avec humour même si c’est très sérieux. Les discours politiques passent leur temps à brandir la peur du « communautarisme » et à pointer du doigt les minorités raciales pour leur soi-disant « repli identitaire » : retourner le stigmate passe alors par le fait de s’entourer des sien·ne·s pour se créer un sas de décompression, un espace où la charge raciale devient moins pesante voire même inexistante, ainsi qu’un espace pour s’organiser collectivement.
Vous avez à plusieurs reprises publié sur les discriminations intracommunautaires, ou entre communautés. Quelle importance leur accordez-vous dans vos réflexions ?
Elles sont déterminantes et heureusement, certain·e·s s’expriment de plus en plus à leur sujet. On a tendance à percevoir les minorités noires, arabes et asiatiques comme des blocs uniformes, alors que par exemple, l’Asie compte plus de 50 pays ! Je vous laisse faire le compte sur la diversité de cultures, langues et pratiques que ce nombre implique. Et surtout, il existe des dynamiques de pouvoir au sein même d’un continent, qu’elles soient impérialistes, culturelles, et coloristes : la teinte de la couleur de peau joue un rôle énorme dans les dynamiques de domination existantes au sein « des communautés asiatiques », selon l’expression qui dans le fond ne veut rien dire. On pense souvent le colorisme comme une pratique émergeant des communautés noires, alors que c’est en Asie que se produisent et vendent le plus de produits éclaircissants. Les dynamiques coloristes sont en réalité très fortes de l’Asie de l’Est vers l’Asie du Sud par exemple, à l’encontre de ce qu’on appellerait les brown people aux États-Unis. Cette discrimination est très visible dans des pays comme Singapour, où les jobs les plus précaires sont occupés par des personnes d’Asie du Sud et d’Asie du Sud-Est, tandis que la population d’origine chinoise détient la majorité des richesses.
Il existe aussi de fortes discriminations entre communautés, basées notamment sur une négrophobie ambiante très ancrée. C’est le cas au sein des communautés asiatiques de France par exemple, et elle est aussi imputable au mythe de la minorité modèle. Il serait en tout cas hypocrite de ne pas en parler. Pourtant, l’histoire démontre qu’une solidarité politique a largement existé entre activistes noir·e·s et asiatiques notamment aux États-Unis, ou encore entre acteurices internationaux·ales de la scène politique globale, et il est dommage de l’oublier2On peut d’abord commencer avec un exemple historique, dont on parle peu, qui est la conférence de solidarité des peuples d’Asie et d’Afrique tenue en 1960. Portant sur la question du développement en Afrique et en Asie, elle a mené à une véritable volonté d’action conjointe pour une indépendance économique et politique des deux continents. Aux États-Unis, des féministes racisées se sont aussi organisées collectivement dans la « Third World Women’s Alliance » dans les années 70, formant ainsi l’une des premières organisations féministes intersectionnelles. N’oublions pas non plus le refus de Mohamed Ali de s’enrôler pour la guerre du Vietnam en 1976, refus qu’il argumente par une vraie volonté de solidarité envers un autre peuple racisé et oppressé..
Pouvez-nous nous expliquer pourquoi la « rhétorique de la blessure individuelle » peut, selon vous, parfois devenir un frein pour une lutte collective contre les discriminations ?
La « rhétorique de la blessure individuelle » est une notion mise en avant par Jack Halberstam pour parler en premier lieu des milieux queer. On n’aime pas trop en parler dans la nébuleuse activiste très parisienne, mais cette rhétorique est pourtant bien présente, et elle est nocive. Je remarque qu’il y a globalement dans les milieux dits militants une tendance à tout ramener au « je » blessé et meurtri par des discriminations, ce qui en soi est normal dans un premier temps. J’ai l’impression que c’est particulièrement présent dans le milieu queer. Peut-être est-ce en raison d’un risque accru de précarité concernant les conditions matérielles d’existence (par exemple, le risque de se retrouver à la rue parce qu’on est une personne trans, homosexuelle…) ? Mais il ne s’agit là que de spéculations de ma part. Les espaces militants sont aussi des espaces où l’on se confronte directement à ses traumatismes, il y a aussi une libération de la parole certaine vis-à-vis des problématiques de santé mentale. Du coup, cette rhétorique de la blessure individuelle se manifeste par plusieurs choses : lors d’une réunion en collectif, ça peut être le fait d’avoir du mal à produire un discours détaché d’une somme d’individualités parce que chacun·e va y aller de la narration de son traumatisme, ou le fait d’appréhender de produire un discours militant publiquement (par exemple, lors d’une conférence) par peur de trigger une personne (Jack Halberstam illustre son propos par l’usage très important du trigger warning). Je ne dis pas qu’il n’est pas pertinent de parler de ses traumatismes, bien au contraire. Mais je crois qu’il doit y avoir des espaces dédiés dans le temps et l’espace pour cela, et que le militantisme, s’il part nécessairement de blessures individuelles, n’a pas vocation à être une thérapie, et il me semble parfois vain de vouloir chercher du safe partout.
On n’aime en tout cas pas trop en parler parce qu’évoquer la façon de constamment ramener les luttes à ses traumatismes personnels paraît brutal, alors que je crois qu’il s’agit d’une critique purement pragmatique : à force de ne pas vouloir blesser autrui avec le mauvais mot, la mauvaise expression, le mauvais niveau de « déconstruction », les mauvais codes (parce que la nébuleuse parisienne dont je parle est bourrée de codes), on instaure un climat de terreur et un apprentissage par la peur. Il n’y a ainsi plus de vraie remise en question possible, il ne s’agit plus que de faire partie des « cool kids » du militantisme, et on se retrouve donc piégé·e·s dans une forme d’immobilisme.
Cette rhétorique de la blessure individuelle est aussi visible dans les petites guerres d’égo que l’on voit tous les jours arriver sur Instagram ou Twitter : il y existe des phénomènes de « starification », de personnalisation des luttes, je trouve qu’on y voit même se développer des mécanismes d’allégeance complètement délirants (par exemple, pour caricaturer : « dans le conflit A contre B, je défends A »). Il est facile d’être pris·e dans le tourbillon nocif de ces dynamiques et je n’en suis d’ailleurs pas exempte, mais je crois qu’il est important, de temps à autre, d’opérer un retour réflexif sur nos pratiques qui sont parfois malveillantes et toxiques. Parfois, bien au-delà de cette course à la radicalité à laquelle on nous encourage, je crois qu’il convient d’être simplement gentil·le.
Vous avez aussi posté sur la « charge militante »… Ses effets sont-ils similaires à ceux de la charge raciale ?
Oui et non. La charge raciale n’est pas du ressort des personnes racisées, tandis que la « charge militante », que je subis parfois, je l’ai en quelque sorte choisie. Ses effets divergent donc, et je crois que l’on ne peut pas vraiment comparer les deux.
En revanche, je crois que la charge militante est parfois révélatrice de certains rapports de force existant au sein même de collectifs ou milieux militants. Je ne crois pas aux espaces safe, et penser qu’il existe des lieux complètement dénués de dynamiques oppressives me semble être un leurre. Prenons l’exemple du genre : il est déterminant dans la façon de vivre la charge militante. Dans les collectifs ou associations, il est courant que ce soient encore les femmes qui s’adonnent aux tâches les plus « triviales » et pénibles : ménage, administratif, demande de subventions… c’est moins sexy qu’aller dans les black blocks, mais c’est pourtant vital. Je trouve aussi que les hommes cisgenres et hétérosexuels qui militent ont toujours plus de visibilité, de crédit, de légitimité, par rapport à leurs homologues féminines ou non-binaires. Parce qu’il existe à mon sens un imaginaire violent, viriliste et masculin du militantisme (militer, ce serait être en manif et se faire gazer tous les jours), on accorde plus le bénéfice de la radicalité aux hommes qui militent, on leur voue plus d’admiration parce qu’on fantasme sur leurs prises de risque, ce qui me semble malsain. La scène militante française d’Instagram est imprégnée de ces représentations et je dois avouer que cela m’agace. La course à la radicalité est pour moi vaine, et je suis fatiguée de voir des hommes cisgenres et hétéros se mettre constamment en scène tandis que des femmes ou personnes non-binaires qui militent demeurent les « petites mains » éternelles des luttes sociales.
Il est de même évident que la charge militante est à géométrie variable en fonction de la race. Dans des collectifs ou associations en mixité raciale, il est courant d’observer que les personnes racisées sont cantonnées à des rôles d’exécutantes, ou à des tâches perçues comme triviales. À l’inverse, les personnes blanches vont occuper des postes dont elles vont tirer un certain bénéfice social. Je peux témoigner de mon expérience personnelle : actuellement en poste dans une association de lutte contre les violences faites aux femmes, et la plus diplômée et mieux rémunérée dans la structure, j’ai dû batailler pour qu’une collègue cesse de me présenter comme « la stagiaire ». Pas une seule fois jusqu’à l’arrivée récente d’une stagiaire blanche, les personnes blanches de cette association se sont attelées au ménage, qui restait une tâche que nous accomplissions avec mes autres collègues racisées et immigrées. Je trouve cela symptomatique et surtout hypocrite, surtout quand une non-horizontalité de l’organisation est vantée.
Entretien mené par Paul Tommasi.
 Les discriminations – comme les
Les discriminations – comme les




