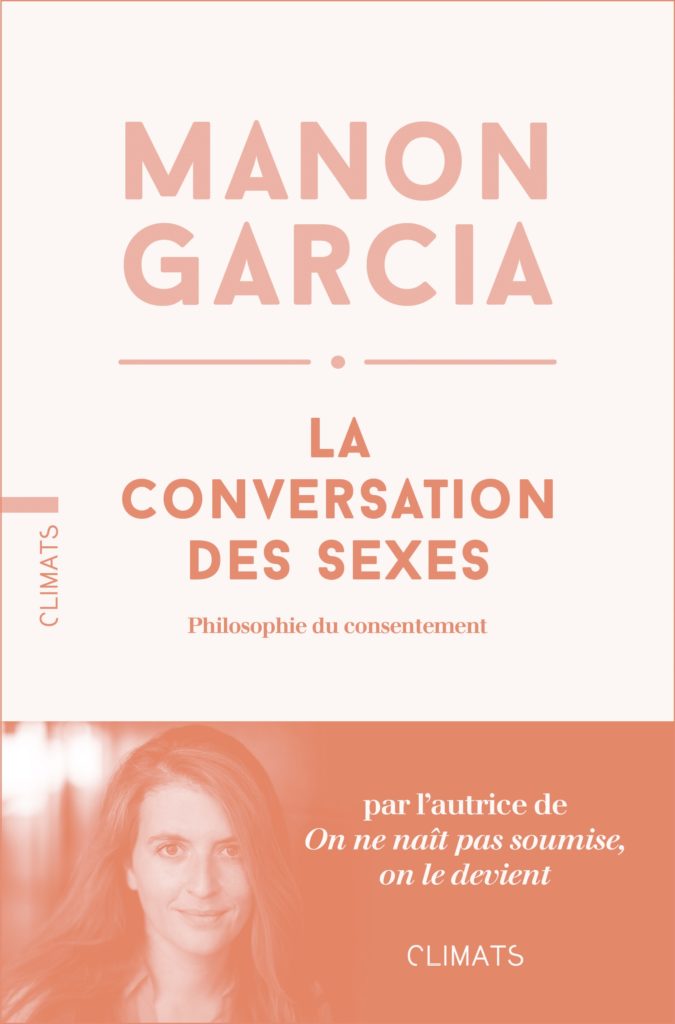
Avec cet essai, la philosophe française Manon Garcia poursuit sa réflexion féministe autour des rapports de pouvoir de genre qui impactent le quotidien, et la liberté, des femmes. Mettant (un peu) de côté Simone de Beauvoir, dont la grille de lecture structurait la pensée de son premier essai, elle s’attelle ici à faire converser différent·e·s philosophes (et quelques sociologues) sur le consentement appliqué à la sexualité. L’objectif de Garcia est évoqué dès les premières pages : elle souhaite montrer l’utilité du concept de consentement, tant pour comprendre les paradoxes de la sexualité contemporaine que pour rendre cette dernière plus égalitaire. Mais pour ce faire, il faut au préalable comprendre la multiplicité des définitions données au terme de consentement.
Le consentement comme principe d’évaluation morale et légale de la sexualité ?
« Le consentement ne va pas de soi, ni au sens où il serait présent dans l’immense majorité des rapports sexuels, ni au sens où l’on saurait exactement de quoi on parle lorsqu’on parle de consentement » (p.20)
Dans les deux premiers chapitres, Garcia mobilise les grandes théories du droit et de philosophie morale et politique qui ont réfléchi au consentement à partir du XVIIe siècle. Du droit civil des contrats et ses obligations juridiques aux obligations politiques chez Hanna Pitkin ; des théories du contrat social entre liberté individuelle et droit commun, qu’elles soient horizontales chez Jean-Jacques Rousseau ou verticales chez John Locke ; de la morale libérale de John Stuart Mill à celle substantielle de Emmanuel Kant… Toutes ces perspectives échouent à définir une sexualité « bonne » et universellement reconnue sur la base du consentement. Car le sexuel est construit à travers un enchevêtrement de lois religieuses, juridiques, morales, sociales et psychiques, et que le consentement ne peut se résoudre sur une seule de ces dimensions sans poser problème sur un autre plan, et notamment sans risquer d’imposer de nouvelles normes inégales.
Après ces 80 pages qui ont très honnêtement représenté un casse-tête pour la sociologue que je suis, et qui pourraient donner envie de ne plus jamais entendre parler de consentement (ou de philosophie), Garcia nous offre un répit avec ce qu’elle présente comme un cas idéal, celui du milieu BDSM. Idéal par la réflexivité que ce milieu apporte aux pratiques sexuelles et à leurs conséquences, et idéal, aussi, pour illustrer les ambiguïtés des théories présentées plus tôt. Si ce chapitre est plus agréable, il semble toutefois un peu moins convainquant : non par les nombreuses études citées, mais par l’impression d’uniformité des pratiques selon une éthique commune, au sein d’un milieu pourtant de plus en plus hétérogène. Ainsi, l’autrice rappelle brièvement les origines LGBTQ de cette sous-culture mais souligne également sa réappropriation hétéronormée, et donc un affaiblissement de l’aspect politique de ces pratiques en opposition aux normes sexuelles dominantes. Pour autant, la suite du chapitre décrit une communauté BDSM dans laquelle toustes les acteurices partageraient unanimement une attention éthique au consentement, pensé comme un impératif pour valoriser la dignité et l’autonomie humaine dans la sexualité. Selon l’autrice, ces valeurs sont partagées par les personnes qui s’inscrivent entièrement dans cette sous-culture, mais rien n’est dit à propos des « emprunts » occasionnels de ces pratiques qui viendraient pimenter la vie hétérosexuelle. On peut légitimement penser qu’en sortant du cadre de résistance dans lequel s’est construite cette éthique du consentement, ces pratiques n’échappent pas à un ordre hétérosexuel dans lequel ce sont les hommes qui dominent les femmes (ce que souligne brièvement l’autrice dans le chapitre suivant). Ce faisant, le BDSM n’est plus une pratique subversive, mais contribue à érotiser des violences d’hommes sur des femmes et fournit, dans un contexte de libération des plaisirs, l’excuse – perçue comme légitime – des « préférences » sexuelles. La gêne ressentie à la lecture de ce chapitre contribue toutefois à réaffirmer la nécessité de la prise en compte du contexte social quand il s’agit de déterminer si le consentement témoigne d’une volonté libre ou d’une contrainte (peut-on réellement trancher ?). Ainsi, pour le BDSM, lorsque le dominant structurel est aussi en position de dominant sexuel sur ses partenaires, on peut plus fortement douter de la place accordée au consentement « éthique » que sur une scène queer où les rapports de pouvoirs sont constamment questionnés (sans nier pour autant la reproduction de violences au sein des espaces/relations queer).
Le consentement comme principe politique de lutte contre les violences sexuelles genrées ?
« Si l’on considère que le consentement doit être l’expression d’une autonomie complète pour être un consentement valide, alors il n’y a pas de consentement sexuel valide » (p.199)
Les chapitres 4, 5 et 6 abordent un problème central qui est au cœur des critiques féministes matérialistes sur les violences sexuelles : jusqu’où le consentement peut-il être valable dans une société patriarcale ? Le chapitre 4 est consacré à un retour historique que l’on retrouve communément dans les études qui s’intéressent à la construction d’un savoir/pouvoir sur la sexualité. Sont convoqués Sigmund Freud et Michel Foucault pour décortiquer la construction sociale des désirs et leur contrôle répressif par les différents dispositifs de pouvoir, dont les individus doivent s’émanciper par l’utilisation de leurs propres corps comme outils de plaisir. Cette vision de la jouissance comme émancipation est critiquée par la politisation féministe des violences sexuelles des années 1970 : comment distinguer le viol du sexe, lorsque, par exemple, celui-ci s’apparente à une obligation conjugale ? Ce continuum sexe-viol est rendu visible par les « sex-wars » aux États-Unis, dont l’autrice regrette d’ailleurs l’appellation, étant donné la critique commune de l’hétérosexualité qui unit les différentes penseuses radicales phares comme Catharine MacKinnon, Adrienne Rich, ou Andrea Dworkin. Pour les autrices qui ont participé à cette « guerre », le postulat de départ est le même : l’hétérosexualité est un système politique qui soumet les femmes par la sexualité et le travail domestique. Les scissions concernant le consentement s’opèrent surtout autour de la pornographie, représentant pour les unes un outil supplémentaire du patriarcat sur l’objectification des femmes, quand il s’agit pour d’autres d’une manière de se réapproprier une sexualité pensée uniquement pour les hommes. Ce passage outre-Atlantique (mais on retrouve les mêmes oppositions en France sur le travail du sexe ou le port du voile) permet de mieux situer le débat qui intéresse désormais Garcia : celui de l’utilisation du consentement comme outil politique de dénonciation des injustices spécifiques infligées par les hommes sur les femmes, injustices que les auteurs classiques vus précédemment semblent avoir oubliées dans leurs théorisations de la liberté.
« Le consentement présuppose une conscience pleine qui est celle du dominant ou celle du dominé qui a pris conscience de cette domination » (p.170)
Le sexe est donc désormais théoriquement politique, mais son utilisation est au service du patriarcat, et la limite est ténue entre ce qui relève du viol ou de relations consenties. C’est essentiellement avec Nicole-Claude Mathieu et Carole Pateman que l’on revisite dans le chapitre 5 les théories libérales et contractuelles du consentement en pointant les dangers que représentent ces perspectives. Ces théories partent du principe que dans une société « moderne », donc supposément démocratique et égalitaire, le fait de consentir à quelque chose est désormais universellement possible, dès lors qu’il n’y a pas de violence explicite exercée. Ainsi, lorsque le droit utilise le consentement comme synonyme d’accord sans prendre en compte les rapports de domination qui persistent, le consentement devient l’outil le plus puissant d’asservissement des femmes. Que peut-on répliquer à la phrase « je pensais qu’elle était consentante », quand aucune violence n’est matérialisée et ne peut donc prouver l’intention de l’agresseur d’imposer sa volonté sur l’autre ? Quasiment tous les procès contemporains médiatisés se jouent sur cette ambiguïté. De ce fait, certaines féministes comme MacKinnon critiquent le terme même de consentement, puisqu’il signifie dans l’inconscient collectif qu’il y a eu un choix libre et éclairé. En d’autres termes, l’illusion d’égalité qui caractérise les sociétés occidentales ne permet pas d’utiliser le terme de consentement, puisque la liberté de chacun·e n’est pas réelle. Pour d’autres féministes, ce n’est pas tant le contexte qui empêche structurellement de consentir, mais bien le registre d’interprétation du consentement (et surtout du non-consentement) qui est construit par et pour les hommes. Le choix (véritable ou non) d’une femme concernant une relation sexuelle sera toujours en sa défaveur. L’exemple le plus probant est celui de la traditionnelle « séduction à la française » qui voudrait que les femmes résistent un peu avant de se laisser aller à leur amant : quelle place pour un consentement lorsque celui-ci est considéré comme présent alors même qu’un refus est manifesté explicitement ?
« Contre une vision du rapport sexuel comme engageant des partenaires et uniquement eux sur la base d’un choix simple fondé sur leur désir sexuel, on voit apparaître la diversité des motivations de l’activité sexuelle, la difficulté d’établir la différence claire entre pression sociale, négligence, contrainte et menace » (p.220)
Le chapitre 6 est le plus intéressant à mes yeux car il prend appui sur des auteurices anglophones moins (re)connu·e·s dans le champ français, et surtout parce qu’il aborde la question qui me hante dans mes propres travaux : les logiques d’interprétation du consentement sexuel. Là encore, seule la variable de genre est mobilisée, ce que l’on peut regretter pour l’ensemble du livre qui ne précise pas comment l’intersection de différentes asymétries (de race, de classe ou d’orientation sexuelle) affecte le consentement. Or, si l’impact des rapports de pouvoir de genre est si fort concernant les stéréotypes qui orientent les comportements, on peut légitimement supposer que l’imbrication d’autres inégalités crée d’autres rapports situés au consentement. Bref, l’apport de Garcia est de rendre accessibles ces travaux quasi-entièrement anglophones qui montrent (depuis les années 1990 !) que le consentement simpliste et binaire qui implique que tous les rapports acceptés sont des rapports désirés (vision libérale du yes means yes) est erroné dès lors que l’on s’intéresse au quotidien des sexualités. En effet, de nombreuses raisons font que les individus acceptent des relations sexuelles sans pour autant les désirer, et sans qu’elles soient explicitement contraintes. Que cela soit fait consciemment pour avoir « la paix », obtenir un échange économique ou social ; ou bien plus inconsciemment par reproduction du seul script sexuel (concept développé par les sociologues John Gagnon et William Simon) à disposition, les personnes savent simuler un accord. C’est le principe même de l’hétéronormativité, qui est de mettre en scène une attirance « naturelle » des corps (cishétérosexuels), qui s’accorderaient sans avoir à se demander. La simulation de tels scripts n’est donc pas fastidieuse, et ce d’autant plus que ces mêmes études montrent que les pratiques hégémoniques du consentement sont essentiellement non verbales et non explicites. Dès lors, une réciprocité de gestes ou un enthousiasme feint ne permettent pas de garantir que le consentement est moralement valide.
De même, le « no means no » pose problème dans la mesure où il fait reposer sur les individus la responsabilité de « juste dire non », alors même que l’on a vu plus haut combien les positions sociales occupées peuvent interférer dans la possibilité, voire la conscience, de pouvoir dire non. Garcia convoque ici une piste passionnante des analyses de la conversation en montrant que même dans les interactions non sexuelles, les règles de politesse (occidentales ?) font que le fait de refuser explicitement quelque chose, encore plus sans se justifier, est complexe, en particulier pour les femmes. Comme le dirait le sociologue Erving Goffman, il s’agit de ne pas « perdre la face » et d’éviter le malaise dans la relation en agissant de manière appropriée.
À ce stade de la lecture, Manon Garcia résume elle-même le trouble qui peut nous habiter : « le viol est un cas extrême d’un continuum de relations sexuelles non voulues, qui représentent vraisemblablement une partie considérable des relations sexuelles » (p.220). Dès lors, cette forme de consentement, valable légalement, est-elle souhaitable moralement ?
Le consentement comme outil de communication érotisé au service d’une sexualité réflexive/respectueuse ?
« [A]ucune libération individuelle ne sera possible sans une transformation sociale produite par des mouvements sociaux de grande ampleur, tout en reconnaissant le potentiel émancipateur imparfait mais réel du consentement comme invitation à une nouvelle conversation érotique entre égaux » (p.252).
Le dernier chapitre constitue une proposition de Manon Garcia (avec un retour de Beauvoir) pour, malgré tout, continuer à avoir des « relations sexuelles bonnes sur le plan moral » (p.227). Pour que cela soit possible, elle prône un impératif de reconnaissance intersubjective de l’autre et de soi comme sujets autonomes, désirants et à respecter. Pour elle, l’activité sexuelle devrait être une recherche de plaisir construite mutuellement, ce qui amène à converser, plutôt qu’à négocier. Dans la lignée des féminismes anticarcéraux, elle montre que la garantie de cet avenir conversationnel ne se trouve pas dans une judiciarisation de la notion de consentement, pourtant portée en France (et déjà promue dans certaines universités états-uniennes) par les courants favorables au consentement dit « affirmatif », et qui considèrent que le consentement doit être « libre, éclairé, spécifique, réversible, enthousiaste ». C’est notamment sur ce dernier point que le bât blesse, puisque ce discours mène à considérer la bonne sexualité, du point de vue de la légitimité comme de la légalité, est uniquement celle qui est désirée. Or nous l’avons vu, on peut faire du sexe, être consentant·e à cette activité, et pour autant, disons-le, avoir la flemme, donc ne pas manifester un enthousiasme débordant et pour autant en retirer des bénéfices pour soi, pour sa relation, ou pour tout un tas d’autres raisons.
Pour rendre légitimes ces « autres raisons » d’avoir des relations sexuelles, Garcia met en avant le concept de « projet sexuel » développé par les sociologues Jennifer Hirsch et Shamus Khan, et qui prend en compte d’autres raisons que le plaisir comme but de l’activité sexuelle. Cependant, un tel projet nécessite des dispositions, des outils, du temps pour élaborer une subjectivité sexuelle conscientisée (voire politisée) sur les raisons pour lesquelles on a une relation sexuelle. C’est une première critique que l’on peut formuler, et qui n’est pas abordée dans ce livre : qui a les moyens matériels, temporels, culturels, juridiques pour élaborer une connaissance fine de ses désirs et de ses limites ? Ironiquement, la manière même dont cet ouvrage complexe est structuré m’a souvent menée à me demander : qui a le privilège de se poser autant de questions ? (Je me demande la même chose pour ma thèse.)
Enfin, pour consolider cette conversation, Garcia prend le parti d’en érotiser le contenu, c’est-à-dire d’aller à l’encontre des croyances tenaces selon lesquelles verbaliser le consentement « casserait l’ambiance ». Elle propose que cette érotisation se fasse à l’aide par exemple de séries qui diffuseraient une représentation positive de la sexualité (comme peut le faire la série Sex Education), mais aussi à travers une intervention de l’État avec des « campagnes d’éducation populaire et de prévention des violences sexuelles » (p.252) ou la prise en compte des questionnements éthiques développés dans des champs non sexuels.
Conclusion
« Le consentement ne remplit pas toutes ses promesses, il ne nous permet pas d’effectuer clairement le départ entre sexe et viol mais il contribue, paradoxalement, à identifier l’enjeu central d’une étude morale et politique de la sexualité et à y répondre ». (p.223)
Avec cet essai, Manon Garcia dépoussière l’ouvrage français de référence de Geneviève Fraisse sur la philosophie du consentement (2007 !) et amène à une compréhension d’autant plus fine des enjeux contemporains autour du consentement sexuel, qui ne se réduisent pas à une simple opposition consentement/bon/légal/légitime vs viol/mauvais/illégal/illégitime. À l’instar de nombreuses études psycho-sociales anglophones en cours depuis les années 2000, l’autrice démontre qu’une relation sexuelle peut combiner autant de ces adjectifs, ce qui vient questionner nos repères pour caractériser ce que devrait être une « bonne » sexualité.
Manon Garcia ne propose pas de solution concrète pour discerner le « vrai » consentement, dont elle montre d’ailleurs l’illusion performative de nouvelles pratiques « positives » du consentement dans un contexte asymétrique qui demeurerait inchangé. En revanche, son ouvrage est une réelle conversation entre auteurices qui ont alimenté les réflexions sur le consentement, et donne à voir une cartographie des débats occidentaux très riches pour les chercheureuses qui souhaiteraient se lancer dans l’épineux sujet du consentement sexuel.
Toutefois, et comme le dirait Audre Lorde, « the master’s tools will never dismantle the masters’s house ». En ce sens, les dernières lignes de l’ouvrage sont quelque peu décevantes puisqu’elles appellent à un changement individuel au sein du couple hétérosexuel : mieux connaître et exprimer ses désirs, écoute respectueuse de l’autre… L’autrice ne tombe pas dans un discours « self-help », mais la limite semble poreuse. Comme si, alors même que plusieurs chapitres soulèvent l’importance capitale du « privé est politique », la clé d’un consentement égalitaire se trouvait finalement dans une meilleure communication interpersonnelle. D’ailleurs, les hommes sont présentés comme étant à la fois ceux qui oppressent, et ceux qui ont un rôle décisif à jouer pour faire advenir une relation égalitaire en termes de consentement, du fait de la « vulnérabilité » des femmes dans la sexualité. Comme si, encore une fois, il fallait attendre des puissants qu’ils daignent nous considérer pour que l’on vive mieux. Ces deux constats mettent l’accent selon moi sur les faibles leviers d’action dont nous disposons pour faire advenir des pratiques respectueuses du consentement sans pour autant briser les bases asymétriques du système.
Alexia Boucherie est doctorante en sociologie. Sa thèse porte sur les différentes appréhensions du consentement dans la sexualité contemporaine.
 Les discriminations – comme les
Les discriminations – comme les




