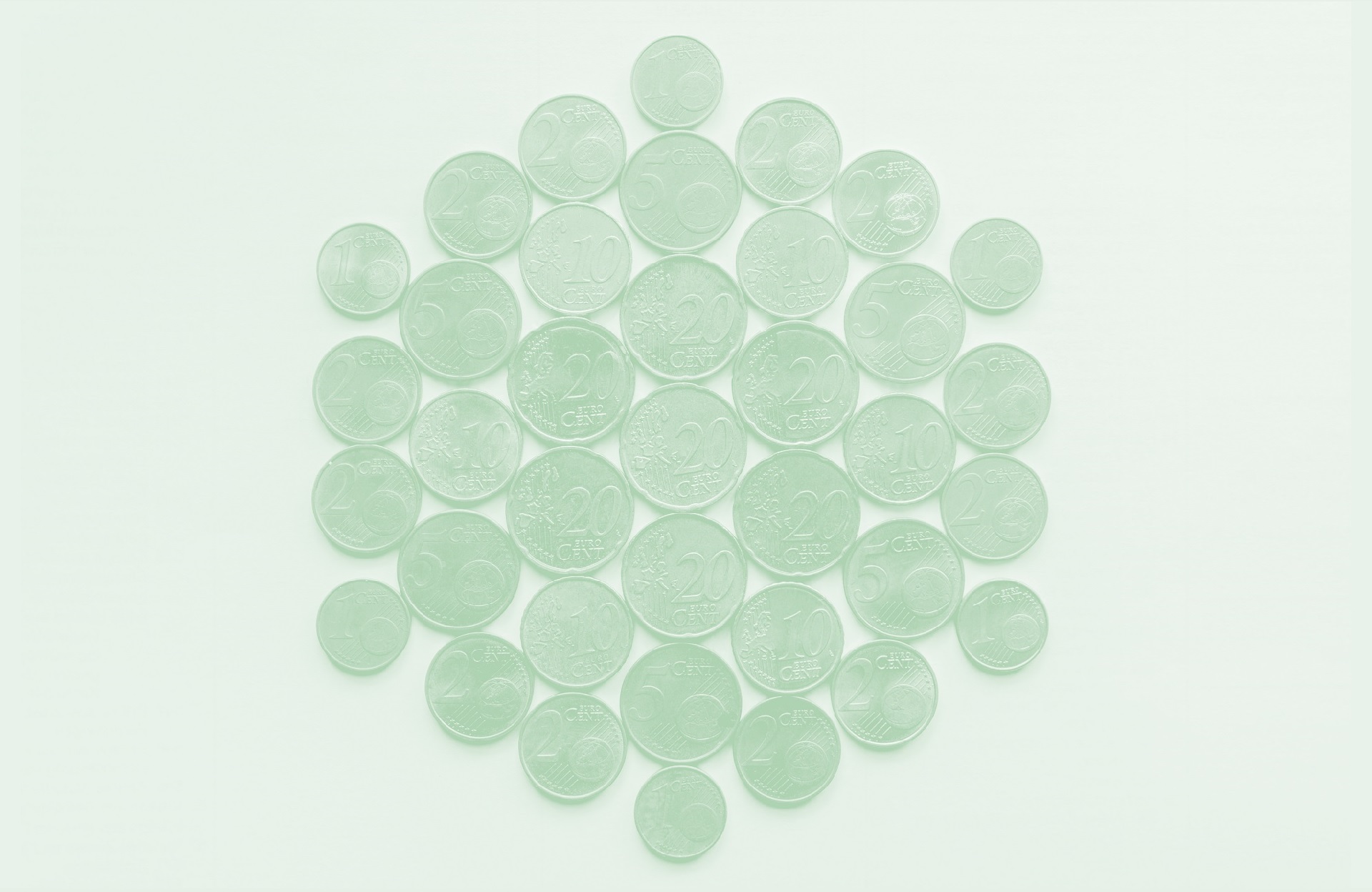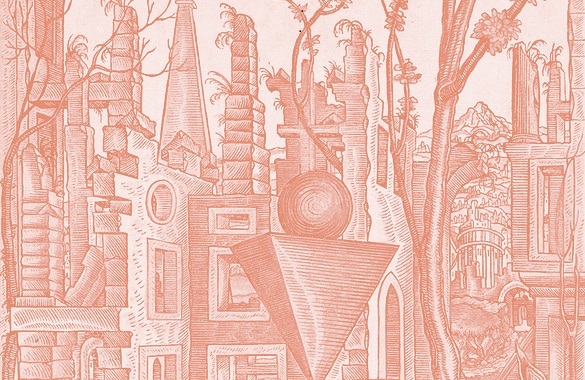Dans un article qui aurait mérité une plus large audience, Victor Borgogno pointait il y a plus de trente ans l’absence de réciprocité de perspectives dont souffrent les relations entre les « nationaux » et les « immigrés » dans les quartiers populaires1Borgogno Victor, « Le discours populaire sur l’immigration : un racisme pratique ? », Peuples Méditerranéens, vol. 51, n°04-06, 1990, pp. 7-30.. On pourrait gloser sur le choix de ces termes pour désigner des groupes dont la qualification, il faut bien le reconnaître, continue de poser problème dans le débat public comme dans le champ scientifique. Mais là n’est pas l’essentiel. En attirant notre attention sur cette expérience pratique qui consiste à se mettre temporairement à la place de celui ou celle que l’on perçoit comme autre, l’auteur mettait le doigt sur l’un des mécanismes centraux de la socialité ordinaire. Et en décrivant des situations dans lesquelles ce n’est pas le refus de s’y livrer qui semble en cause, mais l’oubli même de ce qu’une telle expérience est possible, il nous invitait à élargir notre réflexion bien au-delà du cas qui le préoccupait, celui du vote populaire en faveur du Front National.
La réciprocité que le sociologue voyait à l’œuvre dans certains contextes mais pas dans d’autres n’était pas pour lui en effet, ou pas principalement, la marque d’un effort auquel on consent pour mettre de l’huile relationnelle dans les rouages sociaux, mais bien l’effet de certitudes intériorisées en vertu desquelles il va de soi que l’autre a lui aussi un point de vue et qu’il me fait crédit d’en avoir un moi-même. Ou, pour le dire autrement : ce n’est pas parce que nous nous mettons consciemment à la place de l’autre que l’échange devient possible malgré nos désaccords. Si nous sommes capables de les dépasser, c’est parce que, sans même y réfléchir, chacun accepte que l’autre soit par nature lui aussi un sujet (psychologique, social, politique, juridique, etc.).
On pourrait bien sûr discuter longuement de ces prémisses, qui font l’objet de querelles bien connues en philosophie comme dans les sciences sociales, et de leurs implications politiques. Si, en effet, la réciprocité de perspectives n’est possible qu’entre des individus qui s’y prêtent parce qu’elle leur semble aller de soi, on voit mal comment on pourrait instituer par une action politique volontaire ce qui doit son efficacité sociale précisément au fait de paraître naturel.
Un climat public dégradé
Toutefois, si le savant est dans son rôle lorsqu’il décrit les apories de tout projet politique visant à fabriquer rationnellement des liens sociaux spontanés, le simple observateur du débat public qu’il est généralement aussi peut difficilement se satisfaire d’un climat, celui que le débat public justement donne à voir aujourd’hui, où toute réciprocité de perspectives semble avoir été évacuée. Et il peut difficilement éviter de s’interroger sur les voies et moyens par lesquels on pourrait introduire dans les controverses qui animent la vie publique ne serait-ce qu’un soupçon d’attention à l’expérience du monde social dont sont porteurs celles et ceux que l’on se donne comme adversaires.
C’est tout le drame des personnes qui se vivent comme transfuges, quels que soient les points de départ et d’arrivée de leur voyage social, de n’être que trop conscientes d’une cécité sociale qui les condamne souvent au silence et au dépit, parfois au cynisme ou au ressentiment, parfois encore à la quête narcissique de positions de pouvoir au nom d’un Universel dont elles s’estiment seules légitimes pour dessiner les contours. Mais au-delà de ces trajectoires biographiques particulières, qui n’ont rien toutefois de statistiquement marginal, chacun gagnerait à être conscient de ce qui se joue ici et à prendre au sérieux cet enjeu politique majeur.
On a beaucoup moqué à ce propos, et sans doute à raison, les appels incantatoires au « vivre ensemble » qui se multiplient depuis quelques années dans la vie publique. Et, pour ne prendre que cet exemple, on sait les limites de toute action publique se bornant à une dénonciation morale du racisme, de l’antisémitisme, ou de toute autre manifestation de rejet de l’autre pour ce qu’il est. Dans ce sens, il serait naïf, et d’ailleurs politiquement assez suspect, de miser sur des politiques publiques visant à instaurer une empathie émotionnelle ou cognitive généralisée entre les individus qui se reconnaissent dans des collectifs marqués par la colère sociale, que l’on songe à ceux qui se voient labellisés ou qui se désignent eux-mêmes comme « gilets jaunes », comme « racisés », comme « patriotes », comme « islamo-gauchistes » ou encore comme « complotistes ».
Autrement dit, ce n’est sans doute pas en dépolitisant les revendications et les anathèmes mutuels que l’on créera le monde dont rêvent ceux-là mêmes pour qui le conflit est un mal en soi, mais au contraire en assumant le caractère agonistique de la vie en société et en lui donnant une forme sociale. La réciprocité de perspectives, dès lors, n’est plus une fin en soi, ni même un impératif moral, mais un moyen, un dispositif, un mode d’organisation sociale.
La place des corps intermédiaires
Or, de tels espaces sociaux existent où s’exercent des médiations entre les récits qui circulent dans le débat public et l’environnement immédiat des gens ordinaires ; des espaces où l’on peut admettre la nuance tout en acceptant l’idée que, sur certains points, il n’existe pas une vérité définitive mais des approches différentes, parfois même antagonistes, mais qui doivent malgré tout essayer de fabriquer du commun ; des espaces où des acteurs essaient, à leur échelle, de faire vivre avec discernement le projet collectif de construire un monde social vivable.
Ces espaces, on les trouve dans ce qu’on a longtemps appelé les corps intermédiaires : syndicats, partis politiques, associations, fédérations, conseils, assemblées et autres instances s’intercalant entre l’individu et l’État pour donner corps à ce que, faute de mieux, on continue d’appeler la société civile. Mais ces espaces de sociabilité sont aussi des terrains d’expertise, ceux qu’investissent ces professionnels, travailleurs sociaux, professeurs des écoles, personnels de vie scolaire, des organismes de protection sociale ou intermédiaires de l’emploi, qui organisent au quotidien la rencontre entre des expériences diverses, font tenir les relations qu’entretiennent ces expériences et, ce faisant, font tenir les institutions elles-mêmes.
Bien sûr, il ne s’agit pas de troquer une naïveté contre une autre et de fétichiser le recours au local, au terrain, à la concertation ou à un bon sens populaire qui irait spontanément vers le juste, le bien, le vrai et le beau. Les corps intermédiaires ne protègent pas du corporatisme, le local du localisme, la concertation de la confiscation du pouvoir par quelques-uns, pas plus que le bon sens ne préserve de l’irrationalité des foules. Et on sait que s’en remettre à l’expertise des acteurs de terrain c’est parfois aussi leur donner le droit discrétionnaire de naturaliser l’arbitraire, c’est-à-dire, sous couvert de compétence technique et de légitimité bureaucratique, de justifier un monde social structurellement inégalitaire. Enfin, on n’oublie pas que, fût-ce en s’armant des meilleures intentions du monde, fonder un cercle de parole n’est sans doute pas la manière la plus efficace de réduire les inégalités de patrimoine, d’augmenter le Smic ou de limiter l’évasion fiscale.
Devenir les sociologues de l’expérience des autres
Point de candeur excessive donc, mais plutôt une méthode et un pari.
La méthode – que l’on n’évoque plus aujourd’hui que pour tourner en dérision son parfum soixante-huitard – est celle qui consiste selon la formule consacrée à demander à son interlocuteur d’où il parle, non pas comme une injonction policière à décliner son identité, mais comme une chance donnée à celui ou celle qui pose cette question d’espérer qu’on la lui posera en retour. À un premier niveau, cela implique de poursuivre, sans démagogie mais obstinément, l’enquête sur ce qu’en d’autres temps des chercheurs ont nommé les « lieux neutres », c’est-à-dire ces scènes de débat public sans chef d’orchestre mais dont émane néanmoins une petite musique, où l’on se prétend ou l’on se pense à distance de toute entreprise idéologique, et où pourtant se forgent les « schèmes générateurs » d’un discours dominant sur le social2Bourdieu Pierre, Boltanski Luc, « La production de l’idéologie dominante », Actes de la recherche en sciences sociales, Vol. 2, n°2-3, 1976, pp. 3-73.. Appliquée par exemple aux médias, et dans leur propre intérêt au vu de la défiance qu’ils semblent inspirer à une part grandissante de la population, ce souci justifie que l’on interroge plus qu’on ne le fait les conditions de production de l’information et les états de service des multiples commentateurs de la vie publique qui y prennent part. De manière plus ambitieuse, et peut-être plus transgressive, il y a aussi sans doute matière à se questionner sur la façon dont la voix des sans voix, et plus encore les conflits qui opposent des invisibles à d’autres invisibles, accèdent à l’attention publique. Les sciences sociales disposent à ce titre d’un bel outil, le récit de vie, pour saisir le monde social à travers l’inscription qu’il laisse dans la trame d’expériences quotidiennes toujours singulières. Les travaux des chercheurs, comme la littérature et le cinéma, mettent de telles expériences en partage. Mais l’on se prend à rêver de dispositifs qui, sans voyeurisme ni fausse pudeur, permettraient à deux anonymes que tout semble opposer en dehors de leur commune infortune, de se livrer publiquement l’un à l’autre les secrets de leur être social.
Le pari, c’est justement celui que font quotidiennement, bon gré mal gré, des milliers d’éducatrices et d’éducateurs spécialisés, de profs, d’animatrices et d’animateurs socio-culturels ou d’aides-soignantes et d’aides-soignants lorsqu’ils affrontent cette question dérangeante et qu’ils redessinent ainsi, discrètement et le temps d’un échange, les frontières sociales, culturelles ou ethniques sur lesquelles s’établissent (et que contribuent à tracer) les controverses qui nourrissent le débat public. Non sans heurts et parfois malheureusement jusqu’au drame, mais souvent plus sereinement que ce que l’on entend dire, de telles rencontres se font dans les salles de classe, dans les lieux où l’on croit encore à l’éducation populaire, dans les établissements de soin où l’on s’efforce encore d’être ouvert à tous. Mais elles ne continueront de se faire qu’à condition d’en saisir l’importance et la portée : symboliquement bien sûr, en reconnaissant ce que nous devons à ces myriades d’artisans du lien social ; mais aussi, et peut-être surtout, en leur épargnant, parce que les conditions matérielles ne sont pas à la hauteur, de ne trouver de sens à leur métier qu’en se croyant voué au sacerdoce au nom d’une vocation.
Ce qui est une manière de dire que nous gagnerions tous et toutes à nous faire de temps en temps les sociologues de l’expérience des autres. Et, lorsqu’on est sociologue à plein temps, à ne plus s’excuser de pratiquer une science qui dérange.
Gilles Frigoli est sociologue et maître de conférences à l’université Côte d’Azur.